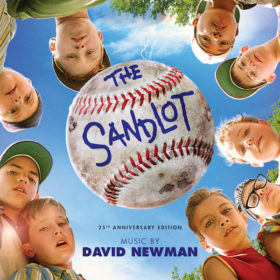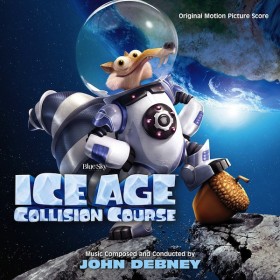Ils s’appellent Derek Flint, Francis Coplan, Hubert Bonisseur de La Bath, Dick Malloy. Les besoins de leur profession les ont affublés de matricules ésotériques comme A-S 3, OSS 117 ou X 1-7. Ils portent (plus ou moins) avantageusement le smoking, déambulent dans des décors tout droit issus d’une brochure touristique, et ni les menaces proférées par quelque génie du mal au petit pied, ni les jambes gainées de noir qu’exhibent de lascives gourgandines ayant juré leur perte, ne peuvent égratigner leur flegmatique réserve. Bien entendu, toute ressemblance avec James Bond ne saurait être que fortuite…
 #1 – (Une) opération (du) tonnerre
#1 – (Une) opération (du) tonnerre
#2 – Bons baisers d’Umiliani
#3 – Dupliquer n’est pas jouer
#4 – Au service secret de l’Élysée
#5 – Les clones ne meurent jamais
#6 – Lalo Royal
#7 – Spyfall
#8 – Le monde ne leur suffit pas
Granuleuses, lacérées de griffures, parfois handicapées par un noir et blanc éreinté, et pourtant rayonnant du fantastique éclat des sourires que la procession des chars faisait éclore par milliers : nul n’a oublié les images de Paris en liesse, enfin soulagée du terrible poids du talon allemand le 25 août 1944. Dans le sillage de la division Leclerc, qu’on avait laissé pénétrer la première dans la capitale pour sauver un peu de l’honneur français en lambeaux, les G.I. bardés d’armes mais aussi de cannettes de Coca-Cola et de tablettes de chewing-gum se préparaient déjà à lancer une nouvelle invasion : celle des nations fraichement libérées par la culture américaine. Comme l’Histoire l’a très largement prouvé depuis, cette opération séduction se révéla incroyablement fructueuse. Pour James Bond, l’espion britannique devenu un peu malgré lui l’un des grands émissaires de la toute-puissance hollywoodienne, le constat se vérifie également. Papillonnant de conquêtes faciles en amours volages, 007 ensemença les quatre coins de la planète. Des innombrables petits bâtards qui virent ainsi le jour, beaucoup se seraient sans doute perdus dans l’oubli sans la folle ténacité de cinéphiles hardis, ou tout simplement inconscients, pour qui les contrées exotiques sont un réservoir inépuisable d’objets défiant l’entendement.
Le Japon n’est pas la plus inaccessible de ces destinations, bien qu’en 1967, nombre de spectateurs occidentaux trouvèrent dans You Only Live Twice (On Ne Vit Que Deux Fois) un parfait dépaysement. Avec la bénédiction du grand acteur local Tetsuro Tamba et d’un John Barry enivré par sa propre verve romantique, Sean Connery faisait son petit marché au milieu d’une cohorte de belles plantes, toutes roucoulantes face à la virilité du grand mâle blanc. Mais sans doute ignorait-il qu’à son arrivée, les copies censément conformes sévissaient déjà. Hyappatsu Hyakuchu (Chasseurs d’Espions) en 1965 et sa suite Ogon No Me trois ans après adoptaient pour héros le bellâtre Akira Takarada, vieux routard du kaiju eiga ici tout de blanc vêtu, que des intrigues d’espionnage farfelues mettaient aux prises avec des essaims de porte-flingues hystériques, des naïades férues de (très) gros flingues et un clone hébété de Groucho Marx. N’ayant nullement l’intention d’assainir cette joyeuse folie, Masaru Sato, de qui l’on n’a peut-être pas assez dit quel remarquable compositeur il était, érige des partitions capharnaüm où les incongruités timbriques de ses musiques de comédie et sa solide expérience de la série noire fusionnent plaisamment. Plus tard, ce cocktail bien frappé devait faire le petit charme des Godzilla estivaux de Jun Fukuda. Dans les sixties, des kyrielles d’autres films, certains musicalisés encore par Sato, ont donné l’opportunité de s’en délecter, comme le réjouissant Ore Ni Sawaru To Abunaize (Black Tight Killers) ou A Chow Bei Mat Ging Chaat (Asiapol Secret Service), échu à l’excellent compositeur Toshiro Mayuzumi… Moult divertissements inféodés de manière plus ou moins voyante au glamour stylisé de la Bondmania.
Mais 007 n’était pas seul dans leur collimateur. L’énorme succès des aventures du détective Tajima, interprété par les bajoues saillantes de Joe Shishido, avait fait des envieux qui s’échinaient depuis lors à recréer la maestria pop de l’iconoclaste réalisateur Seijun Suzuki. Un processus d’émulation qui passait par un Scope pétaradant, des répliques sarcastiques, une nonchalance de tous les instants (de bien belles choses directement héritées de James Bond, elles aussi. Les grands esprits se rencontrent toujours) et une coolitude musicale que même les rebondissements les plus dramatiques ne pouvaient fissurer. Pour preuve, la scène d’ouverture du premier volet de la série, Tantei Jimusho 2-3 : Kutabare Akutodomo (Détective Bureau 2-3), qui voit Harumi Ibe faire valser un saxophone très swing sur fond de cadavres et de voiture en flammes. Passé ce coup de sang liminaire, le score sombre carrément dans une humeur torpide, un peu de vibraphone ici, quelques soupirs fatigués de la trompette par là, ne posant plus qu’un oeil indulgent sur les forfanteries de Tajima qui trompe son monde, bafoue la loi et violente de splendides créatures avec le même rictus satisfait que Sean Connery. A l’écran, la somme de tous ces éléments procure évidemment d’infinis plaisirs. Kokusai Himitsu Keisatsu : Kagi No Kagi (International Secret Police: Key Of Keys), l’un des nombreux succédanés des hits de Suzuki, était-il de cette roborative trempe ? Pas facile d’émettre une opinion quelconque, le film ayant pratiquement disparu des écrans-radars.
Le coupable, même s’il ne pensait pas à mal en commettant son forfait, s’appelle Woody Allen. Pour son premier essai, en 1966, l’idée saugrenue était venue à notre hypocondriaque favori de détourner une obscure production nippone, celle qui nous intéresse présentement donc, en modifiant sa bande-son de fond en comble. Ainsi naquit What’s Up, Tiger Lily? (Lily la Tigresse), couillonnade parodique où une recette légendaire de salade d’oeufs durs (!) gravite au centre d’une guerre entre yakuzas crétins et espions pas beaucoup plus futés. On veut bien croire que l’oeuvre d’origine ait gagné à ces tout nouveaux ressorts comiques. Au sujet de la musique, on fera quand même montre d’un brin de circonspection. Initialement signée Sadao Bekku, compositeur parmi les plus respectés de la scène classique japonaise, doublé d’un grand amateur de jazz qui avait trouvé dans les sixties pailletées l’exutoire idéal, elle s’est volatilisée au profit des lénifiantes plages d’easy listening des éphémères Lovin’ Spoonful, le tout saupoudré d’un rock traîne-la-patte qui ne relève guère la sauce. C’était un score dans l’air du temps, arguera-t-on pour sa defense, on ne peut plus en phase avec son époque… mais nullement prophétique des soubresauts violents dans lesquels se convulseraient les années 70.
On l’a dit et répété : avec James Bond, tout le monde était tenu de se mettre au goût du jour. Y compris un personnage aussi éloigné du super-agent so smart que pouvait l’être le démolisseur Takuma Tsurugi. Délaissant (provisoirement, que les fans du grimaçant Sonny Chiba soient rassérénés) ses seyants habits de combat pour une chemise en soie et son sadisme hyper-graphique pour un romantisme aux chandelles, il séduit la prédatrice Reiko Ike et berne sans en avoir l’air ses ennemis dans Gyakushu ! Satsujin Ken (The Street Fighter’s Last Revenge). Une parenthèse trop brève pour que Toshiaki Tsushima ait eu le temps de s’en apercevoir, si l’on en juge par l’inamovibilité de la guitare électrique formant, autour du thème principal resté illustre, une haie de battements groovy. A leur tour, les femmes (carrément) fatales du bis macho-féministe (oui, c’est possible !) succombent sans se faire prier, telle la très charnelle starlette Miki Sugimoto dans le délirant Zeroka No Onna Akai Wappa (Les Menottes Rouges… mais il n’est pas défendu de préférer le titre alternatif L’Aubergine était Presque Farcie). Bien qu’elle déambule en tenue d’Eve le plus clair de son temps, les marlous vicieux peuplant son chemin ont grand tort de la croire inoffensive : de son sac à main jaillissent des gadgets mortels, en particulier les fameuses menottes dont elle use comme d’une chaine dans un film d’arts martiaux. Shunsuke Kikuchi, qui n’était plus, en 1974, qu’à quelques encablures de la gloire que lui vaudraient les pyjamas multicolores du tokusatsu et surtout le mythique Doragon Boru (Dragon Ball), s’amuse à peu de frais, ne puisant que le minimum de son inspiration généralement tonitruante, mais sans livrer pour autant un travail de vendu. Ainsi procéda-t-il sur pas mal d’autres petits classiques du genre, au point d’en être sacré l’un des ambassadeurs récurrents.
Son confrère Masaaki Hirao s’est parfois montré moins docile. Qu’elle fut rock’n’roll, en souvenir de ses débuts dans la chanson qui consistèrent surtout à singer les déhanchements félins et la coupe luisante de gomina du King Elvis, ou romantique, comme les adaptations animées du génial mangaka Leiji Matsumoto dont il devint le compositeur régulier, son insoumission baigne Esupai (Espy) d’un charme sixties qui, dans les années 70, semblait déjà suranné. A cette histoire purement SF de terrifiants pouvoirs mentaux, assaisonnée pour la circonstance des habituels ingrédients des pseudo-007 (beaucoup d’espions à l’élégance m’as-tu-vu et de beach girls armées jusqu’aux dents, donc), le compositeur apporte la douceur de mélopées rieuses et d’orchestrations piquetées de discrètes enjolivures. Mais si la nostalgie d’une époque révolue n’aura été qu’une brève passade pour un Hirao bientôt rattrapé par le cours du temps, elle représente, dans le cas de l’hyperactif Yuji Ohno, une authentique profession de foi. Les aventures de Lupin III en sont la meilleure preuve. Descendant très officiel d’Arsène Lupin en personne (il est son petit-fils), le gentleman cambrioleur de l’Archipel doit aussi énormément à son autre père, non plus biologique mais spirituel : James Bond, tel qu’incarné par Sean Connery. D’innombrables adaptations live et surtout animées, qui s’étendent de 1971 jusqu’à nos jours, n’auront pas réussi à guérir le personnage de son swinging feeling. Ohno, pour sa part, s’est bien gardé d’essayer, trop heureux qu’il était de s’adonner encore et encore à un jazz polymorphe, tantôt mélancolique et velouté, rempli de dynamiques embardées l’instant d’après, puis charmeur jusqu’à atteindre une espièglerie presque infantile.
Des années de loyaux services, seulement rompues par d’occasionnels one shots (on pense à l’excellent Rupan Sansei – Nenriki Chin Sakusen de Masaru Sato), ont placé Ohno à la tête d’une discographie tentaculaire, dont un chroniqueur kamikaze ne viendrait à bout qu’au prix d’un volume entier et de beaucoup d’huile de coude. Mais là n’est point l’objectif du présent papier. Lupin III, après tout, n’est pas le seul virtuose de la cambriole à s’être acquitté de sa dette envers 007. Le cinéma de Hong Kong est même rempli de ces spécimens, majoritairement féminins. Sous l’impulsion d’un Chu Yuan encore débutant, qui tournerait plus tard certains des plus féériques wu xia pian de la Shaw Brothers, l’ex-colonie britannique connut en plein coeur des sixities une vraie orgie de caper movies mêlant gadgets rudimentaires, richissimes mégalomanes et super-héroïnes masquées. Ces dernières, presque toujours incarnées par les très jeunes Josephine Siao Fong-Fong et Connie Chan Po-Chu (les Shirley Temple chinoises, pour faire vite), se paraient de pseudonymes ronflants (dont un Lady Bond on ne peut plus explicite) et rendaient la justice en même temps qu’une morale confucéenne un rien rasoir. Tombés depuis lors au fond de sombres oubliettes, sans même la caution d’un Quentin Tarantino pour espérer une soudaine résurrection, ces films n’ont laissé comme preuve tangible de leur existence qu’une poignée de sorties vidéos et de 45 tours. A l’intérieur des pochettes élimées par l’âge, quelques remugles jerk et pop songs ouvragées en quatrième vitesse, qui rappellent à toutes fins utiles que la France ne fut pas seule à souffrir des assauts du yé-yé.
De toute manière, il n’y avait pas grand-chose d’autre à jeter en pâture aux mélomanes. Et pour cause ! A cette époque, le cinéma hong-kongais, envoyant bouler copyrights et probité déontologique, s’était déjà fait une spécialité de pirater les bandes originales en provenance des quatre coins du monde. Un titanesque catalogue dans lequel, jusqu’au début des années 90, les productions locales ont puisé en toute impunité les morceaux d’action et les trémolos romantiques nécessaires à leur survie. Dans la catégorie qui nous intéresse, John Barry, avec ses tubes « bondiens » sous le bras, se trouvait évidemment aux premières loges. Pire, les réalisateurs chinois ne tardèrent pas à l’arracher aux monte-en-l’air sexy du Jane Bond movie pour lui faire passer en revue les genres dominants de l’industrie. A commencer par le film de sabre, où l’on distinguera tout particulièrement Ho Meng-Hua. Cet ayatollah des gadgets meurtriers avait le chic pour glisser dans les mains de ses épéistes d’extravagantes armes (dont une mémorable guillotine volante), qu’on eût pu croire inventées par un aïeul médiéval de Q. Ce qui ne rend pas moins déconcertants, aux yeux du spectateur occidental non vacciné, les duels à mort enrobés du grand thème d’action d’On Her Majesty’s Secret Service (Au Service Secret de Sa Majesté), l’une des victimes favorites des resquilleurs de la pellicule.
Mais Hong Kong ne s’est pas toujours vautrée à plaisir dans l’illégalité. Il valait d’ailleurs mieux dans le cas de Zhi Dao Huang Long (L’Homme de Hong Kong), très distrayante oeuvrette fantasmée par la superstar martiale Jimmy Wang Yu comme son passeport pour le marché international. Afin de toucher à l’efficacité américaine tant convoitée, il lui fallait un budget plus confortable que d’ordinaire, un cadre à la fois exotique et familier pour tous (ici, celui d’une « jamesbonderie » orientale truffée de ces poursuites en voiture et à pied dont les seventies étaient gourmandes) et un score raisonnablement efficace, en plus d’être original. Peu ou prou, c’est ce qu’a fourni le compositeur australien Noel Quinlan : des charges funk tricotant à toute vitesse, quelques mixtures synthétiques déjà moins heureuses et la chanson Sky High du groupe Jigsaw, qu’un auditoire fatigué pourrait presque confondre avec un rebut inavoué des Beatles. Inégal, donc, mais à choisir, de loin préférable aux atrocités Bontempi que la plupart des musiciens locaux sont habitués à fournir en masse.
Dans Guo Chan Ling Ling Qi (Bons Baisers de Pékin), tourné vingt ans après, le mythique leitmotiv de Monty Norman aurait sans nul doute bien mieux convenu à Stephen Chow, 007 idiot et expert dans le maniement du hachoir, que sa grésillante copie. L’humour absurde du prince du mo lei tau (ou, traduit du cantonais, « n’importe quoi »), s’il affiche là une vigoureuse santé, n’est clairement pas aidé par l’insignifiant bricoleur William Woo : essayez d’imaginer John Barry, soudain saisi d’horribles coliques en plein phrasé mélodieux, et vous aurez une idée à peu près précise du résultat… Chow et Wang Yu ne sont pas les seules vedettes hongkongaises à s’être colletées à l’agent au permis de tuer. La plus assidue d’entre elles, aussi surprenant que cela paraisse, n’est autre que Jackie Chan. En y réfléchissant mieux, cependant, l’étonnement s’estompe vite. Souvenons-nous qu’au firmament de sa gloire, le sympathique trompe-la-mort attirait ses fans dans les salles comme il l’aurait fait des inconditionnels de Bond, les bombardant de succulentes promesses d’évasion, de jolies filles et de décors monumentaux. Sûrement, la superbe base secrète de Fei Ying Gai Wak (Opération Condor) aurait soulevé l’admiration de Ken Adam, l’exubérant production designer des premiers 007. A la musique, Chris Babida ne se prend guère au sérieux, butinant d’un héroïsme cheap, vague réminiscence de Superman, à un désert échappé tant des Cigares du Pharaon d’Hergé que des fonds de tiroir de Maurice Jarre. Sans oublier, pour parfaire le tableau, les litanies marrantes que scande le mystérieux peuple des dunes… Inoffensif mais constamment amusant, l’ensemble divertit bien davantage que Te Wu Mi Cheng (Espion Amateur), tentative ringarde et sans le sou de concurrencer le gros son hollywoodien, ou l’inodore Ging Chaat Goo Si 4 (Contre-Attaque). Ayant acquis les droits de celui-ci sur le sol américain, l’opportuniste New Line résolut carrément de jeter aux orties sa bande-son au bénéfice d’une nouvelle partition, signée du très inégal compositeur de l’ombre J. Peter Robinson. First Strike, tel qu’il s’intitule là-bas, ne figurera jamais parmi ses meilleurs travaux, la faute aux énigmatiques hors-sujets qui le parsèment. Que viennent donc fabriquer ces percussions brésiliennes au beau milieu d’une scène de combat sans rien d’exotique ?
Hollywood, cet ailleurs fabuleux qui s’est longtemps refusé à Jackie, semblait à même de lui ouvrir l’accès aux munificences orchestrales trop grandes pour Hong Kong. Il a pu y croire un temps durant grâce à Lalo Schifrin, inspiré et groovy pour son premier grand succès américain, Rush Hour. La suite de ses tribulations outre-Atlantique est cependant loin d’avoir transformé cet essai prometteur, comme si le comédien, au moment de quitter la terre de ses exploits, avait malencontreusement glissé dans son baluchon des décennies de musiquettes sans relief. Déjà pas du genre à faire se hérisser d’excitation les poils des avant-bras, les parties acoustiques de The Tuxedo (Le Smoking), oubliable divertissement où un costume d’allure ordinaire transforme son détenteur en super-espion, se compliquent d’effets électroniques triturés par un John Debney loin de son élément. On pourrait d’ailleurs en dire autant de The Spy Next Door (Kung-Fu Nanny), dans lequel David Newman, contraint de jongler avec des moyens dérisoires, livre une tambouille certes énergique mais sans rapport aucun avec les festins orchestraux qui ont fait sa réputation. Dans les deux cas, la musique, à force de renâcler et de boitiller en maugréant, dégringole à l’unisson d’une mise en scène pachydermique, sabotant du même coup les dernières chances de croire un tant soit peu à un Jackie Chan possible concurrent de James Bond.
Il serait vain de nier, ami lecteur : votre serviteur, tout humble qu’il est, a parfaitement vu votre visage se plisser sous l’effet d’une mimique bouffonne. Ce bon vieux Jackie, crédible en 007 de substitution ? Pas assez sérieux pour ce type de rôle. Trop nabot aussi ? Force est d’admettre que son physique, pourtant souple et chargé d’énergie, n’est pas franchement celui de l’emploi… Mais attendez d’avoir vu Weng Weng, vous pourriez bien réviser votre jugement. Malgré une carrière météorique dans le cinéma philippin au début des années 80 (une poignée de titres et puis s’en va), l’acteur avait trouvé l’argument parfait pour reléguer dans l’ombre les meutes de Bond concurrents : sa taille lilliputienne ! Exit Marrie Lee, la redoutable espionne de la série des Cleopatra Wong, qui exhibe ses jolies gambettes dans de fulgurantes démonstrations martiales ! Au gnouf Tony Ferrer, très populaire agent X-44, qui roule des mécaniques dans une enfilade de nanars désopilants ! Nullement intimidé, Weng Weng endosse le traditionnel smoking, tombe de délicieuses ingénues deux fois plus hautes que lui et escoffie ses ennemis avec une prédilection traitresse pour les coups (vraiment très) bas. Mais si le nain au regard vitreux sort grand vainqueur de tout ce bric-à-brac Z, ses rivaux et lui demeurent égaux face au je-m’en-foutisme des compositeurs. Bien qu’employer un tel qualificatif revienne à faire trop grand cas des pique-assiette chargés de chiper à droite et à gauche le labeur des collègues… Une interrogation persiste toutefois à l’écoute du thème principal de For Your Height Only, qui caricature avec les moyens du bord certain riff de guitare passé à la postérité. Vol caractérisé ou «creation» originale ? A dire vrai, peu importe. Plaquée à tout bout de champ sur un Weng Weng multipliant roulés-boulés et mitraillages homériques, cette rengaine se découvre un potentiel comique des plus vivifiants.
Heureusement, serait-on tenté de croire, l’Inde, vers laquelle nous emmène dès à présent notre voyage, devrait venger le béophile gavé de contrefaçons malhonnêtes. C’est un fait connu même des néophytes : on ne rigole pas avec la musique de film dans le Sous-Continent, seul et unique endroit au monde où les compositeurs peuvent se vanter d’un prestige égal à celui des auteurs les plus adulés. Mais ce phénomène culturel sans équivalent, qui plonge ses racines dans un passé millénaire, n’est pas sans cultiver quelques zones marécageuses où règnent les méthodes cavalières du bis… Au cours des années 60 et 70, au plus fort de la fièvre Bond, des musiciens, paroliers et/ou chanteurs de haute popularité tels que Baldev Nath et Rahul Dev Burman ont exploité le filon de l’espionnite à grand coups de Puraskar, Bullet et autres Golden Eyes Secret Agent 077. Les sourires épanouis des espions hindis, le texte souvent candide des numéros dansants rivalisent de naïveté avec les musicals hollywoodiens, les chorégraphies, à quelques exceptions près, beaucoup moins. Sous cet étalage de bonne humeur, pourtant, l’opportunisme cynique n’est pas si loin. Car les parenthèses chantées ont beau jouir de toutes les attentions, il n’en va résolument pas de même pour les passages instrumentaux, là encore de vulgaires transplantations des succès venus d’occident, ceux de John Barry en tête. Et les héros du cru de jouer du poing et du pistolet sur les ruées de cuivres familières de Goldfinger ou Diamonds Are Forever (Les Diamants Sont Éternels)… Aujourd’hui, les indélicatesses de ce genre s’étant faites rares, ils préfèrent se piquer aux anabolisants sonores de la « zimmerisation » triomphante des années 2000. Dans le film qui porte son nom, l’agent Vinod houspille le folklore gentiment désuet qui phagocytait en 1977 ses premières aventures, et part à la conquête d’un nouveau public grâce au score foutraque et bruyant de Pritam Chakraborty. Et si les personnages n’ont pas poussé la mutinerie jusqu’à bannir de l’écran les traditionnelles danses, ils ondulent et se dandinent désormais selon des codes occidentaux que les anciens, parfois regroupés en petits groupes frissonnant d’indignation dans un coin oublié du cadre, n’ont pas assez de mots pour conspuer.
Mais assez avec l’Asie et ses magouilleurs patentés ! Portons plutôt nos regards vers le cinéma mexicain, royaume de toutes les folies qui connut dans les années 60 et 70 un très excentrique âge d’or. La lucha libre, institution immortelle, portée par un engouement populaire ressemblant à s’y méprendre à une vraie ferveur religieuse, n’était pas en reste et dépêcha dans les salles obscures ses légions de combattants masqués. Lesquels, ravis de l’aubaine, transposèrent joyeusement à l’écran les castagnes manichéennes opposant sur le ring les vertueux défenseurs du bien aux mauvais garçons jamais à court de viles manoeuvres. Leur leader se nomme Santo, el Enmascarado de Plata, stoïque bourreau des canailles cupides, du bestiaire fantastique traditionnel, des invasions extraterrestres… et des compositeurs crapuleux ? Ceux-là, hélas, ont échappé à la vigilance des luchadores. Il faut souligner, aussi, que même les plus valeureux des colosses sans visage n’étaient pas toujours immunisés contre la tentation de lorgner la copie du voisin. On a ainsi vu Santo, dès ses premières aventures pelliculées, élire domicile dans un laboratoire secret (un débarras exigu où bouillonnent quelques éprouvettes multicolores) emprunté de toute évidence à Batman. Et même si la Bondmania a dû patienter jusqu’au début des seventies pour le contaminer, il s’est ensuite soumis de bon gré à tout son cérémonial, n’omettant ni les intrigues d’espionnage tirées par les cheveux, ni les voitures de sport vrombissantes, ni les adorables conquêtes féminines (qui laissent pourtant de marbre notre héros, trop occupé à châtier l’injustice).
Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, John Barry ne figure pas au premier rang des musiciens allègrement dépouillés par la mexploitation. James Bernard, sacré roi de l’épouvante grâce à son travail au sein de la Hammer, a bien plus souvent servi de vache à lait, comme c’était déjà le cas au cours des années 60, quand les cinéastes locaux recyclaient à en perdre haleine les sanglants méfaits de Dracula, du loup-garou et de beaucoup d’autres monstres légendaires. Dans Santo Contra Blue Demon en la Atlantida, l’habituelle grandiloquence du vénérable Bernard fait en tout cas un mélange pas aussi impur que redouté avec les frénétiques gesticulations de Gustavo Cesar Carrion, faiseur prolifique qui martyrise son orgue électronique. A scénario cinglé, cuisine sonore ad hoc, conclura-t-on en haussant les épaules. Jugez plutôt : mandaté par Interpol et bientôt rejoint par son grand rival Blue Demon, Santo doit en découdre avec un savant nazi dans les vestiges oubliés de l’Atlantide. Comme pour tout ersatz de 007, les nouvelles aventures de l’agent masqué sont fortement teintées d’exotisme et lui font prendre l’avion à destination de Madrid ou du Brésil. Haïti, dans Santo Contra la Magia Nera (Magie Noire à Haïti), est un autre de ces paysages ensoleillés où notre héros balade sa massive carcasse avec un manque d’entrain confondant. Evidemment, quand on sait que se tient à la barre l’Alfredo B. Crevenna des mauvais jours, qui transforme une intrigue « fil de fer » en une réclame touristique éhontée… Les Difficiles de Pétionville, un groupe local, marche à fond dans la combine, bien qu’il faille leur rendre cette justice que leur démonstration de konpa, musique typiquement haïtienne où la guitare se taille la part du lion, constitue la seule parcelle d’enthousiasme de toute l’entreprise.
Hors catcheurs masqués, le Mexique s’est également amusé à jeter dans Agente XU 777 le mariole ultra-populaire Cantinflas, qui s’en prend au spy movie avec tout son bagout destructeur. Cahotant, lancé sur les routes défoncées de la phonétique tel un camion privé de freins, le phrasé du comédien résonne à son éreintante façon comme une musique à part entière. Maura Monti, surtout restée fameuse pour la panoplie de Batwoman qu’elle porte avec superbe dans La Mujer Murcielago en 1968, s’en revient dès l’année suivante émoustiller l’assistance avec Con Licencia para Matar. Aux côtés d’une autre espionne à l’orgueilleux fuselage, elle botte le fondement d’affreux bad guys et met sens dessus dessous le pauvre compositeur Gustavo Cesar Carrion, qui hésite sans cesse entre easy listening un peu terne et giclées de mambo. A cent lieues de ces tergiversations, son confrère Suheyl Denizci trouvait dans la série des Altin Cocuk, fleuron turc des James Bond à la gomme, le crédo magique dont il allait user et abuser sans retenue. En dépit d’une chanson pour le moins catchy, flanquant une langoureuse danse du ventre dans le générique du premier épisode Rajol al Akhtar (L’Homme du Danger), Denizci délaisse le vibraphone et les petites tranches cristallines qu’on imaginait déjà omniprésentes pour verser dans un jazz très « big band et cabaret de second ordre. » Les aventures de l’agent Golden Boy, au carrefour de l’imitation 007 et du hard-boiled vaguement expressionniste, s’y prêtaient assez bien, même si les boucles répétitives à l’excès qui phagocytent la bande-son se mordent très vite la queue. N’est pas Misraki ni Schifrin qui veut…
Quand Tiburon, Delfin et Mojarrita sont dans les parages, la monotonie, a contrario, n’est pas de mise. Les trois espions aux légères déficiences mentales, personnages vedettes du cinéma argentin des seventies, ont fait les zouaves dans une petite dizaine de films usinés pour pas cher. Leur fiévreuse gymnastique verbale et faciale prenant régulièrement le dessus sur des séquences d’action de série Z, les compositeurs affectés à la franchise, dont Victor Proncet et Pocho Leyes, se sont sentis obligés de redoubler à leur tour d’efforts gesticulants. Résultat, une cataracte d’expériences sonores anarchiques inonde l’écran sans nous laisser le temps de reprendre notre respiration. Des hauts-le-corps de l’orchestre s’ingéniant comme il peut à raccrocher les wagons de la vibe funk, du mickey mousing conduit à l’aveuglette et même de La Chevauchée des Walkyries poignardée dans le dos lorsque les trois compères rentrent dans le gras de l’adversité… Il y a vraiment à boire et à manger. Dans Los Superagentes Bionicos, où nos héros sont dotés grâce à la science de pouvoirs bioniques dignes de Steve Austin, les synthés objectivement ridicules de Victor Proncet parviennent même, hasard miraculeux, à se fondre sans occasionner le moindre remouds dans un script idiot qui transforme le nec plus ultra de la technologie en une farce éléphantesque. Rigolotes à l’insu de leur plein gré, ces musiques exhalent une étrange forme de séduction, résolument « autre », qui manque au tout frais Los Superagentes Nueva Generacion, très scolairement appliqué à la besogne (les restes vintage qui ont survécu par endroits se font tanner le cuir par les tables de la loi zimmeriennes du nouveau millénaire) et, fatalement, assez barbant.
D’exemplaire façon, ce dernier score, tout comme le film qu’il accompagne, donne à mesurer l’ampleur du fossé que les ans et les modes fluctuantes ont creusé entre les super-espions d’antan et leurs successeurs contemporains. Quand les uns se révélaient tour à tour sublimes et grotesques, qu’ils louvoyaient au milieu d’essaims de balles avec plus d’agilité sans doute qu’entre les récifs du ridicule, avec des hordes disparates de compositeurs ne les quittant pas d’une semelle, les autres font souvent preuve en comparaison d’un sérieux granitique, même lorsqu’ils s’essaient à fouiller le terreau peu ou prou parodique en dehors duquel les corniauds de 007 n’auraient jamais prospéré. Mais occupés aujourd’hui autant qu’hier à trainer leurs guêtres d’une extrémité du monde à une autre, soyons assurés qu’ils trouveront toujours sur leur route des compositeurs enchantés de fleurir d’une offrande, qu’elle soit délirante et malpolie ou rivée à des rails soigneusement rectilignes, le grand autel bâti à la gloire universelle de Bond, James Bond.