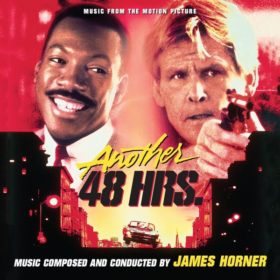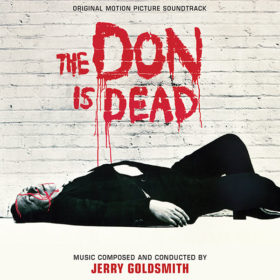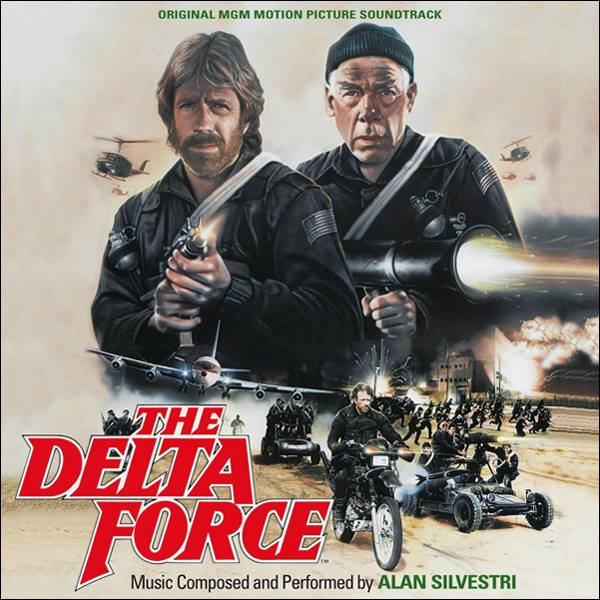#1 – The Shaw Must Go On
#2 – Élégie de la bagarre
#3 – Gun Crazy
Rétrospectivement, les signes avant-coureurs pullulaient — regardez donc Michael Hui. Le déclin du film d’arts martiaux, d’abord essoufflé puis exsangue face à un cinéma contemporain que Hong Kong n’avait jamais connu aussi conquérant, pèse d’une façon ou d’une autre sur sa conscience. L’acariâtre émissaire de la gouaille cantonaise, le grand chambellan des zygomatiques en émoi, bien résolu à hisser la comédie jusqu’à des sphères d’excellence dont les précédents marioles de l’industrie ne caressaient pas même le rêve, vit ses efforts exubérants récompensés par une batelée d’immenses cartons dans les années 70. L’une des clefs de son succès tient sans conteste à son frère Sam, chanteur gentiment pop doté d’une bouille de jeune premier, qui flanqua tous les films de la fratrie Hui de tubes simplets, pour ne pas dire un tantinet bêtas. Ceux-ci tinrent à chaque fois le rôle de socle thématique, à partir duquel on élabora sans grand souci de sophistication des musiques d’une candeur désarmante, comme du Raymond Lefèvre enseveli sous des pousses de soja. Michael Hui s’en contenta largement pour l’essentiel, mais se permit de-ci de-là quelques savoureuses incartades. Témoin le désopilant mano a mano culinaire de son magnum opus, The Private Eyes (Mister Boo, Détective Privé), où un dentier de requin encore prêt à mordre et un chapelet de saucisses reconverti en nunchaku appellent à la rescousse les deux notes carnassières emblématiques de Jaws et le thème bondissant d’Enter The Dragon. Avec la bénédiction des ayants droit ? Tant de candeur, est-ce seulement concevable…
Pas d’erreur, Raymond Chow avait eu le nez creux. Lui, le publiciste dissident de la Shaw Brothers, parti sans demander son reste pour fonder à l’orée des seventies la Golden Harvest, peut se targuer d’avoir assis à quelques années d’intervalle l’irrésistible aura d’un trio de monstres sacrés. Après le météore destructeur du nom de Bruce Lee et avant les classiques champagne de Jackie Chan, il y eut donc Michael Hui, le seul de cette trinité sainte à être resté une attraction foncièrement locale. Idem, à un plus modeste degré, pour son frère Ricky, qui connut sa petite heure de gloire en solo grâce à une brochette de comédies bidendum. Dans From Riches To Rags (Millionnaires d’un Jour), il confronte ses airs d’idiot du village à une bande de sicaires crétins et, accessoirement, au Jerry Goldsmith paroxystique de Star Trek: The Motion Picture. Quand, devenu richissime après avoir joué les chiffres gagnants du loto, il quitte la terne chrysalide de son train-train pour se rouler dans l’opulence, les accents élégiaques de ce chef-d’œuvre de l’infini exaltent s’il en était besoin l’émerveillement du nouveau bourgeois. Plus tard, à la suite d’une maldonne l’ayant convaincu qu’un cancer le ronge jusqu’aux os, la tentation du pathos tout en violons pleureurs se dissout au contact du majestueux thème de l’Enterprise — eurêka ! Des tueurs, grassement rétribués par ses soins, vont se charger de lui épargner les affres de l’agonie. Evidemment, la face lumineuse de Star Trek se volatilise ici. Une fois établi que le funeste diagnostic n’était qu’erroné, notre infortuné rupin se démène comme un diable pour semer ses poursuivants, dont le Blaster Beam caverneux et l’agitation tribale liée aux Klingons tentent coûte que coûte de faire oublier la maladresse chronique. Et derrière la caméra, un certain John Woo, jeune cinéaste à tout faire, de se morfondre en songeant à cet utopique projet de polar, son doux rêve, qu’il ne tournera peut-être jamais…
De la gaudriole hystérique et des vilains d’opérette, on ne risque guère de s’en mettre sous la dent avec The Teahouse et Big Brother Cheng, diptyque criminel qui, de par son énorme succès, pava d’or scintillant la voie maitresse de la décennie suivante. C’était en 1974, un tournant décisif dans la carrière de Charles Bronson qui se laissa séduire par l’idée de jouer au justicier dans la ville. Indéniablement, le bestiaire patibulaire de Hong Kong ne lui aurait pas donné moins de fil à retordre que celui de la Grosse Pomme. A telle enseigne qu’une alliance avec un autre moustachu vengeur, l’impavide Chen Kuan-Tai, eût semblé le meilleur moyen de purger de sa vermine les rues festonnées de barbelés, le tout sur fond d’Herbie Hancock épidermique et ténébreusement jazzy. Rictus abrutis, machettes glissées sous la ceinture et bœuf en fusion où la réverbération, acculée dans le rouge par le risque-tout Mario Migliardi et son concept album Apollo Beat, se morcelle en soupirs d’ectoplasme : les triades font régner la terreur. On ne pense pas qu’à Paul Kersey, les cités à feu et à sang du poliziottesco, qui embrasait alors le box-office transalpin, viennent également à l’esprit. Peut-être ce cousinage sulfureux motiva-t-il la prééminence d’un butin italien sur la bande-son des deux films… Mais plutôt qu’un cinéma policier devenu le royaume de tous les extrêmes, c’est le catalogue personnel des compositeurs de la Botte qu’ils écument en particulier. Outre Migliardi, le Bruno Nicolai fantasque de Dimensioni Sonore, ces disques truffés de cornues de laboratoire associant sa signature à celle de Morricone, décuple à coups de surréalistes gibbosités la malfaisance des truands.
A l’autre bout du spectre, la maison de thé tenue par Chen Kuan-Tai, ultime bastion de la liberté, mute en Éden des temps modernes au contact des minauderies délicieuses de La Conquista di Luna, pur régal lounge qu’inspira apparemment l’astre lunaire à Luciano Michelini. Ce dernier, mélodiste et pianiste émérite, est appelé derechef sur la ligne de front, par le truchement cette fois de son œuvre peu courue pour le cinéma. A l’origine, Anna, quel Particolare Piacere (L’Emprise des Sens) prête sa sensibilité métamorphe à l’éprouvante plongée de la bellissima Edwige Fenech dans les bauges du crime, qu’elle ne soupçonnait pas si interlopes. Jetée par ses ravisseurs chinois dans le chaudron plein de grosses bulles de Hong Kong, cette superbe partition fait tomber sur The Teahouse et sa suite un petit jour mélancolique, aidé par un cor anglais affligé et les vocalises séraphiques d’Edda Dell’Orso. Mais elle fait surtout ruisseler la nuit, au travers d’étourdissants crescendos sur fond desquels les gangsters et les citoyens adeptes de l’auto-défense en décousent sans merci. En même temps qu’une pluie battante de ralentis sauvages, l’apocalypse paraît avoir submergé la ville… Celle-ci, malgré tout, n’avait encore rien vu. Esseulé, marginal, depuis les angles morts où les fours de ses premiers films l’avaient acculé, un jeune homme en colère livra quelques années plus loin Hong Kong à un absolu chaos. Le nom du trublion ? Tsui Hark. Son cocktail Molotov s’intitule Dangerous Encounter Of The First Kind (L’Enfer des Armes), grotesque radioscopie, tétanisante de noirceur, d’une société qu’il percevait alors à son dernier degré de pourrissement. Les bras d’honneur aussi virulents n’ont pas pour coutume de s’encombrer d’une quelconque demi-mesure, et celui-ci n’y déroge pas. Il s’en vante même sans perdre une seconde, transformant un appartement anonyme en une geôle purpurine, secouée par le tonnerre et les éclairs d’un film d’épouvante gothique.
Ce ne sont pourtant pas dans les armoires de Carlo Savina ou Les Baxter, vieux briscards des maisons hantées, que Tsui alla chaparder de quoi mettre en musique son prologue, mais dans cet autre shrapnel dévastateur qu’est Zombie. Les grands esprits, dit-on, se rencontrent à la faveur des dieux, ce que firent par la bande George A. Romero, ici enrôlé via la tonitruante version européenne de son Dawn Of The Dead, et le chien fou que l’on n’avait pas encore honoré du sobriquet de « Spielberg de Hong Kong. » En guise de trait d’union râpeux, le magma sonore éructé par Goblin tire à boulets rouges sur les univers putrescents filmés par les deux cinéastes de l’enfer. Qu’il s’agisse du bipède obnubilé même dans la mort par la consommation à tout crin ou de terroristes en herbe se lavant les mains de la moindre question morale, tout ce petit monde en prend pour son grade. Le rock d’outre-sépulcre vocifèrera ainsi jusqu’au point final, furieusement mis sur les pierres tombales hérissant par centaines un cimetière où presque tous les protagonistes trépasseront la gueule ouverte. Méritaient-ils seulement un sort plus clément ? C’est une spectaculaire brochette de personnages désaxés, irresponsables et franchement crétins que nous offre Dangerous Encouter Of The First Kind, parmi lesquels un gang peinturluré de blousons noirs qui apparaissent comme les ostensibles fac-similés chinois de The Warriors (Les Guerriers de la Nuit) de Walter Hill, citation à l’appui d’un Barry De Vorzon à qui les escarmouches au pas de charge inspirèrent de féroces embardées punk. Mais les mercenaires ne sont pas mal non plus, leurs silhouettes de boogeymen se découpant sur des ténèbres putrides où pulse et bourdonne le lancinant Wunderbar, à la fois pièce maitresse de Wolfgang Riechmann et (la faute à une rencontre fatale en pleine rue) legs unique qu’il céda à la scène électronique des seventies.
De sacrés malandrins, ces soudards ! Qui n’hésitent pas à recourir aux tortures les plus raffinées pour parvenir à leurs fins. Le Blaster Beam et l’ambiance enivrée de magie noire de Star Trek grincent d’ailleurs à nouveau, inexorablement aimantés par tant de délicatesse… Il n’empêche que la figure la plus corruptrice du film, l’œil insondable du cyclone déclenché par Tsui Hark, reste la jeune sœur du flic déboussolé que joue le toujours omniprésent Lo Lieh. C’est dans sa frêle personne que se concentrent les turpitudes brutales du Amityville Horror (Amityville : la Maison du Diable) de Lalo Schifrin, derrière la glace sans aucune lézarde de son visage que mijotent d’inquiétants bois arrachés au Gator de Charles Bernstein entre deux frappes groovy. Le côté obscur de The Empire Strikes Back couve même au fond de ses yeux cruels, quelques notes rogues en droite provenance du sinistre conciliabule que tiennent l’Empereur et son âme damnée Darth Vader. Par le truchement de ces émanations musicales maléfiques, un profil psychologique qu’on qualifiera prudemment de difficile prend forme biscornue. Telle une Marianne des enfers, la jeune fille étourdit hargneusement de ses harangues trois adolescents ayant perdu le nord. Avec, en point de mire, un seul objectif : réduire en cendres l’infecte souricière à laquelle se résume Hong Kong. Pour un peu, on croirait surgie d’un tout autre espace-temps cinématographique cette poignée de séquences sises dans un appartement cossu, où des bourgeois toujours endimanchés vaquent à leurs paisibles occupations au son gracieux, et quelque peu lénifiant, de la valse ciselée par Pierre Bachelet pour nacrer l’érotisme BCBG d’Histoire d’O.
S’il fit parler de lui à grand bruit, y compris par ses démêlés avec la censure qui avait juré sa perte, Dangerous Encounter Of The First Kind n’aurait guère dû entrainer de commentaires quant à sa musique de bric et de broc. Après tout, combien d’aigrefins que les scrupules ne garrottaient point, leurs poches remplies de partitions volées à l’étalage, l’avaient-ils précédé sans provoquer nul esclandre ? Mais le fait est qu’on en parla. L’omniprésence des chevelus frondeurs de Goblin, en particulier, intrigua et parfois même offusqua plus d’une oreille. Ce fut pour le cinéma hongkongais le revers de la médaille, la rançon de son succès sans cesse croissant auprès de l’Occident stupéfait. Oh certes, les regards braqués en nombre sur lui ne le convainquirent pas du jour au lendemain de filer droit. Il s’en faut de beaucoup ! Mais au commencement des eighties, les jours du brigandage à grande échelle étaient comptés. L’on s’en persuadera en restant avec Tsui Hark, non plus cette fois le réalisateur crépitant d’électricité statique mais le comédien prêt à sortir de ses gonds. Armé de sa barbiche et de sa carcasse efflanquée que moule une seyante salopette, il alimente généreusement la portion comique de Yes, Madam (Le Sens du Devoir 2), matrice ultra-nerveuse du girls with guns — l’appellation parle d’elle-même. Tandis que Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock, sublimes impératrices du polar martial, s’affairent à déchausser les molaires de hordes de gouapes, Tsui, pas franchement de taille à donner le coup de poing, tourne en bourrique un trio d’imbéciles grimaçants. La musique n’est pas la dernière à s’en amuser, dégainant durant cet ubuesque chassé-croisé les synthés froids comme la banquise d’Halloween. Contrepoids ironique garanti ! John Carpenter reste cependant le seul otage d’un film ayant pris soin de se munir d’une bande vraiment originale, quoique celle-ci, grossièrement taillée dans un épais bloc de polyester, ne capture pas le profil le plus flatteur d’un Romeo Diaz qu’on connut moins je-m’en-foutiste ailleurs.
Après cette plaisante récréation, Tsui Hark se hâta de tomber la salopette pour revêtir à nouveau ses habits d’or. Ceux de cinéaste, qui ne nous intéressent pas ici outre mesure puisqu’il venait d’ouvrir avec le talentueux musicien James Wong une collaboration de choix, certifiée sans aucun additif (ou presque) de souche frauduleuse ; et ceux de producteur, homme avisé dont le flair lui intima de sauver son ami John Woo du purgatoire des comédies hippopotamesques. Et c’est ainsi qu’en 1986, A Better Tomorrow (Le Syndicat du Crime), non content de ne faire qu’une bouchée des records de recettes à Hong Kong, couronna nouveau roi de l’industrie le polar sanglant, ou heroic bloodshed, comme il fut baptisé ultérieurement. Ce vieux briscard de Joseph Koo gratifia bien les gangsters chevaleresques du film d’une musique inégale, avec, pour le meilleur, un harmonica triste et fluet, porte-drapeau des lendemains qui se refusent à être meilleurs. Mais rien n’y fit : nostalgique sans doute des wu xia pian de Chang Cheh, dont il fut soit dit au passage l’assistant le temps d’une poignée de classiques rouge sang, John Woo transposa dans un cadre contemporain ses héros incorruptibles… et ses petites attrapes musicales. La fameuse séquence des pots de fleurs, morceau d’anthologie s’il en est, fait main basse sur Birdy de Peter Gabriel, qui lui-même recyclait déjà, sous des oripeaux moins agressivement rock, l’un des highlights du troisième album solo dudit Gabriel. Chow Yun-Fat, victime d’un pied-de-nez railleur, et surtout d’une paire de balles ayant transpercé sa jambe, se retrouve dans cette scène plus bas que terre, à l’inverse d’un Matthew Modine muet d’extase à qui l’essor paroxystique de Gabriel donnait les ailes tant rêvées. Celles qui le propulseraient haut, très loin de la banlieue pareille à un furoncle hideux de Philadelphie.
Durant les années 70, Brian Eno mit sur pied un album très prosaïquement intitulé Music For Films, bien qu’il ne fût pas conçu à l’usage du cinéma, mais seulement pour les films que le maître zen aimait à se faire de toutes pièces dans sa tête. Toutefois, il se trouva par la suite quelques producteurs ou compositeurs plus ou moins margoulins pour estimer qu’une telle matière musicale se languissait forcément d’un réceptacle de pellicule. C’est donc en sauveur potentiel que se pose A Better Tomorrow qui, au cœur d’un conflit fratricide voué à la tragédie, insère au forceps de cérémoniels accords de piano dont les fioritures électroniques évoquent à grand-peine un orgue de pacotille. Irréfutablement, les opulentes partitions orchestrales au buffet desquelles le tout-Hong Kong se servit à satiété pendant les seventies n’étaient plus au goût du jour — un phénomène qui ne fit que s’accentuer avec A Better Tomorrow 2 (Le Syndicat du Crime 2). « Bigger and louder », tels sont les mots d’ordre de cette suite inévitable, qui profite des coups de flingue s’amoncelant frénétiquement pour passer au crible le son musclé du Hollywood des temps nouveaux. Les synthés aussi ringues qu’efficaces de No Mercy (Sans Pitié) d’Alan Silvestri, ponctionnés au hasard d’une bobine, feraient des ambassadeurs convaincants à l’intérieur d’un ensemble pas si hétéroclite que ça, d’où ne saille avec la vigueur des hauts contrastes que le bon sourire de Jeff Bridges dans Starman. Bien sûr, nous n’avons pas affaire au très joli thème doré par Jack Nitzsche, une fois n’est pas coutume en veine de romantisme, mais plutôt à l’une de ses laborieuses caricatures « carpenteriennes » visant à gonfler le suspense un brin. Bref, le genre de compagnon trapu à cent lieues de déparer parmi les virils épanchements électroniques d’Extreme Prejudice, western moderne et teigneux de Jerry Goldsmith, et du 52 Pick-Up (Paiement Cash) d’un Gary Chang débutant mais déjà appâté par les lourds effluves de la série B qui tabasse.
Il serait mortifiant d’injustice de ne pas citer la contribution tricolore à cet édifice scélérat. Gageons que son désir névrotique de tutoyer l’efficacité à l’américaine aura accordé à Parole de Flic l’insigne honneur d’être ainsi vandalisé. L’admiration commune que John Woo et sa méga-star Chow Yun-Fat vouent à Delon n’y fut peut-être pas non plus pour rien… Voici donc le synclavier pop-rock de Pino Marchese téléporté à Hong Kong, cet ailleurs stylisé au-delà de l’entendement où, miracle des vases communicants, ses effets frustes s’épanouissent bien mieux qu’ils ne le faisaient au contact d’un Delon narcissique et presque bodybuildé. Ce n’est évidemment pas cette triste rognure de l’acteur qui fut la muse de Woo lors du tournage de The Killer, deux ans après, mais la figure au hiératisme superbe du Samouraï. Au firmament de sa gloire, le bel Alain jouait un tueur à gages sans plus d’attaches qu’un spectre, un être maudit dont Chow Yun-Fat incarne, dans ce qui demeure le film le plus emblématique de Woo, un parent habité par la même mélancolie. Les génuflexions ferventes à l’égard du classique livide de Jean-Pierre Melville ont cependant leurs limites : pas de François de Roubaix au programme d’une bande-son comme il se doit disparate, non, rien qu’un autre panorama empestant la cordite du cinéma d’action américain — au sein duquel s’est glissé un intrus de taille : l’ouverture du célébrissime Messiah de Haendel. Le maître allemand, même tout éberlué d’avoir été parachuté en terra incognita, se voit épargner les affres d’un trop rude dépaysement parmi les myriades de cierges baignant de leur lueur flavescente une petite église, théâtre écarlate de l’extraordinaire séquence finale.
Au milieu de ce qui ressemblerait presque à un troc et puces, deux citations éhontées apostrophent davantage que leurs consœurs. Bien plus qu’au pauvre Lowell Lo, compositeur « officiel » mais à peine moins insignifiant qu’un astérisque en bas de page (à deux ou trois exceptions près, l’on pourrait circonscrire la part des musiques originales de The Killer aux séduisantes vocalises de Sally Yeh), elles sont à mettre au crédit de David Wu. Monteur de génie, le gaillard se tient tapi derrière un nombre impressionnant de réussites du cinéma hongkongais à son summum. Il confesse volontiers que sa science frénétique du découpage est redevable pour beaucoup à la musique, sa muse de toujours, son égérie prodigue des meilleurs conseils, toujours la bienvenue dans son antre de travail. Un chassé-croisé virtuose dans le terminal d’un aéroport lui donne on ne peut plus raison, tant les accords en suspens de Hero And The Terror (Héros), l’œuvre d’un David Michael Frank étonnamment inspiré par les bacchantes vaillantes de Chuck Norris, épousent avec un naturel exempt du moindre cahot les ralentis chorégraphiques sculptés par John Woo. Constat analogue pour ce bijou qu’est l’exécution d’un contrat sur les eaux de Victoria Harbour. Le Red Heat (Double Détente) mal embouché de James Horner, séparé d’un Walter Hill démissionnaire le temps d’une valse folle avec les excès baroques de Hong Kong, se gonfle ici d’une véritable puissance dramatique, qui pare d’un lustre inédit ses féroces emportements électro-acoustiques. Son géniteur himself ne lui soupçonnait à coup sûr aucunement pareil potentiel, en tout cas pas en n’ayant eu à se mettre sous la dent que les images sans relief d’un Schwarzy coiffé d’une ouchanka dodue et serrant les mâchoires comme à l’accoutumée.
A l’aube des années 90, le cinéma de Hong Kong avait atteint son apex. Le star system fonctionnait à plein rendement, le patrimoine des genres, son noyau primordial, étincelait de vitalité (et préparait même le retour flamboyant du film d’arts martiaux), les salles obscures ne désemplissaient pas, les cascadeurs trompe-la-mort ne connaissaient pas la crise… Les compositeurs, en fin de compte, étaient bien parmi les seuls à faire la soupe à la grimace. Assez paradoxalement, pourrait-on avancer, après qu’ils eussent été mis sur la touche durant tant d’années, éclipsés par l’invraisemblable bric-à-brac de bandes (absolument pas) originales aux mille ligatures. Mais ils n’avaient cessé de tenir lieu de vulgaires prête-noms que pour pâtir de conditions de travail en-dessous de tout. Bontempi souffreteux et formules mangées de calcaire étaient (et sont toujours aujourd’hui, du reste) leur lot commun, qu’ils honoraient sans panache ni enthousiasme. Il arrivait encore, par-ci par-là, qu’un morceau choisi s’insinuât entre les mailles du filet, comme par exemple à l’occasion du troisième A Better Tomorrow, refusé en bloc par John Woo mais aussitôt repris en main par Tsui Hark — entre les deux anciens amis, le torchon brûlait. A nouveau, le film va chercher sa pitance dans les borborygmes électroniques devenus à l’époque monnaie courante, plus précisément ceux du petit polar Off Limits (Saigon, l’Enfer pour Deux Flics), emballé tant bien que mal par un James Newton Howard qui avait encore tout à prouver. Et pourtant, prodige des réactions chimiques que Hong Kong porta tant de fois à ébullition ! Anita Mui, sublime et farouche, sort un peu plus encore grandie de sa rencontre avec ces scintillements de synthèse, qui parachèvent de faire d’elle la véritable héroïne de ce troisième chapitre. Chow Yun-Fat lui-même, l’éther d’A Better Tomorrow, sa charismatique essence, ne peut que s’incliner. Avec évidemment une stupeur ravie glissant sur son sourire de petite crapule.
Toute chose a une fin — « sauf la guerre », croit bon de préciser le fou furieux Anthony Wong dans Hard-Boiled (À Toute Épreuve). John Woo était alors sur le point de faire ses valises, direction Hollywood, où il croiserait la route de James Horner, Graeme Revell, John Powell ou bien Hans Zimmer himself. Avant de s’envoler loin de Hong Kong devenu trop exigu pour sa colossale stature, il légua à sa ville tant aimée un hallucinant chant du cygne, un monument d’action pyrotechnique… doublé d’une petite revanche : les appétences du cinéaste pour le jazz, qu’avaient frustrées les producteurs de The Killer, s’étalent cette fois au grand jour sous la houlette de l’homme-orchestre Michael Gibbs. Tantôt bleuissant l’âme d’ecchymoses languides, tantôt saisi d’une dantesque fureur, le saxophone passe par tous ses états. Mais le voici tout à coup qui disparait des radars lorsque la caméra s’engouffre durant un plan-séquence d’anthologie dans les couloirs d’un hôpital à feu et à sang. Une touffeur collante paraît empoicrer le spectacle de l’ultra-violence, et des réminiscences fugaces se succèdent sous nos yeux écarquillés, coiffant de souples dreadlocks les gunmen expédiés les uns après les autres ad patres. Au sein du pandémonium à couper le souffle déchaîné par Woo, les sifflements inquiétants du « hose-oon », trésor d’artisanat chipé au Predator 2 d’Alan Silvestri, produisent assurément leur petit effet.
Ce fut la dernière fois que le réalisateur, passant en revue les bacs fournis des disquaires de la planète, se permit d’avoir les mains baladeuses. Il n’y avait de toute manière plus grand-monde dans le cinéma de Hong Kong pour s’enhardir à ce type de larcin. Une récidive bien velléitaire, vulgaire flammèche vite mouchée, brasillait encore parfois, comme dans le cas de la trépidante série noire The Longest Nite. Cette production Milkyway chapeautée (d’aucuns insinueraient plutôt entièrement réalisée) par Johnnie To, à qui l’avènement du nouveau millénaire réservait une unanimité critique flambant neuve, fait en effet coulisser et s’emboîter ses engrenages fatals au rythme quasi-ininterrompu des synthés de Midnight Express. Du thème fameux de Moroder, seriné au point de s’entortiller sur lui-même tel un ruban de Möbius, nait un sentiment pulsatif d’urgence qui pousse le flic ripoux à courir aux quatre coins de Macao, en un vain effort pour raccrocher les wagons d’une intrigue retorse. La rétrocession sonna le glas d’une époque, dont le béophile baroudeur ne peut se souvenir sans qu’une poignante nostalgie n’étreigne son cœur. Celle d’une faune hongkongaise hirsute et foisonnante de pique-assiette, un gouleyant cimetière de la morale où les basses manœuvres musicales, après avoir longtemps fait florès, s’abîmèrent finalement par la faute d’une poussée suspecte de déontologie — pour ne plus jamais revenir.