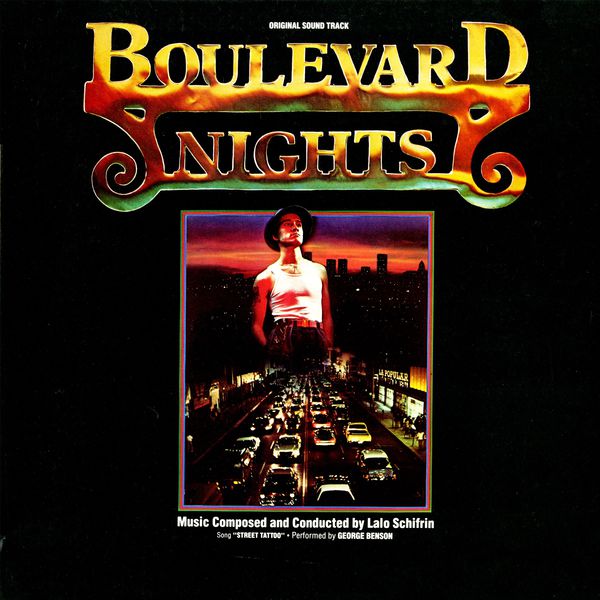Ils s’appellent Derek Flint, Francis Coplan, Hubert Bonisseur de La Bath, Dick Malloy. Les besoins de leur profession les ont affublés de matricules ésotériques comme A-S 3, OSS 117 ou X 1-7. Ils portent (plus ou moins) avantageusement le smoking, déambulent dans des décors tout droit issus d’une brochure touristique, et ni les menaces proférées par quelque génie du mal au petit pied, ni les jambes gainées de noir qu’exhibent de lascives gourgandines ayant juré leur perte, ne peuvent égratigner leur flegmatique réserve. Bien entendu, toute ressemblance avec James Bond ne saurait être que fortuite…
 #1 – (Une) opération (du) tonnerre
#1 – (Une) opération (du) tonnerre
#2 – Bons baisers d’Umiliani
#3 – Dupliquer n’est pas jouer
#4 – Au service secret de l’Élysée
#5 – Les clones ne meurent jamais
#6 – Lalo Royal
#7 – Spyfall
#8 – Le monde ne leur suffit pas
Prononcez à haute voix le nom de Lalo Schifrin, ami cinéphile au long cours, puis piochez dans vos souvenirs comme vous le feriez à l’intérieur d’un bocal de confiseries. Rapidement, se dessineront sous vos yeux bien des âges du système hollywoodien, fertiles ou déliquescents, et bon nombre des silhouettes fameuses l’ayant peuplé : Steve McQueen battant les cartes avec dextérité ou arrachant de virils grondements au moteur de sa Ford Mustang, la gueule béante d’un .44 Magnum derrière lequel flotte l’impénétrable rictus de Clint Eastwood, le cauchemar futuriste glacé où Robert Duvall se tord tel un ver à l’hameçon, Jackie Chan faisant le pitre aux côtés du moulin à paroles Chris Tucker… Autant de preuves, assorties de beaucoup d’autres encore, de l’immense versatilité du compositeur argentin. Par contre, les chances sont maigres qu’à cette clique prestigieuse viennent s’ajouter deux ou trois espions en smoking et chaussures vernissées. Si les James Bond de foire avaient été l’une des spécialités de Schifrin, cela devrait se savoir, non ? Enter The Dragon (Opération Dragon), à la rigueur, pourrait être repêché grâce à son mystérieux décor insulaire, bourré de portes dérobées et de passages souterrains, que régente d’une main de fer (c’est le cas de le dire) un méchant dont la mégalomanie suave n’aurait pas dépareillé dans l’univers de 007. Et Schifrin, en mode tout-terrain une nouvelle fois, d’accommoder les cuivres explosifs liés aux mortelles cabrioles du grand Bruce Lee d’un contingent de percussions insolites et de bois lourds de danger.
Qu’on se le dise toutefois, ce titre-là n’a rien d’un essai solitaire. En vérité, dans les années 60, le compositeur s’était ouvert précocement aux règles remaniées de fond en comble du cinéma d’espionnage, tant et si bien qu’il reste l’un des plus généreux mécènes de la « Bondmania. » Henry Mancini lui-même, seigneur et maître incontesté des swinging sixties, ne peut réellement rivaliser avec une telle prolixité malgré deux tentatives mémorables : Charade, qu’il fait galoper ventre à terre sur fond de ces fameux ostinati voisins du mambo, et Arabesque, où les entêtantes volutes du romantisme qui lui est si cher n’empêchent pas le suspense de se tordre dans d’impressionnantes convulsions. Ceci étant, au contraire de Mancini qui faisait là équipe avec Stanley Donen, Schifrin n’a pas eu la chance de mettre son génie au service de grands cinéastes, de ceux capables à l’époque de fédérer autour de leur seul nom un aréopage de fortes personnalités artistiques. D’où l’incognito plus ou moins prononcé des scores engendrés par ses régulières poussées d’espionnite.
Parmi les mieux lotis d’entre eux durant les sixties se trouve The Liquidator (Le Liquidateur), non pas grâce à la prestation à contre-emploi du regretté Rod Taylor en quidam froussard happé dans de rocambolesques engrenages, mais plutôt par la seule bienfaisance vocale de Shirley Bassey, dont les plus dégourdis eurent vite fait de remarquer qu’elle s’époumonait dans un registre aussi explosif que celui de Goldfinger deux ans auparavant. La musique qui flanque ses lyrics n’est pas en reste, piquant son entêtant tic-tac de brusques crescendos de cuivres. Mais Schifrin l’iconoclaste ne pouvait décemment se satisfaire d’un pastiche trop carré de John Barry, et bifurque chaque fois qu’il le peut (comprendre souvent) vers tout ce que les années 60 comportaient d’aveuglantes bariolures. Quitte à délaisser un tantinet son très accrocheur thème principal pour flirter à intervalles réguliers avec la source music.
A l’instar de pléthore d’autres vedettes du petit écran, Robert Vaughn et David McCallum, le tandem gagnant de The Man From U.N.C.L.E., n’ont pas exactement rencontré le même succès en tentant l’aventure au cinéma. Les deux polissons pensaient pourtant avoir mis toutes les chances de leur côté en restant fidèles aux cartes postales hérissées de flingues qui les avaient catapultés au firmament. Dans cette ambitieuse opération Xerox, ils ont d’ailleurs croisé à nouveau le chemin d’un des piliers musicaux de la série, Lalo Schifrin en personne. Face au duel à mort opposant Vaughn au savant fou de The Venetian Affair (Minuit sur le Grand Canal), coupable entre autres ignominies d’avoir transformé un sommet pour la paix en bain de sang, le compositeur imagine l’une des partitions les moins « caractéristiques » qu’on ait jamais fournies aux 007 de tout poil. Majoritairement conçue pour un ensemble sous pression d’instruments à cordes, rarement très aimable, elle cumule les sonorités aiguisées comme un rasoir et scintillant de l’éclat froid du saphir. S’en détache, en particulier, une très intrigante cithare, à laquelle ni les personnages stéréotypés du récit, ni la cité des Doges elle-même, cadre ensoleillé par excellence, ne paraissaient destinés.
Au contraire, Sol Madrid (Les Corrupteurs) dispense chaleur et guirlandes festonnées à profusion. Rien qu’à tendre l’oreille, on débarrasserait volontiers David McCallum de son costume sombre pour l’empêtrer dans les lourds replis d’un poncho, tant les timbres extrêmement vifs du score courent en parallèle avec le western zapata. Ennio Morricone, le très doué compatriote de Schifrin, Luis Bacalov, ou même le Maurice Jarre de Villa Rides (Pancho Villa), étaient à l’époque les bâtons de dynamite qui embrasaient les joyeuses révolutions inhérentes au genre. Fort de sa sensibilité latine incluant guitare mélancolique au coin du feu et charges exubérantes (et aussi, ne les oublions pas, quelques éclats davantage dans l’air du temps), Sol Madrid parait prêt à enflammer la mèche avec une insouciance identique. Quelques années plus tard, Claude Bolling, consciemment ou non, saura régler son pas sur celui des maestros précités en donnant vie à l’univers farfelu du Magnifique.
Si le spectacle à tout prix et la poudre de perlimpinpin avaient été ses obsessions majeures, le présent article aurait pu (dû ?) démarrer sur les chapeaux de roue en se frottant à une œuvre fondamentale. Car dans la carrière bien remplie de Schifrin, qui dit espionnage dit en première instance Mission: Impossible. Carte du globe piquée d’une multitude de croix rouges, science du déguisement digne du transformiste Fregoli et gadgets dernier cri, tous les ingrédients du parfait 007 semblaient s’être donné rendez-vous au service de Jim Phelps. Mais en 1966, la série prenait soin de développer un ton bien à elle, splendidement indifférent aux héros hédonistes et endimanchés grouillant alors par centaines, ni vraiment annonciateur de la recrudescence proche des intrigues paranoïaques et du double jeu aux motifs opaques.
Il faudra attendre jusqu’à l’été 2000 pour que Tom Cruise, super athlète propulsé en apesanteur par les ralentis musclés de John Woo, « jamesbondise » définitivement sur les écrans de cinéma un concept somme toute plus cérébral que spectaculaire. Hans Zimmer, au passage, s’en donnera à cœur joie, cinglant cet M:I-2 d’épaisses rafales rock dans l’espoir de rajeunir le mythe. Inutile de préciser que l’inoubliable Main Title de Schifrin et ses marches de suspense (le grand classique The Plot) sont ressortis broyés d’entre les mâchoires d’un score excessivement peu subtil, que l’omnipotent gourou de Remote Control n’a carrossé qu’à la diable.
Devenu un hit instantané, Mission: Impossible a beaucoup fait pour la starisation de son compositeur. Au moins autant qu’un autre morceau d’anthologie, Dirty Harry, issu de l’esprit en plein ébullition de l’heureux homme lors des seventies naissantes. Confronté à Clint le Charognard, inflexible incarnation de la Loi dont il est l’exact contemporain, quelle chance Mrs. Pollifax – Spy avait-il de briller ? Pour dire, même les admirateurs patentés du grand Lalo ne sont pas du genre à perdre le boire et le manger à la seule mention de ce score toujours inédit. Et pourtant, avec cette adaptation des romans de Dorothy Gilman, où une vieille dame lunatique fait tourner en bourrique les agents secrets du monde entier, on voit mal Schifrin s’être contenté d’égrainer les gimmicks musicaux les plus rebattus de la spyploitation.
Du coup, pourquoi ne pas imaginer la chose comme un dérivé malicieux de, par exemple, The President’s Analyst (La Folle mission du Docteur Schaeffer) ? Non pas que James Coburn, qui aura capitalisé sans retenue sur sa très mâle coolitude durant les sixties, puisse être comparé de quelque façon à notre vénérable redresseuse de torts. Mais dans cette comédie d’espionnage dont il tient la vedette, la musique s’amuse en permanence à jouer le balancier entre d’éclatantes scansions de cuivres, au premier degré plus qu’évident, et les coups de coude complices de la guitare électrique et du piano, qui ont déclaré la guerre à toute velléité dramatique. L’approche est casse-gueule, mais dosée avec art et méthode. D’ailleurs, quand il s’essaiera de nouveau au genre en 1980, après de nombreuses années passées loin des résidus de fausse couche de 007, Schifrin, sûr de son instinct, fera encore se télescoper humour cabochard et tension brûlante.
Il faut dire que le sujet s’y prêtait merveilleusement : The Nude Bomb (Le Plus Secret des Agents Secrets), premier portage dans les salles obscures de la folle sitcom Get Smart (Max la Menace), met entre les mains de la mégalomaniaque organisation KAOS une arme terrible, capable… de désintégrer les vêtements à n’importe quel endroit de la planète ! On le voit, l’heure est critique. Raison de plus pour s’amuser, et Schifrin n’a nul besoin qu’on le lui dise deux fois. Avec l’aide de Don Black et de la chanteuse Merry Clayton, il conclue son ironique labeur par une déflagration disco qui fait rétrospectivement figure d’adieu aux tempétueuses seventies.
Même, cet au revoir-là pourrait s’étendre à tout le cinéma d’espionnage groovy, les ultimes randonnées du compositeur sur ce terrain l’ayant plutôt conduit vers des films sérieux, un peu dans la lignée du curieux Telefon (Un Espion de Trop) qui réunissait en 1977 les durs à cuire Don Siegel et Charles Bronson. The Fourth Protocol (Le Quatrième Protocole), avec Michael Caine dans son 397ème rôle d’agent secret à qui on ne la raconte pas, et The Osterman Weekend, l’œuvre testament de Sam Peckinpah, avancent donc sans le moindre alibi parodique en bandoulière, même si le premier ne manque pas de flonflons fanfaresques (assez réjouissants, d’ailleurs) et que le second s’adonne à des pulsions pop qui ne resteront pas comme ce que Schifrin a jamais écrit de plus foudroyant.
La liste s’achèverait là si n’avait eu lieu en 2004 la rencontre inopinée entre l’Argentin septuagénaire, parvenu au couchant de sa carrière, et l’industrie du jeu vidéo. Sous sa combinaison de cuir moulant, Sam Fisher, le vieux briscard de la série Splinter Cell, n’a évidemment rien de l’élégance surannée des duplicatas de James Bond. Mais pour se fondre dans l’ombre, il dispose d’une panoplie de gadgets, tout à fait orthodoxes pour la plupart, et d’autres pour le moins excentriques, qui rendraient écarlate de jalousie ce brave Q. Le thème concocté par Schifrin pour l’épisode Pandora Tomorrow exhale cependant les odeurs d’un autre temps, absolument délicieuses et investies d’un capital nostalgie certain, mais dont l’anachronisme était voué à mortifier les gamers affamés de péripéties high-tech. Qu’à cela ne tienne, le zélé Jack Wall s’est occupé de soumettre ces cordes incisives et ces cuivres féroces (par instants, on croirait presque entendre le John Williams vintage des films catastrophes) aux vicissitudes du scoring moderne, symbolisées ici par un déluge d’électro. Force est de constater que le bougre a rempli victorieusement son office en balafrant la patte Lalo Schifrin, jusqu’à la rendre méconnaissable. Un bien terne chant du cygne pour celui qui fit voir de toutes les couleurs aux espions en goguette du cinéma américain.