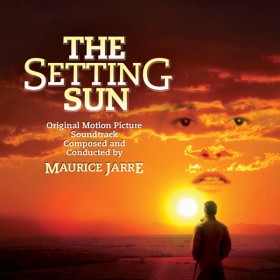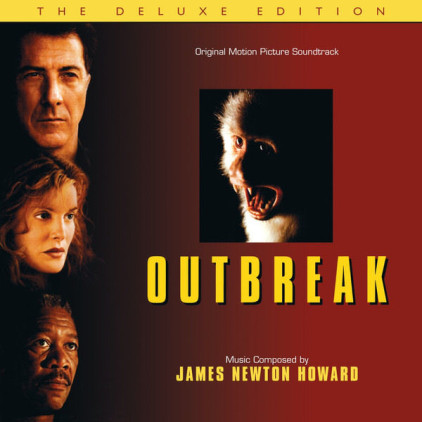Ils s’appellent Derek Flint, Francis Coplan, Hubert Bonisseur de La Bath, Dick Malloy. Les besoins de leur profession les ont affublés de matricules ésotériques comme A-S 3, OSS 117 ou X 1-7. Ils portent (plus ou moins) avantageusement le smoking, déambulent dans des décors tout droit issus d’une brochure touristique, et ni les menaces proférées par quelque génie du mal au petit pied, ni les jambes gainées de noir qu’exhibent de lascives gourgandines ayant juré leur perte, ne peuvent égratigner leur flegmatique réserve. Bien entendu, toute ressemblance avec James Bond ne saurait être que fortuite…
 #1 – (Une) opération (du) tonnerre
#1 – (Une) opération (du) tonnerre
#2 – Bons baisers d’Umiliani
#3 – Dupliquer n’est pas jouer
#4 – Au service secret de l’Élysée
#5 – Les clones ne meurent jamais
#6 – Lalo Royal
#7 – Spyfall
#8 – Le monde ne leur suffit pas
N’allons pas molester la réalité. Bien qu’incontestable pépinière des espions glamour, les années 60 ont toléré de-ci de-là quelques incartades à l’ambre clapotante des verres de martini, aux robes du soir sculptant les accortes traitresses et à tout ce qui constituait le décorum des nouveaux barbouzes. Voyez plutôt Harry Palmer. Avec son imperméable fané et ses lunettes d’aspect sévère, derrière laquelle les yeux de Michael Caine brillent d’un éclat dur et froid que même l’élégant jazz de John Barry est impuissant à adoucir, il a tout l’air d’un petit fonctionnaire sans états d’âme. Il n’empêche que son apparent bras d’honneur à la folie pop de l’époque a fini par se retourner contre lui. Funeral In Berlin (Mes Funérailles à Berlin), le second épisode de ses aventures, a beau récupérer l’urbanisme dépressif de The Icpress File (Icpress, Danger Immédiat), quelque chose, déjà, semble s’être rompu. Le sérieux ostensiblement affiché se lézarde en maints endroits, laissant notamment s’infiltrer de bien réjouissants tortillons de la musique de Konrad Elfers. S’il l’avait voulu, le thème principal, très flexible, aurait pu suggérer une atmosphère zébrée de tension larvée, mais souvent apprêté avec une bonne dose de second degré, il se complait surtout dans les fantasmes d’un espionnage groovy. Lequel prend les commandes pour de bon lors d’un Billion Dollar Brain (Un Cerveau d’un Milliard de Dollars) contaminé dans ses moindres recoins par le délirant anarchisme de Ken Russell. En parfait gentleman tirant orgueil de son flegme tout britannique, Richard Rodney Bennett s’emploie à suturer les morceaux épars d’un script loufdingue grâce à son écriture musicale rigoureuse, tantôt noire et claironnante, tantôt empreinte de l’élégance d’un piano martelant aristocratiquement ses accords.
Impossible de lui échapper. James Bond était partout ! Le constat, limpide, eut tôt fait d’asséner un coup terrible aux bonnes vieilles Cold War Stories pleines d’agents paranoïaques. Et pendant que leurs ultimes partisans, tel l’excellent cinéaste John Frankenheimer, s’échinaient envers et contre tout à faire brûler la flamme, tous les autres bricolaient, la plupart du temps dans la précipitation, des histoires tarabiscotées d’espions tirés à quatre épingles et de savants fous complotant pour la domination du monde. Les rois du cartoon eux-mêmes, Chuck Jones, Hanna Barbera et consort, qui n’étaient pas à une parodie près, ont rapidement invité leurs héros de celluloïd au banquet. Mais ni Jerry, engoncé dans un trench-coat cousu de gadgets et affrontant le mégalomane Tom dans The Mouse From H.U.N.G.E.R., ni Vil Coyote épuisant toutes les ressources de sa panoplie d’espion pour tenter d’enfin mettre la patte sur le Road Runner dans Sugar And Spies, n’ont su convaincre les Dean Elliott et William Lava de renoncer au confort douillet du mickey-mousing. Composée à huit mains, la musique du long métrage The Man Called Flintstone (L’Agent Pierrafeu 007) fait cependant montre d’un soupçon d’ambition entre deux chansons lénifiantes. Le générique notamment, où Fred est transformé en James Bond des temps préhistoriques, file bon train grâce à quelques couplets bourrés de vitamines.
Il n’existe pas de pires contrefaçons, peut-on estimer, que celles émanant du fabriquant en personne. Non pas que le clan Broccoli, détenteur éternel des aventures de 007, ait financé dans l’ombre une poignée d’avatars officieux du personnage. Mais par deux fois, conséquences de procès à rallonge et d’imbroglios juridiques qu’il serait fastidieux de vouloir disséquer ici, le super espion leur a échappé pour s’en aller baguenauder dans des films comptant parmi les moins aimés de la série. Le ton sacrément camp de Casino Royale en 1967 et la vision d’un Sean Connery en survêtement, tout encroûté de calcaire dans Never Say Never Again (Jamais Plus Jamais) seize ans plus tard, ne sont pas étrangers à une telle inimitié. Sans oublier la défection derrière le pupitre de John Barry, qui s’accompagne, pire encore, de celle du leitmotiv mythique de Monty Norman. Pour ça, et pour une sereine indifférence au joug des modes qu’il partage avec son amphitryon de pellicule Jacques Demy, Michel Legrand a été cloué au pilori. Auprès du public de 1983, qui peinait à se souvenir que les swinging sixties avaient existé un jour, les mélodies rondes et feutrées qui représentent l’essentiel de sa partition étaient condamnées à essuyer des bordées de lazzis. Sans doute aurait-on fait grâce au compositeur de ces rebuffades s’il avait pu être à pied d’œuvre sur Casino Royale, énorme gloubiboulga où les kyrielles de stars qui s’y croisent ne donnent pas toujours l’impression de savoir ce que diable elles fabriquent ici. Sans l’intervention d’un Monsieur Loyal bienveillant, en l’occurrence Burt Bacharach, qui dévide comme fil rouge salvateur sa capiteuse chanson phare The Look Of Love, cette invraisemblable ménagerie eût aussi bien pu s’effondrer sous le poids de tant d’égos au mètre carré.
A l’image de ces deux volets alternatifs, parqués depuis lors dans la léproserie de l’empire Bond pour crime de lèse-majesté, ou d’une Cinecittà fertile en héros récurrents, certains combinards anglo-saxons ont essayé de pérenniser leur propre franchise. A l’arrivée, on les a rarement vus dépasser le stade du premier épisode. Reclus au fin fond de la campagne anglaise, hors de portée des vils producteurs qui cherchaient à brider son génie, l’auto-satisfait Lindsay Shonteff surpasse, sinon en talent, du moins en pugnacité, ses collègues enclins à jeter trop vite l’éponge. Son personnage fétiche, Charles Vine, devenu par la suite Charles Bind, qui camoufle sous la préciosité de son verbe un esprit incurablement beauf, peut se vanter d’une belle longévité courant de 1965 jusqu’au début des années 90. Amoureux transi du Mauser et des paires de .357 Magnum qu’il fait tournoyer comme un pistolero de foire, notre homme semble s’être extirpé d’un western de basse souche. Un sentiment jamais entériné par la musique, qui aura vu se succéder au fil des ans bien des compositeurs paisiblement scrupuleux, véritables yes men très dociles face aux us et coutumes du spy scoring. L’originalité n’étouffe pas davantage l’incontournable lot de chansons, comme ce Givin’ It Plenty bien dans l’air du temps mais, pour tout avouer, assez fendard. The Second Best Secret Agent In The Whole Wide World, remontage américain du film inaugural de la série, Licensed To Kill, surplombe néanmoins la mêlée grâce au ton à la fois railleur et pétillant des paroles de Sammy Davis Jr.
Et puisque de subtiles circonvolutions thématiques viennent de nous conduire au Rat Pack… C’est amusant de constater que leurs membres, à une époque où l’immense popularité du groupe commençait à décroître, ont presque tous misé leurs jetons sur le business des pseudo-James Bond. Dean Martin a eu le nez creux, pour sa part, en choisissant d’interpréter Matt Helm. Ce ne fut bien sûr pas sans de substantielles modifications apportées au matériau littéraire d’origine, où le personnage était une gigantesque brute n’hésitant jamais à tuer de sang-froid. Après que ces zones noires aient été évacuées au bénéfice de la coolitude un rien bouffie de Dino, le public vint suffisamment nombreux pour justifier trois suites au Silencers (Matt Helm, Agent Très Spécial) original, et même une série cathodique tardive en 1976. On ne s’épanchera guère sur celle-ci, son caractère policier ne prêtant plus trop le flanc à l’espionnite pop, hormis pour louer l’excellent générique d’un Morton Stevens accoutumé aux rengaines entêtantes pour la petite lucarne. Cette jolie petite réussite, en tout cas, est la digne héritière des partitions des deux premiers films, respectivement signées par Elmer Bernstein, dont l’indolente palette jazzy ne laisse encore deviner que l’ombre du futur stakhanoviste des comédies eighties (au rang desquelles le « westernien » Spies Like Us [Drôles d’Espions]), et par un Lalo Schifrin gratifiant le formidable thème principal de Murderer’s Row (Bien Joué Matt Helm) de multiples variations à l’énergie dévastatrice. En comparaison, les deux derniers opus font assez triste figure malgré le zèle sautillant d’Hugo Montenegro. A peu près autant en odeur de sainteté dans le cénacle béophile que ne l’est André Rieu auprès des amateurs de classique (c’est dire), la faute à ses reprises alcoolisées de certains standards d’Ennio Morricone, Hugo le débauché profite des aventures de Matt Helm pour établir un catalogue exhaustif de ses tics les plus décriés. Prêtez donc l’oreille à ces chœurs mixtes que le musicien transforme en cocasses onomatopées, vous nous en direz des nouvelles…
Curieusement, bien que Lady In Cement (La Femme en Ciment) dégouline de ce genre de fantaisies, le score demeure l’un des rares élus dans toute la filmographie de Montenegro à jouir de quelque estime. Les qualités mélodiques du compositeur, souvent passées sous silence, flanquent dans un beau désordre les plis un peu fatigués du costume de Tony Rome, le stoïque détective qu’interprète pour la deuxième fois Frank Sinatra après Tony Rome (Tony Rome est Dangereux). D’obédience clairement plus « bondienne » que précédemment, cette suite n’a pas traumatisé les mémoires, tant s’en faut, ni marqué d’une pierre blanche la carrière de The Voice. Mais bien davantage qu’à l’acteur, c’est au crooner canaille que les ersatz de 007 sont redevables d’un de leurs rares titres de gloire. En 1966, Sinatra eut le coup de foudre pour l’adorable thème d’A Man Could Get Killed (D pour Danger) écrit par Bert Kaempfert, merveille de romantisme transformant l’idylle obligée entre le vaillant héros et son faire-valoir enjuponné en love story vénitienne. Avec l’active complicité du compositeur, Sinatra enrobait aussitôt ledit thème de sa voix de braise pour donner naissance à ce que l’on peut qualifier, tout sens de la mesure gardé, de standard immortel : Strangers In The Night. Cette signature de prestige n’a pas beaucoup profité au film, anecdotique pochade restée confite dans son juste anonymat. La même infortune, mille fois plus frustrante hélas, s’est abattue sur la carrière cinématographique de Bert Kaempfert, qui ne fut jamais rien qu’embryonnaire. On eût aimé voir le talentueux monsieur conquérir le grand écran comme il le fit, durant une large partie de sa carrière, des hit-parades.
De son côté, c’est par d’autres biais que la musique que Derek Flint, le très sportif espion aux mains de fer, a pris rencard avec la postérité. Les zélateurs de Jerry Goldsmith, pour la majorité d’entre eux, n’en ont jamais pris ombrage, Our Man Flint (Notre Homme Flint) et sa séquelle In Like Flint (F Comme Flint) faisant tout juste figure à leurs yeux d’inoffensifs ruban d’easy listening. Quelle sévérité à l’encontre du Maestro californien ! A la fois tributaire des bulles insouciantes des sixties et marqué par le goût notoire de son géniteur pour les acrobaties électroniques, ce beau doublé a bien plus fière allure qu’on ne condescend à l’admettre. Mais c’est la mâle attitude de sa tête d’affiche, le charismatique James Coburn, qui a fait impression. Robert McGinnis, une pointure du monde de l’illustration comme on n’en fait plus, trouvait au comédien un tel magnétisme, à l’écran comme sur les affiches des deux films conçues par Bob Peak, qu’il fit de lui l’alter ego du pulp detective Milo March en couverture des romans de M.E. Chaber. Plus près de nous, Flint est devenu l’idole et le maître à penser de l’International Man of Mystery Austin Powers, qui se régale de ses exploits dans la scène d’ouverture de The Spy Who Shagged Me (L’Espion qui m’a Tirée). L’instant paraissait propice pour le compositeur George S. Clinton, en charge des trois aventures du super-agent aux dents gâtées, d’adresser un petit bonjour au thème bondissant de Goldsmith. Mais en dehors d’une profusion de clins d’œil, non point cyniques mais émus aux années 60 (le fameux réarrangement du Soul Bossa Nova de Quincy Jones a la patate !), ce sont surtout les 007 de John Barry qui tiennent lieu de point cardinal. Le mélomane un peu joueur pourra s’amuser à pointer du doigt les nombreux passages « à la manière de », qu’il s’agisse du leitmotiv diabolique du Dr. Evil ou des réminiscences du suspense spatial de You Only Live Twice (On Ne Vit Que Deux Fois).
Goldmember, dernier opus de la trilogie, ajoute une corde supplémentaire à l’arc de Clinton. La vertigineuse choucroute afro qu’y arbore Beyoncé est, en soi, un indice de premier ordre. On peut en dire autant du nom de son personnage, Foxxy Cleopatra, référence assumée à la prédatrice Cleopatra Jones dans le film éponyme de Jack Starrett. Aiguillonnée par l’indiscipline criarde des seventies et par le groove chargé d’énergie de J.J. Johnson, la miss Jones, « Jane Bond » revancharde, devenait le cauchemar des mâles assez fous pour se dresser sur son chemin. Pour caricatural qu’il puisse sembler aujourd’hui, ce drôle de cocktail symbolisait l’aboutissement d’une démarche entreprise quelques années auparavant. Les producteurs de Shaft, en 1971, n’avaient-ils pas clamé haut et fort leur intention de faire de Richard Roundtree le premier 007 black ? La filiation, assez discrète dans le film fondateur, prend pleinement possession des inévitables suites, Shaft’s Big Score! (Les Nouveaux Exploits de Shaft), dont la longue poursuite finale sur terre, sur mer et dans les airs se confond avec les poussées de fièvre explosives du Symphony For Shafted Souls de Gordon Parks, et Shaft In Africa (Shaft Contre les Trafiquants d’Hommes), où la guerre déclarée par notre héros à d’odieux négriers se mue en bande dessinée anticolonialiste et surgadgétisée. Le funk occasionnellement primitif de Johnny Pate vient remuer le tout avec une vraie jubilation.
Un petit mot, si vous le voulez bien, à propos des cadors de la blaxploitation. Certains d’entre eux, résolus coûte que coûte à bichonner la légende d’un cinéma noir auto-suffisant et surtout précurseur, n’ont pas mâché leurs mots pour réduire le rôle des pionniers à trois fois rien. Sidney Poitier, l’inévitable, ne valait pas mieux, dans leur bouche, qu’un suppôt sans épaisseur du grand Satan Hollywood. Et dans ce révisionnisme filou, Bill Cosby n’existait carrément pas. L’acteur a pourtant marqué de son empreinte la petite lucarne en chapeautant le Bill Cosby Show, premier programme, en 1969, à ne présenter que des acteurs noirs à son générique. Si le politiquement correct ne nous faisait pas craindre un jeu de mots tendancieux, on dirait même de lui qu’il avait déjà annoncé la couleur, quatre ans plus tôt, avec la série I Spy (Les Espions) où Robert Culp tenait à ses côtés la vedette. Enlevé, dépaysant et constamment relax, à l’image de la musique couronnée par un Emmy Award de l’injustement oublié Earle Hagen, I Spy est bien sûr l’un des nombreux rejetons de The Man From U.N.C.L.E. (Des Agents Très Spéciaux), la série qui a su donner à des quarterons d’autres l’incoercible désir de raccrocher les wagons de la « bondmania. » Musicalement parlant, son fabuleux casting de jeunes loups aux dents longues ne connaissait aucun égal : Gerald Fried, Morton Stevens, Lalo Schifrin, tous de hardis aventuriers bravant l’étroitesse des budgets pour donner à humer les délicieux parfums exotiques de la lutte menée par David McCallum et Robert Vaughn, l’autre Dynamic Duo de la télévision américaine des années 60, contre le terrible cartel du mal THRUSH.
A la tête de cette dream team, il y avait Jerry Goldsmith, auteur d’un Main Title réjouissant comme pas deux et garant à lui seul de la coolitude sacerdotale de la série. Succès oblige, un duplicata féminin vit assez rapidement le jour, et dont le leadership musical fut attribué cette fois à Dave Grusin. Mais si ce dernier pensait avoir misé à son tour sur le bon cheval, les audiences sclérosées de The Girl From U.N.C.L.E. (Annie, Agent Très Spécial) ne tardèrent pas à le faire déchanter. Ses condisciples (dont Richard Shores, transfuge de la maison mère) et lui avaient pourtant trouvé le juste équilibre entre les références attendues au grand frère et l’originalité de soyeuses touches jazzy, lesquelles collent à la souple silhouette de Stefanie Powers aussi amoureusement que les minuscules robes constituant ses « bleus de travail. » On pourrait, pourquoi pas, lui trouver quelques affinités avec Doris Day, icône ingénue du girl power dans un Caprice (Opération Caprice) que Frank De Vol, les pectoraux sculptés par sa longue collaboration avec Robert Aldrich, embaume d’une pincée de viriles fragrances. Modesty Blaise n’est pas très éloignée non plus, et l’on ne dit pas ça parce que l’affriolante et redoutable héroïne de comic strip venait d’investir le grand écran, en cette même année 1966, pour prendre à bras-le-corps les excroissances généralement machistes de la saga Bond. Peut-être désireux de s’encanailler en voluptueuse compagnie, le très sérieux Joseph Losey n’a malheureusement pas su dépolluer son esprit de l’ancestral cliché de la demoiselle en détresse. Il se borne donc (mais c’est déjà beaucoup) à filmer sous son jour le plus sensuel la bellissima Monica Vitti, coulée au prix d’on ignore quelles contorsions dans des combinaisons aux couleurs de l’arc-en-ciel. Galvanisé plutôt qu’inhibé par ces oripeaux kitsch, le jazzman John Dankworth créé un score riche de mille trouvailles. Grave en de furtifs moments, souvent remuant et parfois même branché sur un mode baba cool, Modesty Blaise fait tourbillonner son excellent thème avec une inventivité qui ne décline ni les boîtes à musique pop, ni les petites fanfares dominicales.
Le temps de l’innocence, si l’on peut l’appeler ainsi, n’était évidemment pas fait pour perdurer. A l’entame des années 70, les bouleversements sans précédent qui secouèrent l’usine à rêves, précipitant la fin du règne des studios et marquant l’avènement du Nouvel Hollywood, faillirent être fatals à la désarmante candeur des James Bond de carnaval. Incidemment, les adieux de Sean Connery au personnage qui le bombarda jusque vers la A-list ont pu peser d’un certain poids dans la balance. Face au nœud gordien que représentait cette succession épineuse entre toutes, Roger Moore trancha bien vite en recyclant la bonhomie charmeuse que les aventures de Simon Templar et Brett Sinclair lui avaient donné moult occasions de peaufiner. Dans l’intervalle, il s’était aussi fait la main sur le tout petit film d’espionnage Crossplot (Double Jeu), où d’ubuesques péripéties autour d’un spot publicitaire pour une marque de désodorisant soumettent son flegme habituel à rude épreuve. Stanley Black à la baguette est probablement celui qui s’y est le plus amusé, tant les morceaux de bravoure constellant son ouvrage crépitent d’une énergie dansante. C’est ce dynamisme quasi juvénile que certains compositeurs, insensibles au grand chambardement de la nouvelle décennie, s’entêteront à brandir haut, telle une banderole aux couleurs vives des swinging sixties. Témoin Claude Bolling, déclamant avec sa verve toujours aussi prolixe dans Catch Me A Spy (Les Doigts Croisés) un cortège de mélodies de velours, d’easy listening à la paresse trompeuse et de petits murmures où l’ironie ne franchit jamais la frontière ténue qui la sépare des moqueries faciles. Bref, tout l’abécédaire d’Henry Mancini, à qui Stéphane Lerouge, l’oreille aussi aiguisée que de coutume, n’a pas manqué de comparer Bolling.
Quand on s’appelle Jerry Goldsmith, en revanche, on n’est pas vraiment du genre à ressasser sans trêve le passé tout en poussant des soupirs à fendre l’âme. Les yeux résolument fixés sur l’horizon, au point, qui sait, d’y avoir perçu les contours encore flous de sa collaboration future avec le sale gosse Joe Dante, Goldsmith s’écarte de la coolitude des Flint et change S*P*Y*S (Les ‘S’ Pions) en une gaudriole étrange et dépenaillée. Jamais au repos, la musique rivalise de bouffonneries avec les zéros de l’espionnage Elliott Gould et Donald Sutherland, affublant le thème principal de synthés pustuleux, s’emmêlant les pieds sur des airs slaves déglingués et pastichant éhontément le répertoire classique, comme la fameuse ouverture de la Symphonie n°5 de Beethoven, que des sonorités orientales caricaturent à traits pâteux. Une œuvre mineure, aux dires des béophiles décontenancés par son inclination aux borborygmes de toutes espèces. N’empêche que S*P*Y*S demeure l’une des plus divertissantes partitions du « 007 fake » des seventies, alors mal en point. Car tandis que l’espionnage dit sérieux reprenait du poil de la bête, souvent en collant au plus près d’une actualité brûlante, les faux James Bond, eux, s’abîmaient dans les tréfonds les moins avouables (mais pas les moins réjouissants pour les fins gourmets au palais exercé) du cinéma d’exploitation pur et dur. Ainsi, dans le très nul et très rigolo Double Agent 73 (Super Nichons Contre Mafia), l’incroyablement poumonnée Chesty Morgan se livre incognito aux joies de l’espionnage grâce à un très ingénieux gadget : un appareil photo dissimulé à l’intérieur d’une de ses titanesques mamelles ! Inutile de préciser que les occasions de se rincer l’œil sont légion. Hélas, nos oreilles ne sont pas à semblable fête, le blâme en incombant aux compositeurs de dernière catégorie vers lesquels le genre se tournait de plus en plus. Combien de fois ces tristes sires n’ont-ils pas tailladé les vibrations funk des années 70, les nivelant à la médiocre hauteur de ce qui leur tenait lieu d’inspiration.
C’est alors que surgit, sans que quiconque ne l’ait vue arriver, la vague déferlante Star Wars, qui transperça la touffeur estivale de 1977 avec les conséquences que l’on a décortiquées depuis lors un bon milliard de fois. Qu’il nous suffise, à nous autres béophiles, d’évoquer le triomphe néo-romantique et les cuivres wagnériens de John Williams, source d’une nouvelle métamorphose de la musique de film hollywoodienne. Il n’est plus resté que deux ou trois fortes têtes pour faire de la résistance chez les barbouzes au nœud papillon, comme le routard de la télévision John Cacavas, régulièrement vilipendé pour ses très discutables arrangements du thème de Billy Goldenberg dans Kojak. Son Once Upon A Spy, groovy jusqu’à plus soif et nanti d’une rengaine frénétique donnant le la en quelques accords bien balancés, ne fait pas mystère de son faible (nullement) coupable pour les favoris broussailleux, les chemises à jabot et les 007 de John Barry. Rétrospectivement, un tel score, sans rien d’exceptionnel pourtant, brille de l’éclat bravache propre aux barouds d’honneur : autour de lui, le spy scoring n’avait cessé de croitre dans d’opulentes dimensions symphoniques. Donald Sutherland, engoncé dans une lourde doudoune, crapahute au coeur d’un labyrinthe de congères dans Bear Island (Le Secret de la Banquise), et Robert Farnon fait exploser les grandes pompes orchestrales sans se soucier le moins du monde d’un quelconque sens de la mesure. Val Kilmer se pointe en rock star dépassée par les événements dans Top Secret!, et Maurice Jarre, avec le sérieux papal de ses partitions pour les grandes fresques de David Lean, préside à la tonitruante rencontre entre l’espionnage portnawak et les « World War II Movies », chargés par ses soins de scansions dévastatrices à la Franz Waxman. Jamais un second degré gluant de facilité ne vient s’insinuer dans sa symphonie martiale, pas même lorsque les cadors du déguisement, tentant d’infiltrer les lignes ennemies dans un costume de bovidé, subissent à leur corps défendant (quoique…) les derniers outrages.
Evidemment, les années 80, c’est aussi le règne des opérateurs-son et des scores électroniques aux très variables qualités. En soi, ce n’est pas une surprise que le cinéma X, qui devait bien se colleter tôt ou tard à un James Bond soudain pourvu de plantureux attributs (Jane Bond Meets Octopussy, Jane Bond Meets Thunderballs), ait opté pour cette approche très générique, et surtout guère dispendieuse. Mais James Newton Howard, qu’un vieux réflexe nous pousse à spontanément associer à de fastueuses débauches orchestrales, est passé par là lui aussi. Presque vingt ans avant qu’il ne rencontre Hans Zimmer sous le ciel plombé de Gotham City, il goûtait pour la première fois aux plaisirs des binômes hétéroclites en compagnie de Lennie Niehaus, futur pourvoyeur des accords de gratte éthérés dont Clint Eastwood est friand. Le résultat de leur frotti-frotta s’intitule Never Too Young To Die (Stargrove et Danja, Agents Exécutifs), et seuls les thuriféraires monomaniaques de l’un ou l’autre des deux compositeurs se lamenteront qu’un album ne soit jamais paru. Qu’elle ait affaire à des mitraillages à peine plus explosifs que dans un Z philippin ou à une scène de séduction à deux doigts de virer au concours de tee-shirt mouillé, la musique ne manque jamais de brandir ses synthés très modes comme l’argument stylistique absolu. Une décennie plus loin, Mark Mancina succombera au même écueil dans The Secret Agent Club (Espions en Herbe), à cette notable différence que les balbutiements Bontempi cèderont ici leur place à des riffs mollement rock. Pas étonnant, le super-espion de service arborant la moustache et les yeux exorbités de Hulk Hogan, ambassadeur quoi qu’il advienne d’un catch américain dont les ambiances graisseuses n’ont que peu à voir (pour ne pas dire fichtrement rien) avec John Barry.
Ancienne vedette du ring lui aussi, Dwayne « The Rock » Johnson, tous froncements de sourcils dehors dans l’adaptation éponyme (mais rebaptisée en France Max la Menace) de la sitcom des sixties Get Smart, écope à peu de chose près d’un traitement musical identique à celui de son illustre ainé. Le genre de job taillé sur mesure pour Trevor Rabin, que ses fans (doux Jésus ! Il en existe donc ?), en rien découragés par la réprobation générale, considèrent comme un authentique guitar hero. S’acharnant avec des trésors de finesse sur son instrument de prédilection, le compositeur régurgite le fameux thème « à la Henry Mancini » de la série sous une forme ingrate, puis l’achève en le criblant de traits d’action d’une cacophonique modernité. Michael Kamen, artiste rock’n’roll dans l’âme, et Bill Conti, toujours partant pour chausser ses bottes de combat, ont su tout autrement honorer ce créneau en écrivant respectivement les scores de Blue Ice et Spy Hard (Agent Zéro Zéro). Dans le premier, Michael Caine, pour la énième fois dans la peau d’un vieux de la vieille des services secrets (« I was James bloody Bond », plastronne-t-il, pince-sans-rire), fait craquer la belle Sean Young sur fond de saxophone moelleux et règle ses compte au rythme de violents horions orchestraux (un cocktail qui n’est pas sans évoquer, sur un mode mineur cependant, les Lethal Weapon du même Kamen). Quant au second, nouvelle guignolade d’un Leslie Nielsen sur la pente savonneuse du déclin, sa gratte frénétique transforme l’acteur, bien mieux qu’une mise en scène fossilisée, en super-héros trompe-la-mort. Mais la musique de Conti n’est pas que symphonico-rock, comme en témoignent les cuivres « bondiens » de l’hilarante contrefaçon des génériques de Maurice Binder, dont les fameuses naïades découpées en ombres chinoises accusent cette fois une spectaculaire surcharge pondérale. Le très populaire comique et chanteur Weird Al Yankovic, passé en coup de vent pour dispenser d’ironiques vocalises, en a carrément perdu la tête.
Les choses, depuis lors, n’ont pas connu d’évolution significative, s’enlisant au contraire dans un fracas de marteau-pilon qui, presque invariablement, résonne lorsque les espions des années 2000 bondissent à l’écran. Au milieu des petites mains qui encombrent le genre et se satisfont d’un prêt-à-écouter sans grande ambition (voir à ce propos Kingsman: The Secret Service, l’une des dernières déclinaisons en date, où un Henry Jackman perclus de tics modernes s’inscrit en porte-à-faux avec la nostalgie pop du réalisateur Matthew Vaughn), reste heureusement quelques artisans un tant soit peu consciencieux. C’est le cas de John Powell avec Agent Cody Banks (Cody Banks, Agent Secret), qui se paye le luxe de glisser dans son traditionnel et robuste alliage de cuivres mastoc et d’électro speedée quelques échos discrets, mais toujours autant labellisés sixties, de ce bon vieux vibraphone. Edward Shearmur, pas le dernier non plus à ruer tel un taureau furieux pour peu qu’on lui confie un orchestre, se surprend également dans Johnny English à moirer un festival d’action non-stop des couleurs du spy movie d’autrefois. Pas au point de se voir reprocher une concupiscence traitresse à l’égard du passéisme, n’exagérons rien, mais suffisamment pour que la bouille éberluée de Rowan Atkinson rappelle, dans ses grimaces parodiques, les seconds rôles des plus ineffables 007 de la période Roger Moore.
Moins enclin à regarder par-dessus son épaule, Johnny English Reborn (Johnny English, le Retour) reflète davantage le goût pour l’efficacité immédiate d’un Ilan Eshkeri qui, de formules trompettantes en explosions rythmiques très peu subtiles, rappelle à chaque instant qu’il est un homme ancré des deux pieds dans son époque. Et à la réflexion, que pourrait-il y avoir là de répréhensible ? Pris au piège des teintes acidulées des années 60, incapables de voir en Sean Connery autre chose que « the sensation of the month », les bâtards italiens de James Bond n’attirent plus aujourd’hui qu’une poignée de regards intrigués, dans le petit cabinet des curiosités où leur auto-destruction foudroyante les a conduits. Mais leurs homologues américains n’ont jamais baissé pavillon, justement grâce à cette aptitude, qu’on assimilerait presque à un farouche instinct de survie, à faire peau neuve au fil des époques et des nombreux visages sur le grand écran du père fondateur lui-même. A coup sûr, le succès du nouveau James Bond, qui marque la résurrection du SPECTRE et sur lequel tous les regards sont comme d’habitude rivés, devrait rapidement fournir à tous les espions relax en ce bas-monde un énorme parc d’élégants et cruels Méphistophélès à combattre. Et aux compositeurs hollywoodiens, un matériau suffisamment riche pour qu’ils lâchent une fois de plus la bride à leur imagination.