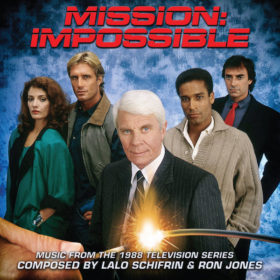THE MEAN SEASON (1985)
THE MEAN SEASON (1985)
UN ÉTÉ POURRI
Compositeur : Lalo Schifrin
Durée : 77:52 | 55 pistes
Éditeur : Intrada
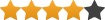
Rien n’est plus facile que d’apposer sur le front d’un artiste une étiquette le catégorisant une fois pour toutes. Entré dans la légende comme le prince de la «coolitude» musicale grâce aux délectables atmosphères jazzy de Bullitt, The Cincinnati Kid (Le Kid de Cincinnati) ou Les Félins, Lalo Schifrin a malheureusement vu cette envahissante consécration occulter bien des facettes de son talent protéiforme. Ce n’est pourtant pas faute de s’être illustré dans des genres divers et variés : en touche-à-tout de génie, le compositeur argentin a écrit d’impressionnantes partitions symphoniques, des œuvres intimistes et subtiles et s’est livré plus souvent qu’à son tour à d’audacieuses expérimentations, truffées de sonorités étranges et atonales (ceux qui ont écouté THX 1138 ne pourront qu’opiner du chef). The Mean Season (Un Eté Pourri), honnête thriller réalisé en 1985 par le très oublié Phillip Borsos, témoigne avec éloquence de cette créativité bouillonnante. A une époque où bon nombre de musiciens camouflaient une inspiration en berne derrière des synthés faméliques, Schifrin mettait tout son savoir-faire à l’œuvre pour métamorphoser ce qui n’aurait pu être qu’un score routinier en un très efficace exercice de suspense, doublé d’un onctueux hommage aux séries noires des années quarante et cinquante.
Le superbe Main Title donne très clairement le la, avec ses brusques sursauts cuivrés et son déploiement de cordes tantôt sombres et violentes, tantôt élégantes et enlevées, qui accompagnent une trompette solo sur un tempo fiévreux. Difficile de ne pas succomber au pouvoir d’évocation de cette formidable ouverture qui peuple immédiatement l’esprit d’images au noir et blanc contrasté, où un privé engoncé dans un imperméable et coiffé d’un feutre mou traîne son blues dans des ruelles désertes. Cet entêtant parfum hard-boiled (du terme dont on désigne les ouvrages d’écrivains durs à cuire tels Dashiell Hammett ou Mickey Spillane) imprègne encore un She’ll Find Something tout en sobriété et You let Everything Slide, passionnante fusion de bois élégiaques, de solennels accents jazzy et de touches électroniques aussi mystérieuses que discrètes. Et puisque tout film noir digne de ce nom ne saurait se passer d’incandescents charmes féminins, Schifrin n’oublie pas d’irriguer The Mean Season de très belles effusions romantiques, qui s’incarnent dans un love theme délicat. La finesse de son écriture est tour à tour magnifiée par le piano de The Timing Wasn’t Right et I Just Wish, les cordes merveilleusement surannées du bien nommé Old Movie Strings et le lyrisme généreux de Christine (End Credits).
Mais peut-être, avant d’aller plus loin, conviendrait-il de jouer cartes sur table. Car, contrairement à ce que pouvait laisser entendre ce qui précède, The Mean Season ne cherche guère à se donner des allures de polar rétro. Kurt Russell, dans le rôle d’un journaliste assoiffé de gloriole, n’a rien du charisme gouailleur et désabusé d’un Humphrey Bogart, et Mariel Hemingway, qui incarne sa douce petite amie, ne possède pas une once de la dangereuse séduction émanant de Lana Turner ou Ida Lupino. Non, le film de Phillip Borsos, malgré sa volonté de privilégier l’atmosphère et la psychologie à l’action pétaradante, reste fermement ancré dans le présent, et la musique de Lalo Schifrin s’en fait l’écho via le tueur retors interprété par Richard Jordan. Cette fois, le compositeur abandonne toute idée de sophistication mélodique pour élaborer des ambiances tendues, vagues réminiscences des sonorités avant-gardistes qui caractérisaient le diabolique Scorpio dans Dirty Harry (L’Inspecteur Harry). Avec pour armes des cordes glaçantes, un piano minimaliste et les interventions sporadiques de synthés emplis d’une sourde menace, des titres comme The Fourth Call, We’ve Been Had ou Shower Curtain, tout en dégageant un certain parfum «herrmannien», réussissent à contourner l’écueil des grinçantes poussées de fièvre de Psycho (Psychose), devenues un vrai cliché musical par la faute de compositeurs bien incapables de les dompter. A cent lieues des batteries usagées d’effets-choc trop faciles, Schifrin instaure dans ces plages de suspense un rythme presque languissant, d’où suinte un malaise diffus, nimbant ainsi le meurtrier de l’aura diabolique que la réalisation paresseuse de Borsos est généralement impuissante à invoquer.
Le constat s’avère d’ailleurs rigoureusement identique lors des (rares) moments où le cours du récit s’emballe. Alors que le cinéaste se démène comme il peut pour donner un semblant de dynamisme à des scènes d’action sans relief, Schifrin, lui, prouve une fois encore son admirable maîtrise dans ce registre particulier. Au jeu des cordes survoltées et des rythmiques haletantes, c’est At The Top Of The Bridge, davantage encore que les pourtant très réussis Here We Go ou Headline, qui rafle brillamment la mise. Le Main Title, débarrassé de ses oripeaux groovy, est scandé avec énergie par des cuivres retentissants, tandis que les cordes virevoltent et qu’un piano très sombre nous gratifie en bout de course d’une brève et intense explosion. Mais Everglades n’est pas mal non plus, qui met également à contribution le thème principal dans une spectaculaire décharge d’adrénaline.
Non content d’une version album parfaitement équilibrée, Intrada a choisi de présenter The Mean Season dans toute son exhaustivité en gorgeant le disque d’une bonne demi-heure de pistes dites de transition, pour la plupart dévolues au mystère et au suspense. Ces rajouts, certes appréciables, s’avèrent néanmoins assez anecdotiques, du fait de leur extrême brièveté (chacun d’entre eux ne dure en moyenne que quelques dizaines de secondes, parfois même moins !) Deux échantillons de source music, toutefois, tranchent nettement sur l’ensemble du score : le rafraichissant Mean Cartoon Source renvoie de toute évidence aux fameuses partitions « animées » de Carl Stalling et, par là même, semble préfigurer le Maroon Cartoon du Who Framed Roger Rabbit (Qui Veut la Peau de Roger Rabbit ?) d’Alan Silvestri, autre hommage appuyé à la tradition musicale du film noir. Quant à Lunchtime, il tourne le dos à la sophistication suave d’un Quintet pour faire tonitruer une guitare rock’n’roll que l’on n’attendait évidemment pas. Un zeste de variété supplémentaire pour une œuvre qui n’en avait de toute façon pas grand besoin, tant elle brille par ses nombreux foyers d’inspiration et l’égal bonheur avec lequel elle leur rend justice.