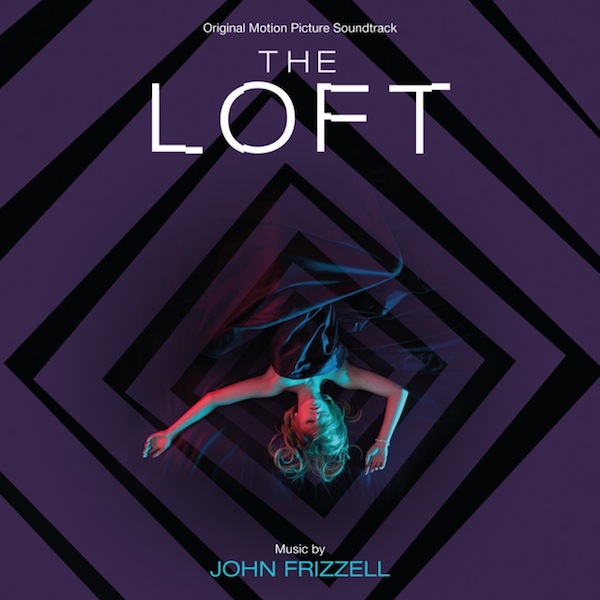Quel est ton premier souvenir musical ?
Il y en a deux : mon grand frère jouant du piano dans la salle à manger au moment où je partais me coucher, je devais alors avoir trois ou quatre ans, et mes parents écoutant de la musique classique dans la voiture. J’ai le souvenir d’avoir été particulièrement marqué par un morceau que j’avais trouvé magnifique, et même si je n’ai depuis jamais retrouvé ce que c’était, cela reste pour moi une excellente impression.
Y a-t-il une œuvre musicale que tu as découverte et qui t’a orienté vers ce que tu fais aujourd’hui ?
Jurassic Park de John Williams, mon premier disque de musique de film : pas trop mal pour commencer ! (rires) J’ai très peu été au cinéma pendant les douze premières années de ma vie – mes parents ne m’y emmenaient pas – et un jour dans un magasin, il y avait tout le battage médiatique autour de Jurassic Park qui n’était pas encore sorti. La bande-annonce tournait, avec ce plan de l’hélicoptère arrivant sur l’île, et la musique derrière… Le déclic, vraiment le déclic. Je me suis procuré le CD avant de voir le film, j’ai d’ailleurs eu une sorte de Jurassic Park mania où j’achetais tout ce qui tournait autour, mais c’est la musique qui m’a le plus impressionné. Je l’écoutais littéralement en boucle, et c’est là que j’ai pris conscience de la force que pouvait avoir la musique sur une image.
Tu arrives toujours à l’écouter de la même façon maintenant ?
Oui ! Et cette séquence intitulée Welcome To Jurassic Park, qui dure bien sept minutes dans le film : ce que Spielberg et Williams arrivent à y créer, c’est vraiment pour moi le modèle artistique au cinéma.
Et tu as donc décidé de te mettre à la composition ?
En fait, vraiment trois ou quatre ans plus tard. J’ai d’abord eu la chance d’avoir au collège un professeur de musique remplaçant qui valorisait les élèves et les impliquait beaucoup. C’est un peu lui qui m’a donné l’impression qu’on pouvait créer quelque chose d’intéressant en musique, transmettre des émotions. J’ai commencé à écrire en troisième.
Et quels souvenirs gardes-tu de ces premières compositions ?
C’était très basique, composé au piano, extrêmement tonal et complètement axé sur la mélodie. Mais j’ai voulu assez vite écrire directement pour l’orchestre car c’est ce qui m’a toujours le plus intéressé, et là c’était directement inspiré par John Williams. Et mon premier vrai souvenir, c’est lorsque j’étais au lycée Claude Monet où je préparais l’option musique pour le bac. Mon professeur, Annick Chartreux, dirigeait un orchestre et avait organisé un petit concert où des élèves pouvaient faire jouer leur propre composition. J’avais donc écrit quelque chose, je commence à diriger… et là ça part dans tous les sens, obligé d’arrêter et de recommencer… J’étais au lycée, ce n’était pas la fin du monde mais pour moi c’était l’échec total ! (rires)
As-tu un instrument de prédilection ?
Je dirai les cordes d’une manière générale, surtout parce qu’il y a tellement de possibilités d’expressivité dans les cordes qui ne sont pas données à quelqu’un comme moi qui suis pianiste de formation. Je ne sais plus qui disait que pour être un bon chef d’orchestre, il faut avoir joué d’un instrument à cordes, mais je pense que c’est vrai autant d’un point de vue technique qu’émotionnel. Et parmi les cordes, si j’avais un instrument de prédilection, ce serait le violoncelle. J’ai écrit pour cet instrument assez tôt parce qu’à l’époque une des mes très bonnes amies était violoncelliste : c’est un instrument que la palette de sonorités, du grave à l’aigu, rend vraiment intéressant comme soliste.
Tu es parti au Berklee College of Music de Boston un an après le baccalauréat : comment cela s’est-il décidé ? Qu’avais-tu en tête à ce moment-là ?
J’ai découvert Berklee alors que j’étais au lycée, en seconde ou première, et deux choses m’attiraient. D’abord, sans être spécialement anti-conservatoire, j’ai suivi avant tout des cours particuliers de musique. J’ai ensuite essayé d’entrer au conservatoire mais j’ai trouvé ça extrêmement élitiste, entièrement tourné vers le passé et pas du tout vers le futur. Ca ne me tentait pas trop.
Au départ j’avais pensé devenir professeur de musique et composer à côté mais je me suis rendu compte que cela ne me disait rien non plus à ce moment-là. Et personnellement, j’avais également besoin de quitter la France, de découvrir d’autres choses : j’avais l’impression d’être enfermé sur le plan créatif.
En plus, Berklee donne la possibilité de décrocher un travail et de gagner sa vie immédiatement après le cursus, et il n’y a pas beaucoup d’écoles qui permettent ça. Je peux dire que j’ai commencé à bien gagner ma vie un an seulement après Berklee, et je n’étais qu’un simple assistant ! Mais c’est un marché où les budgets sont suffisamment importants pour justifier les services de quelqu’un comme moi. Rentrer dans le business est plus facile aux Etats-Unis, il y a la libre entreprise, ça fait un peu rêve américain, mais si on se bouge, on y arrive. En France, c’est quasiment impossible.
Ce sont les raisons pour lesquelles je suis parti. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui pouvaient me soutenir financièrement, et j’ai décroché une bourse. Ce qui m’intéressait à Berklee dès le départ, c’était le cursus « film scoring » parce que le retour sur investissement se ferait plus facilement dans les médias. Si on veut écrire de la musique et gagner sa vie, c’est dans les médias que cela se passe. Ceux qui étudient à Berklee avec une spécialité en composition classique par exemple font une erreur selon moi parce qu’ils vont dépenser 120.000 dollars pour décrocher un diplôme qui va être difficile à rentabiliser.
Tu avais déjà un schéma pour la suite ?
Non. J’avais juste le schéma pour ces quatre ans à Berklee. J’avais tout planifié dès le départ : il y a un tronc commun obligatoire et beaucoup de cours à la carte, et je savais exactement ce que je voulais. En fait j’ai vraiment paniqué une semaine avant d’avoir mon diplôme : je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que j’allais faire ensuite, si je devais rester à Boston, aller à New York, à Los Angeles, ou même revenir en France… Et puis je me suis dit que je pouvais tenter Los Angeles, ce qui m’apparaissait être un choix réaliste. On m’avait dit : « Tu vas voir, c’est une culture différente, pour des européens ce n’est pas facile de s’adapter à la vie à L.A. ». J’avais des exemples de gens qui avaient habité L.A. et étaient revenus sur la côte Est ou en France. Je me suis dit que puisque j’étais là, je devais essayer, voir si ça me plaisait, si je trouvais du boulot… J’ai donc acheté une voiture et envoyé toutes mes affaires là-bas. Ca a commencé ainsi.
Et puis je dois avouer qu’après quatre ans à Berklee, j’avais vraiment envie de partir. En dernière année, on est au niveau où chacun a l’impression d’en savoir suffisamment pour faire les exercices : on aimerait alors pouvoir les faire et être payé pour, plutôt que de payer pour avoir le droit de les faire.
Et pendant tes quatre années à Berklee, tu as étudié la composition, l’orchestration et la direction d’orchestre : avais-tu alors envisagé l’une de ces trois disciplines plus que les deux autres ?
J’aurais aimé développer ma direction d’orchestre. C’est l’un des mes regrets à l’heure actuelle, mais peut-être que je pourrai rattraper ça dans les prochaines années car cela m’intéresse vraiment. J’ai d’ailleurs créé un orchestre à Berklee pendant que j’étais là-bas. J’avais même un temps pensé suivre un master en direction d’orchestre, mais pour une question financière, mes parents m’ont dit : « Non, là il faut travailler ! » (rires). Mais je l’aurais bien fait, c’est vraiment quelque chose qui me passionne.
D’où est venue l’idée de monter un orchestre à Berklee et comment cela s’est-il passé ?
Berklee a la particularité d’être historiquement une école de jazz et de musique moderne. Ce n’est pas un conservatoire au sens où on l’entend habituellement chez nous. A l’époque où j’y étais, il y avait 4 000 étudiants dont, si je me souviens bien, quelque chose comme 600 pianistes, 800 guitaristes, peut-être 500 batteurs, pas mal de basses et de cuivres aussi dans le style « big band », et en fait très peu de musiciens de formation classique. Le but de Berklee à l’origine et pendant les quarante premières années était de ne pas être trop élitiste et d’accepter qui veut venir à condition bien sûr qu’il puisse payer. Aujourd’hui, ils ont inversé la tendance parce qu’il y a trop de monde, ils ne prennent plus que 35% des gens qui demandent, après audition. Donc il y a avait bien quelques groupes orchestraux, mais aucun n’était proportionné pour jouer de grandes symphonies : c’était plutôt ce qu’on appelle là-bas des orchestres « pops ».
Pour moi, être à Berklee, dans cette école, ne signifiait pas qu’il fallait oublier le classique. Et c’était aussi par besoin car l’enseignement de la direction d’orchestre à Berklee s’effectue au cours des deux premières années à partir de battues sur des enregistrements, et il n’y a qu’un seul moment, en troisième année, où des musiciens sont en face de nous, et il s’agit d’un ensemble de seulement sept ou huit personnes.
Donc comme la direction d’orchestre m’intéressait vraiment et que je voulais me perfectionner, je me suis dit qu’il manquait un véritable orchestre. On a fait des concerts, on a enregistré quelques morceaux, au final je pense que tout le monde en a bénéficié. Par contre, rien n’était facilité, on avait un peu l’impression d’aller à l’encontre de l’école et il a fallu pas mal de temps pour que j’apprenne les règles, la politique… C’était intéressant. L’orchestre commençait vraiment à se lancer quand je suis parti, et ils ont arrêtés deux ou trois ans après.
Ils ont arrêté ?
Oui, parce qu’ils ont pris le groupe que j’avais créé à l’origine pour l’intégrer à l’orchestre « pops » de l’école. Ils ont d’une certaine manière court-circuité ce qui n’était jusqu’ici qu’une initiative d’étudiants. Mais je pense qu’on a au moins lancé l’idée qu’il y avait la possibilité de monter un grand orchestre à Berklee : une belle idée pour une école de musique, non ? Par contre des groupes de salsa, de bossa nova ou de jazz, il y en a plein, ça ne manque pas ! (rires)
A Boston, tu as travaillé aussi avec les Longwood Players…
Oui, une petite parenthèse pendant Berklee. J’ai été « orchestra manager » pour une petite troupe amateur de théâtre, à un moment où je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de miracle, que les opportunités n’allaient pas tomber du ciel et qu’il fallait aller de l’avant. J’ai vu un jour une annonce sur un tableau et je me suis dit que j’allais essayer : ils cherchaient un directeur musical, et même si je me rendais bien compte que je n’avais pas les compétences, je leur ai dit que s’ils avaient besoin de quoi que ce soit concernant la musique, je serai ravi de les aider. Ca s’est lancé comme ça, je me chargeais notamment de trouver les musiciens. Il y avait deux pièces par an, dont une comédie musicale, un style qui en plus fonctionne bien avec les étudiants de Berklee. J’ai travaillé avec la compagnie deux années de suite, et la deuxième j’étais chef d’orchestre. C’est vraiment un grand souvenir parce que cela m’a fait découvrir Broadway et le milieu de la comédie musicale que je ne connaissais pas du tout. Et si quelqu’un me proposait aujourd’hui un travail à Broadway sur la côte Est, ça m’intéresserait beaucoup.
Qu’est-ce qui t’attire vers Broadway ?
Le live ! Je me souviens qu’avec les Longwood Players on jouait six représentations, et chacune d’entre elles était différente et ça c’est unique : l’adrénaline du show, le respect des chanteurs… Dans les deux cas – musiques de film ou comédies musicales – il s’agit de travail d’équipe, mais le live a vraiment un côté sympa.