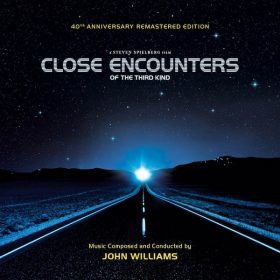THE FURY (1978)
THE FURY (1978)
FURIE
Compositeur : John Williams
Durée : 110:54 | 42 pistes
Éditeur : La-La Land Records
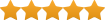
On peut comprendre la lassitude irritée de Brian De Palma. A devoir faire face des années durant aux sempiternelles questions sur la place qu’occupe Hitchcock dans son œuvre, il a fini par ne plus se prêter que de mauvaise grâce au jeu stéréotypé des interviews. N’empêche que l’on n’est pas obligé de le croire aveuglément lorsqu’il minimise l’influence du maître du suspense, ne reconnaissant que Vertigo (Sueurs Froides) et Rear Window (Fenêtre sur Cour) comme modèles abondamment visités. Quid de Rebecca et Psycho (Psychose), dont la virtuosité technique et les caractères ambivalents l’ont sans conteste aidé à façonner certains de ses meilleurs films ? Et que dire, pour en revenir à des considérations plus musicales, de sa collaboration avec l’illustre frère d’armes de Sir Alfred, Bernard Herrmann ? Un partenariat que De Palma a d’ailleurs initié en personne en 1973, même si les deux hommes ne se seraient peut-être jamais rencontrés sans les précieuses suggestions du monteur Paul Hirsch, grâce à qui le cinéaste avait découvert, à son grand étonnement, qu’Herrmann était toujours de ce monde et travaillait encore, quoique de manière très sporadique, pour le grand écran. Ainsi naquirent les superbes partitions de Sisters (Soeurs de Sang) et d’Obsession, où De Palma, tel James Stewart entraînant Kim Novak dans sa quête morbide d’un amour perdu, avait en quelque sorte instrumentalisé le génie du musicien, comme pour nourrir son désir fou d’un pont fantasmagorique jeté entre son cinéma et celui d’Hitchcock à ses heures les plus glorieuses.
Enchanté du résultat (et à juste titre), le réalisateur songeait déjà à tenter la passe de trois en confiant le futur Carrie à Herrmann. Mais ce dernier mourut, terrassé par la fièvre créatrice que ses ultimes affectations avaient ravivée, et le film tomba finalement entre les mains du talentueux Pino Donaggio. Brian De Palma, néanmoins, était loin d’avoir tiré un trait sur son dada hitchcockien, et c’est avec opiniâtreté, alors qu’il travaillait dans les derniers mois de l’année 1977 à la mise en chantier de The Fury, qu’il se mit en quête d’un compositeur suffisamment habile pour «faire du Herrmann». Pour quiconque s’enhardirait à se frotter de la sorte au grand Bernie, la seule récompense possible semblait être, au mieux, une bordée de lazzis, au pire, le gibet. Sauf que l’heureux élu, nul autre que John Williams, était alors parvenu à une étape charnière de sa carrière, qui devait marquer d’une pierre blanche l’Histoire de la musique de film. Star Wars, Superman, Jaws… Autant de joyaux décisifs ayant bouleversé le Landerneau hollywoodien, parmi lesquels The Fury aura toutes les peines du monde à s’octroyer une petite niche. S’il fallait à tout prix distribuer des blâmes, le film hybride de Brian De Palma, victime d’un désintérêt généralisé, en écoperait d’un bien plus sûrement que l’hypothétique panne d’inspiration qu’on aurait la fort mauvaise idée d’attribuer à Williams. Car le Main Title, au-dessus de tout reproche, s’impose à lui seul comme l’une des plus fascinantes réussites de son auteur. Herrmann, l’archétype tant convoité, rôde à pas feutrés au cœur de cette spirale puissamment macabre, d’où les cuivres et la clarinette ressortent transfigurés, irradiant une séduction maléfique. Le générique ne s’est pas même achevé que, déjà, les ambitions de De Palma apparaissent limpides. Ce qui l’aiguillonne, ce sont les fêlures cachées, les faux-semblants traîtres et l’innocence viciée par une science monstrueuse, plutôt que les rebondissements typiquement seventies d’une intrigue d’espionnage en laquelle il ne semble parfois croire qu’avec mollesse.
Dans l’âpre exercice du thriller paranoïaque, qui a vu des compositeurs de l’acabit de David Shire ou Michael Small faire de petits miracles, Williams n’aurait sans doute pas démérité. Que les sceptiques jettent une oreille au formidable Black Sunday pour s’en convaincre ! Quand bien même, on ne pourra jamais que supputer, les scènes remplies de coups de feu, de filatures nocturnes et d’écoutes crapuleuses s’avérant symptomatiquement dépourvues de musique, à quelques exceptions près (le trépidant The Fog Scene donne un sacré coup de fouet au chassé-croisé automobile qu’il accompagne). En dépit de son implication de tous les instants, Kirk Douglas himself, dans l’un de ses derniers rôles au sommet de l’affiche, n’est pas de taille à rivaliser face à la véritable attraction de The Fury : la télékinésie et les adolescents déboussolés qu’elle tient sous son emprise. S’ensuit, sur ce sombre postulat, une pléiade de scènes tour à tour inquiétantes et grotesques, qui préfigurent l’explosion de tête face caméra de Scanners comme les gamins en révolte du cultissime Akira.
Dans les premières manifestations paranormales, encore assez anodines, qui secouent The Train Wreck, c’est à nouveau Herrmann que le bref tourbillon du theremin convoque sans appel. A ceci près que l’alter ego d’Hitchcock a cédé sa place à l’expérimentateur imperméable à tout compromis, auquel la science-fiction des années 50 doit l’une de ses partitions séminales, The Day The Earth Stood Still (Le Jour où la Terre s’arrêta). De nombreuses bobines et pistes musicales plus tard, Williams laisse éclater (de façon littérale !) les terribles pouvoirs des jeunes héros dans Gillian’s Power, où les cordes et les cuivres, inextricablement liés, vocifèrent d’une implacable et identique fureur. Gageons, même s’il s’était souvent montré peu amène à l’égard du petit monde de la musique de film et de ses propres créations, qu’Herrmann aurait su mesurer à leur juste valeur les audaces de son successeur. A coup sûr, l’une d’entre elles, Death On The Carousel, se serait distinguée plus que n’importe quelle autre à ses yeux. A ce propos, ce n’est pas la version initialement écrite de cette pièce à l’essor glacial que Brian De Palma, lui aussi à la recherche de roboratives transgressions sonores, a choisi de mettre en évidence, mais son double truffé d’électronique. Conjointement à l’enregistrement du score complet, Williams, ne dérogeant pas à la tradition, s’est attaché à l’entière restructuration de son labeur pour créer un album princier, dont les multiples finesses ne sauraient être assimilées à un banal bout-à-bout de morceaux. Death On The Carousel, qui garde pourtant intact son ténébreux crescendo, s’en trouve métamorphosé. Il faut entendre avec quel brio la source music, ici un orgue aux accents forains, est peu à peu pervertie par les vrilles inquisitrices du London Symphony Orchestra, jusqu’à sombrer dans un dérèglement cacophonique total lorsque, à l’image, les nacelles d’un manège sont projetées dans les airs sous le coup d’une terrible décharge télékinésique.
Il s’en était fallu de peu que les choses ne se gâtent. Par la faute de ces plans incongrus où des figurants enturbannés agitent les bras et vagissent à en perdre haleine, des gloussements réjouis menaçaient de tomber de la bouche du spectateur. Heureusement, Williams veille au grain ! C’est grâce à la force évocatrice de sa musique que l’accident, d’essence indéniablement dramatique, qui ensanglante la joyeuse foire parvient à se jouer du ridicule avec lequel De Palma ne rechigne guère à frayer. Et c’est bien à lui, une fois encore, qu’une autre scène cruciale de The Fury, oscillant en permanence sur le fil du rasoir, doit de ne jamais trébucher. A l’instar du célèbre final de The Untouchables (Les Incorruptibles), qu’il tournera presque dix ans plus tard, Brian De Palma prend le parti dans Gillian’s Escape de filmer intégralement au ralenti la fuite d’Amy Irving, tandis que gravite autour d’elle une myriade d’actions annexes, entrelacées comme sur une piste de danse… ou comme dans un rêve. L’étrange texture du résultat est de celles dont on fait les songes les plus évanescents autant que les cauchemars impossibles à briser. Et le compositeur, à l’évidence envoûté, s’immerge sans retenue dans cette chimère. Les cordes, majoritairement présentes, passent par presque tous les états concevables, d’abord fugues d’une délicieuse légèreté puis vibratos où perce une colère impuissante.
Pas la peine de vous faire un dessin : dans The Fury, la lumière est une denrée rare. Les ombres qui rampent avec avidité à l’intérieur de Gillian’s Escape ne font d’ailleurs qu’une bouchée des réminiscences chétives de For Gillian, délicieuse sucrerie conduite à un trot espiègle, ou de la jolie petite mélodie révélée par le hautbois de Hester’s Theme. La mélancolie qui sourd doucement de Remembering Robin, alors que Kirk Douglas se raccroche tant qu’il peut au souvenir de jours plus heureux, est le dernier trompe-l’œil à se désagréger sous la tyrannie des envolées macabres. L’angoisse chevillée au corps, assaillie d’effroyables projections mentales dans Vision On The Stairs et Gillian’s Vision, Amy Irving ne peut échapper à l’entonnoir du cyclone symphonique s’abattant sur elle. Et lorsque le fameux theremin «herrmannien» réapparait sournoisement, quand le thème principal se répand telle une encre opaque et que l’horreur connaît une graduation tout en dents ébréchées, c’est une partition antérieure de Williams qui vient tout à coup à l’esprit. Evidemment pas Star Wars et ses fanfares galactiques, ni même le célèbre motif de deux notes d’un certain squale glouton, dont la parenté grinçante avec les coups de couteau de Psycho n’a échappé à personne. Non, les honneurs reviennent aux plus discordantes saillies du tragi-comique Family Plot (Complot de Famille), qui se trouve être, parce que l’on éprouvera quelque difficulté à appeler un hasard, la musique écrite pour le film testament d’Alfred Hitchcock.
On se plait à imaginer Brian De Palma sur le strapontin d’une salle obscure, la mine déconfite face au mécanisme laborieux du tout dernier effort de son maître à penser, mais dressant néanmoins une oreille appréciatrice à chacun des violents sursauts dont le score est friand. Vision d’autant plus tentante qu’elle suffirait à dissiper l’illusion, peut-être alimentée bien malencontreusement par ces lignes, selon laquelle John Williams n’aurait soumis sa maestria qu’à l’exercice ingrat du copier-coller. Si hommage est rendu sans nulle ambigüité à Herrmann, l’une des plus importantes figures musicales qu’ait jamais connues Hollywood, The Fury appartient tout aussi incontestablement à Williams. Il a injecté dans cette partition toute la magnificence harmonique, toutes les épatantes cassures de ton et de rythme, toute la générosité et la passion dévorante qui l’ont propulsé, à l’instar de son illustre modèle, dans les constellations ouvertes seulement à l’élite. Et cette entreprise profondément personnelle trouve l’un de ses points culminants avec le somptueux Epilogue, exclusivité précieuse de la version album où le pupitre des cordes, louant une dernière fois la splendeur vénéneuse du Main Title, abasourdit par son lyrisme déchirant. Un seul terme vient aux lèvres devant tant de beauté, que l’on hésite malgré tout à employer après qu’il ait été galvaudé par des générations de critiques à l’emporte-pièce… Mais diable, on serait bien sot d’en faire l’économie pour de si pusillanimes raisons, alors claironnons-le d’une voix de stentor : The Fury est un chef-d’œuvre !