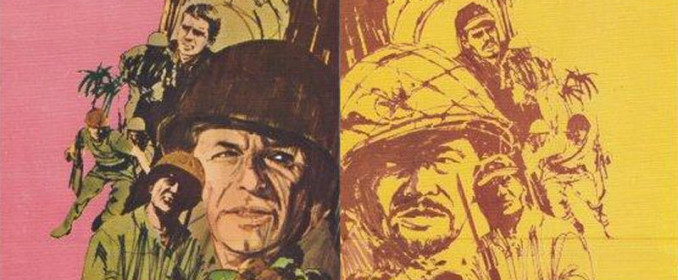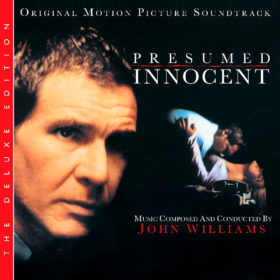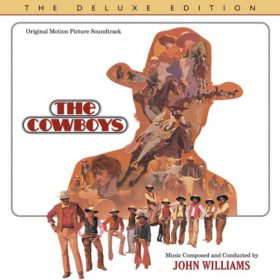STAR WARS: RETURN OF THE JEDI (1983)
Réalisateur : Richard Marquand
Compositeur : John Williams
Séquence décryptée : Dark Vader’s Death (1:59:50 – 2:01:59)
Éditeur : BMG Classics / RCA Victor
Ingrat et patibulaire, le cinéma fantastique ? Bien au contraire, on l’a très souvent connu bonne pâte. Combien de fois a-t-il rassasié avec obligeance notre curiosité, en révélant ce que cachaient les masques portés par certains de ses personnages emblématiques ? Suffisamment, en tout cas, pour que les vieux routards du genre sachent à quoi s’en tenir. Du Fantôme de l’Opéra aux boogeymen increvables des années 80, les faciès dévoilés rivalisent à tout coup de hideur purulente et de balafres grossières. Au final, on dénombre autant de stigmates sur ces visages labourés que de réactions diverses dans les rangs du public, ces dernières oscillant entre terreur, révulsion hoquetante et hilarité bien involontairement provoquée. Mais le cas Darth Vader ne s’insère dans aucune de ces alvéoles émotionnelles. L’instant fatidique où lui est ôté son casque, symbole ténébreux de la tyrannie oppressant les étoiles, ne s’accompagne pas de la grandiloquence à moitié attendue. On ne saurait même en être plus éloigné.
Maître-mot : sobriété. D’aucuns parleraient même plutôt de pantouflardise, à voir Richard Marquand organiser en champs-contrechamps placides le dernier face-à-face entre Luke Skywalker et son père moribond. Le parti-pris, quoi qu’il en soit, est suivi sans rechigner par John Williams, que l’on n’imaginait pas, lui encore moins que le réalisateur, sur un terrain aussi peu fracassant. Sa fameuse Imperial March, inextricablement liée au seigneur du mal, gorgée de cuivres ombrageux et sans réplique, avait surtout adopté comme trait saillant une totale absence de discrétion. La voici pourtant réduite au silence ou, à tout le moins, rapetissée à des dimensions quasi solistes, qui substituent aux démonstrations de force du London Symphony Orchestra une sensibilité nue. Ayant trouvé in extremis la voie de la rédemption, Vader veut profiter de l’ultime étincelle de vie, qu’il sent décliner en lui, pour contempler son fils de ses propres yeux. Le visage blême, cadavéreux, entraperçu au détour d’un plan fugitif de The Empire Strikes Back, apparait enfin dans toute son horreur. Mais sa découverte, longtemps fantasmée, n’inspire nul effroi, rien qu’une terrible pitié dont les cordes engendrent l’écho aigu et navré.
Autre mot-clef : pudeur. En lieu et place d’emportements mélos, Luke ne peut que serrer timidement l’épaule de ce père qu’il avait rejeté de toutes ses forces autrefois. A l’enfant qu’il n’a jamais connu, celui qui s’est un jour prénommé Anakin adresse un sourire vacillant, le premier esquissé par ses lèvres brûlées depuis la naissance de son alter ego maléfique. Impossible miracle, son thème tripartite, sculpté dans l’ébène la plus arrogante, renonce alors à son essence martiale pour s’ouvrir, un peu gauche mais désespérément sincère, à la tendresse. John Williams passe la muselière aux hordes de cuivres qu’on eût juré intrinsèques au chevalier noir de l’Empire, et avec la ligne gracile d’une flûte, le jeu tout aussi délicat de la clarinette, trois fois rien en somme, il réussit l’impensable. Le tour de force, ici, tenant à ce que cette redistribution incroyablement culottée des cartes instrumentales ne donne jamais le sentiment d’une volte-face trop hâtive pour être honnête, ni d’un putsch lacrymal allant bon train avec ses gros sabots. Pour le compositeur, il est hors de question de procéder à de menues tricheries avec l’imposante stature de Vador, encore moins de duper un public acquis à sa faconde symphonique. Il ne veut que découvrir à son tour, sans brusquerie aucune, la pathétique vérité profondément enfouie sous le fameux masque noir.
Dans Star Wars comme dans bien des fables morales ou des contes nimbés de mythologie, la rédemption ne peut s’accomplir qu’à travers l’oubli redouté de la mort. Mais ce n’est pas la peur qui embrume le regard de Vader, plutôt une fatigue écrasante, trop lourde pour être encore combattue, et surtout le soulagement de se voir libéré du fardeau d’un orgueil qui, jadis, empoisonna son cœur. C’est cette mélancolie douce-amère que laisse flotter la voix déjà lointaine du cor, circonscrite à quelques notes poignantes d’où semblent surgir les visions rayées de bruine d’une procession funéraire. On croit discerner là des profils voûtés, des visages graves luttant contre les larmes. Au sein de cette assemblée muette jaillie dans notre esprit se découpent les traits familiers de Luke, ce personnage tragique, condamné à porter le poids des erreurs commises par ses pères de substitution autant que par son véritable géniteur. Celui-ci, enfin, expire sous ses yeux. Et s’il tend l’oreille en cet instant, peut-être le jeune homme parviendra-t-il à saisir la plainte d’une harpe esseulée, qui se meurt doucement : les sanglots d’une âme souillée mais repentante. Ou le dernier soupir exhalé par l’un des plus célèbres thèmes qu’ait jamais enfanté le cinéma.