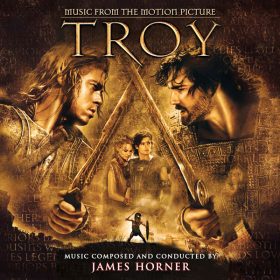La partition composée par James Horner en 1988 pour Willow, film de Ron Howard écrit et produit par George Lucas, s’avère particulièrement intéressante lorsqu’on considère l’approche qu’adopte le compositeur d’un univers familier au spectateur, celui du merveilleux et de l’aventure que Lucas lui-même avait ressuscité dix ans plus tôt avec Star Wars (La Guerre des Etoiles).
Dans sa partition pour Star Wars, John Williams avait choisi de créer un lien de familiarité avec le spectateur grâce à des univers musicaux disparates propres à la musique de concert et à l’histoire du cinéma : le style flamboyant d’Erich Wolfgang Korngold pour les films de cape et d’épée du couple Michael Curtiz / Errol Flynn, les rythmes et harmonies «païennes» du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, la Symphonie en Trois Mouvements du même Stravinsky, Battle Of Britain (La Bataille d’Angleterre) de William Walton,…Ces univers distincts, à l’image des univers propres au cinéma de genre qui parsèment le film (film de samouraï, western, film de guerre, comédie «slapstick»…), sont unifiés par le style personnel du compositeur et les thèmes qu’ils composent, capables de donner au film une identité cohérente. Ces thèmes font désormais partie de la mémoire musicale collective des spectateurs du monde entier.
 La démarche de James Horner s’approche de celle de John Williams dans la manière d’évoquer des résonances avec des univers culturels plus ou moins familiers, mais leur identification par le spectateur opère de façon différente de celle de son aîné. Il faut tout d’abord revenir sur la méthode propre au compositeur de composer pour le grand écran. Il fait partie de ces musiciens dont l’élément primordial est avant tout la couleur instrumentale. Dans cette approche purement intuitive et subjective, l’univers du film évoquera chez le compositeur des ensembles d’instruments, aussi bien les composants de l’orchestre classique, mais aussi les instruments ethniques ou propres au folklore. La palette instrumentale est l’intuition originelle, la démarche thématique, elle, vient en second, et est souvent très rapide chez le compositeur (les thèmes ne sont pas forcément de grands thèmes développés sur quatre mesures mais plutôt des identifications mélodiques fortes). Encore une fois, l’intuition prime avant toute approche «cérébrale». Même dans son utilisation des techniques d’avant-garde, Horner n’a jamais été un cérébral : pas de technique sérielle ou d’obsession moderniste dans ses partitions, ni de goûts immodérés pour des contrepoints excessivement complexes. C’est le cas par exemple dans son utilisation réussie dans Aliens des techniques bruitistes de Penderecki, compositeur considéré alors par les leaders de l’avant-garde comme «sensualiste». L’approche d’un Howard Shore, par exemple, compositeur attitré de David Cronenberg et de la trilogie de The Lord Of The Rings (Le Seigneur des Anneaux), est beaucoup plus basée sur le travail thématique et contrapuntique, sans intuition première pour la couleur instrumentale.
La démarche de James Horner s’approche de celle de John Williams dans la manière d’évoquer des résonances avec des univers culturels plus ou moins familiers, mais leur identification par le spectateur opère de façon différente de celle de son aîné. Il faut tout d’abord revenir sur la méthode propre au compositeur de composer pour le grand écran. Il fait partie de ces musiciens dont l’élément primordial est avant tout la couleur instrumentale. Dans cette approche purement intuitive et subjective, l’univers du film évoquera chez le compositeur des ensembles d’instruments, aussi bien les composants de l’orchestre classique, mais aussi les instruments ethniques ou propres au folklore. La palette instrumentale est l’intuition originelle, la démarche thématique, elle, vient en second, et est souvent très rapide chez le compositeur (les thèmes ne sont pas forcément de grands thèmes développés sur quatre mesures mais plutôt des identifications mélodiques fortes). Encore une fois, l’intuition prime avant toute approche «cérébrale». Même dans son utilisation des techniques d’avant-garde, Horner n’a jamais été un cérébral : pas de technique sérielle ou d’obsession moderniste dans ses partitions, ni de goûts immodérés pour des contrepoints excessivement complexes. C’est le cas par exemple dans son utilisation réussie dans Aliens des techniques bruitistes de Penderecki, compositeur considéré alors par les leaders de l’avant-garde comme «sensualiste». L’approche d’un Howard Shore, par exemple, compositeur attitré de David Cronenberg et de la trilogie de The Lord Of The Rings (Le Seigneur des Anneaux), est beaucoup plus basée sur le travail thématique et contrapuntique, sans intuition première pour la couleur instrumentale.
 L’identification entre palette instrumentale et couleurs musicales (harmoniques, mélodiques, rythmiques) peut également se traduire par la migration d’éléments issus du répertoire intime du compositeur, notamment Prokofiev, Benjamin Britten, la musique russe ou le répertoire classique de façon plus large, qu’il n’hésite pas à introduire dans ses partitions dans un esprit de complémentarité musicale ou de contrepoint à l’image. L’effet produit peut être émotionnel, musical, dramatique, philosophique, ou tout cela à la fois. En matière de couleurs instrumentales, une partition phare permet de comprendre ce goût persistant du compositeur pour les instruments folkloriques, celle de The Mission (Mission) composée en 1986 par Ennio Morricone, deux ans avant Willow. Œuvre majeure dans la carrière du maestro italien, The Mission marie avec bonheur le XXème siècle et le XVIème siècle, la culture occidentale et la culture amérindienne. Morricone avait fait appel au groupe Incantation pour la partie dévolue aux instruments ethniques. C’est ce même groupe qui joue dans Willow, et James Horner a fait régulièrement appel à ses membres depuis, surtout l’instrumentiste Tony Hinnigan. Avec le film comme canevas, le compositeur peut traduire en musique les intentions des cinéastes mais aussi ses propres émotions. Il répond aux exigences dramatiques et techniques particulières de ce médium, mais peut également y apporter sa touche personnelle dans le choix des approches musicales : style d’écriture, choix des instruments, nuances du jeu des solistes et de la direction d’orchestre, citations, évocations.
L’identification entre palette instrumentale et couleurs musicales (harmoniques, mélodiques, rythmiques) peut également se traduire par la migration d’éléments issus du répertoire intime du compositeur, notamment Prokofiev, Benjamin Britten, la musique russe ou le répertoire classique de façon plus large, qu’il n’hésite pas à introduire dans ses partitions dans un esprit de complémentarité musicale ou de contrepoint à l’image. L’effet produit peut être émotionnel, musical, dramatique, philosophique, ou tout cela à la fois. En matière de couleurs instrumentales, une partition phare permet de comprendre ce goût persistant du compositeur pour les instruments folkloriques, celle de The Mission (Mission) composée en 1986 par Ennio Morricone, deux ans avant Willow. Œuvre majeure dans la carrière du maestro italien, The Mission marie avec bonheur le XXème siècle et le XVIème siècle, la culture occidentale et la culture amérindienne. Morricone avait fait appel au groupe Incantation pour la partie dévolue aux instruments ethniques. C’est ce même groupe qui joue dans Willow, et James Horner a fait régulièrement appel à ses membres depuis, surtout l’instrumentiste Tony Hinnigan. Avec le film comme canevas, le compositeur peut traduire en musique les intentions des cinéastes mais aussi ses propres émotions. Il répond aux exigences dramatiques et techniques particulières de ce médium, mais peut également y apporter sa touche personnelle dans le choix des approches musicales : style d’écriture, choix des instruments, nuances du jeu des solistes et de la direction d’orchestre, citations, évocations.
 Le contexte culturel a donc, comme pour Star Wars, une grande importance pour Willow. Une des caractéristiques de la culture populaire américaine n’est-elle pas cette capacité à intégrer des éléments du patrimoine européen ou mondial, et de les sublimer dans un nouvel ensemble cohérent, dans un monde qui a le potentiel de redevenir universel. C’est une force chez Disney tout comme chez George Lucas, malgré la différence d’époque. A partir de ce matériau filmique et culturel, le compositeur a bâtit sa partition en répondant aux exigences fondamentales du récit merveilleux d’aventure : identification du Bien et du Mal et caractérisations des personnages emblématiques incarnant une qualité (Force, Sagesse, Ingénuité, Sensualité…). James Horner fait sans cesse référence à l’art de la peinture comme parallèle à sa démarche de compositeur pour l’image. A la fois pour faire comprendre la permanence de son style très caractéristique, comme l’est la série des Nymphéas de Claude Monet (on reconnaît son style en quelques mesures, mais aussi dans l’utilisation de figures d’écriture récurrentes, d’instruments fétiches), mais aussi dans sa volonté de composer une toile abstraite où rivalisent les couleurs et les époques tout en respectant la nature profonde du récit, lui donnant une dimension métaphysique ou philosophique.
Le contexte culturel a donc, comme pour Star Wars, une grande importance pour Willow. Une des caractéristiques de la culture populaire américaine n’est-elle pas cette capacité à intégrer des éléments du patrimoine européen ou mondial, et de les sublimer dans un nouvel ensemble cohérent, dans un monde qui a le potentiel de redevenir universel. C’est une force chez Disney tout comme chez George Lucas, malgré la différence d’époque. A partir de ce matériau filmique et culturel, le compositeur a bâtit sa partition en répondant aux exigences fondamentales du récit merveilleux d’aventure : identification du Bien et du Mal et caractérisations des personnages emblématiques incarnant une qualité (Force, Sagesse, Ingénuité, Sensualité…). James Horner fait sans cesse référence à l’art de la peinture comme parallèle à sa démarche de compositeur pour l’image. A la fois pour faire comprendre la permanence de son style très caractéristique, comme l’est la série des Nymphéas de Claude Monet (on reconnaît son style en quelques mesures, mais aussi dans l’utilisation de figures d’écriture récurrentes, d’instruments fétiches), mais aussi dans sa volonté de composer une toile abstraite où rivalisent les couleurs et les époques tout en respectant la nature profonde du récit, lui donnant une dimension métaphysique ou philosophique.
 L’ouverture du film exprime bien l’enjeu fondamental du film (et de tout conte merveilleux) : la rivalité des forces de l’ombre et celles de la lumière. Elle dépeint la naissance, dans les geôles même de la Reine maléfique, de l’enfant de la prophétie qui est supposé mettre fin à son règne de terreur. L’enjeu est de taille, il s’agit donc de préserver l’espoir, la vie au sein des ténèbres. Musicalement, cela se traduit par la rivalité des textures dans l’orchestre : l’omnipotence du Mal par une musique macabre et ce motif du destin de quatre notes (on pense à l’ouverture implacable de la première symphonie de Rachmaninov), cuivres, basses ; et les contre forces de l’espoir et de la lumière (pureté des voix d’enfants associée à l’enfant sauveur, aux fées, à la magie ; thème naïf du générique). Le compositeur donne une dimension métaphysique à la scène en incluant une courte figure d’écriture caractéristique de la musique religieuse du XVIIIème, que l’on peut retrouver dans les œuvres sacrées de Vivaldi, mais qui évoque surtout la quasi-prière funèbre qui compose la deuxième partie du Confutatis Maledictis du Requiem de Mozart, décrit ainsi par Jean-Victor Hocquard : «D’une part les forces obscures (les réprouvés : Confutatis Maledictis) dont le démonisme vient pesamment buter sur de terribles «Thesis» au sein de la tempête (…) ; d’autre part le monde lumineux des voix de soprani qui expriment l’infléchissement apaisant de la lumière d’en haut». Au moment crucial du dénouement, dans le dernier tiers du film, l’orchestre entame un scherzo évoquant la première partie du Confutatis, la partie terrifiante, presque apocalyptique que voulait évoquer Mozart.
L’ouverture du film exprime bien l’enjeu fondamental du film (et de tout conte merveilleux) : la rivalité des forces de l’ombre et celles de la lumière. Elle dépeint la naissance, dans les geôles même de la Reine maléfique, de l’enfant de la prophétie qui est supposé mettre fin à son règne de terreur. L’enjeu est de taille, il s’agit donc de préserver l’espoir, la vie au sein des ténèbres. Musicalement, cela se traduit par la rivalité des textures dans l’orchestre : l’omnipotence du Mal par une musique macabre et ce motif du destin de quatre notes (on pense à l’ouverture implacable de la première symphonie de Rachmaninov), cuivres, basses ; et les contre forces de l’espoir et de la lumière (pureté des voix d’enfants associée à l’enfant sauveur, aux fées, à la magie ; thème naïf du générique). Le compositeur donne une dimension métaphysique à la scène en incluant une courte figure d’écriture caractéristique de la musique religieuse du XVIIIème, que l’on peut retrouver dans les œuvres sacrées de Vivaldi, mais qui évoque surtout la quasi-prière funèbre qui compose la deuxième partie du Confutatis Maledictis du Requiem de Mozart, décrit ainsi par Jean-Victor Hocquard : «D’une part les forces obscures (les réprouvés : Confutatis Maledictis) dont le démonisme vient pesamment buter sur de terribles «Thesis» au sein de la tempête (…) ; d’autre part le monde lumineux des voix de soprani qui expriment l’infléchissement apaisant de la lumière d’en haut». Au moment crucial du dénouement, dans le dernier tiers du film, l’orchestre entame un scherzo évoquant la première partie du Confutatis, la partie terrifiante, presque apocalyptique que voulait évoquer Mozart.
 L’ironie du mode héroïque est incarnée par le personnage interprété par Val Kilmer, baroudeur et voleur habile sans conscience morale. Le personnage gagnera en noblesse par l’affection qu’il porte pour l’orpheline salvatrice, le désir sexuel qu’il ressent pour la fille de la reine maléfique prise en otage et enfin son habileté au maniement de l’épée dans le but de faire triompher les forces du Bien. Pour caractériser à la fois l’héroïsme et l’ironie de ce personnage, James Horner construit un thème de cinq notes puis deux encerclant les fameuses triples du Lebhaft de la Symphonie Rhénane de Robert Schumann, puise à la fois dans la source mythologique (le Vater Rhein, divinité tutélaire, chère au jeune Schumann, élément central des récits des Nibelungen) et transmute toute la pompe solennelle, la démarche lourde, empesée et le sérieux germanique du mouvement de la symphonie en un thème exprimant l’héroïsme enfantin du récit. Plus loin dans le film, dans la scène du départ des nains, qui pourrait tout aussi bien être issue du Bilbo le Hobbit de JRR Tolkien, le compositeur évoque le folklore du Peer Gynt de Edvard Grieg, autre récit mythologique mis en musique de manière mémorable par le compositeur norvégien, à travers un ensemble d’instruments folkloriques.
L’ironie du mode héroïque est incarnée par le personnage interprété par Val Kilmer, baroudeur et voleur habile sans conscience morale. Le personnage gagnera en noblesse par l’affection qu’il porte pour l’orpheline salvatrice, le désir sexuel qu’il ressent pour la fille de la reine maléfique prise en otage et enfin son habileté au maniement de l’épée dans le but de faire triompher les forces du Bien. Pour caractériser à la fois l’héroïsme et l’ironie de ce personnage, James Horner construit un thème de cinq notes puis deux encerclant les fameuses triples du Lebhaft de la Symphonie Rhénane de Robert Schumann, puise à la fois dans la source mythologique (le Vater Rhein, divinité tutélaire, chère au jeune Schumann, élément central des récits des Nibelungen) et transmute toute la pompe solennelle, la démarche lourde, empesée et le sérieux germanique du mouvement de la symphonie en un thème exprimant l’héroïsme enfantin du récit. Plus loin dans le film, dans la scène du départ des nains, qui pourrait tout aussi bien être issue du Bilbo le Hobbit de JRR Tolkien, le compositeur évoque le folklore du Peer Gynt de Edvard Grieg, autre récit mythologique mis en musique de manière mémorable par le compositeur norvégien, à travers un ensemble d’instruments folkloriques.
 L’omniprésence de la musique, son aspect parfois imitatif la lie au rôle traditionnel dévolu aux partitions symphoniques de la tradition épique américaine. L’architecture de la partition repose fondamentalement sur l’affrontement des forces en puissance, d’un côté les personnages hétéroclites qui composent le groupe héroïque (d’où une multitude de thèmes les caractérisant, thème héroïque de Madmartigan, thème noble de Willow, berceuse de l’enfant miracle Elora Danan, thème d’amour entre Madmartigan et Sasha – souvent traité sur le mode ironique – et des instruments issus essentiellement du folklore irlandais), forcés de s’unir pour affronter les forces du Mal, qui sont musicalement plus massives et monolithiques par l’emploi d’un thème «maléfique» récurrent et des couleurs musicales typiques de la musique symphonique russe, notamment le Prokofiev de Alexander Nevsky ou de la Cantate d’Octobre (cette dernière œuvre étant pratiquement inconnue en 1988 pour l’oreille occidentale) et l’utilisation des sons perçants du shakuhachi japonais.
L’omniprésence de la musique, son aspect parfois imitatif la lie au rôle traditionnel dévolu aux partitions symphoniques de la tradition épique américaine. L’architecture de la partition repose fondamentalement sur l’affrontement des forces en puissance, d’un côté les personnages hétéroclites qui composent le groupe héroïque (d’où une multitude de thèmes les caractérisant, thème héroïque de Madmartigan, thème noble de Willow, berceuse de l’enfant miracle Elora Danan, thème d’amour entre Madmartigan et Sasha – souvent traité sur le mode ironique – et des instruments issus essentiellement du folklore irlandais), forcés de s’unir pour affronter les forces du Mal, qui sont musicalement plus massives et monolithiques par l’emploi d’un thème «maléfique» récurrent et des couleurs musicales typiques de la musique symphonique russe, notamment le Prokofiev de Alexander Nevsky ou de la Cantate d’Octobre (cette dernière œuvre étant pratiquement inconnue en 1988 pour l’oreille occidentale) et l’utilisation des sons perçants du shakuhachi japonais.
La limite de cette approche, qui caractérise beaucoup de partitions de James Horner, est son côté répétitif ou systématique, l’emploi de couleurs récurrentes issues du langage symphonique de Prokofiev, Britten ou Chostakovitch par exemple, de motifs tel que le motif «diabolique» de quatre notes qui sera employé avec force dans Enemy At The Gates (Stalingrad) ou la partition de remplacement de dernière minute composée en 2004 pour Troy (Troie). Pourtant ces figures de style s’intègrent parfaitement dans le tissu musical des partitions, qui restent marquées par le style très personnel du compositeur et sa capacité à hausser émotionnellement le substrat du récit filmique en s’adressant à la fois au public averti et non averti. L’intérêt vient du sens qu’il donne aux éléments hétérogènes intégrés de façon parfaitement fluide dans le discours symphonique. Une manière qui rappelle immédiatement les pratiques de Dmitri Chostakovitch lui-même dans ses fresques symphoniques ou ses partitions pour le grand écran.