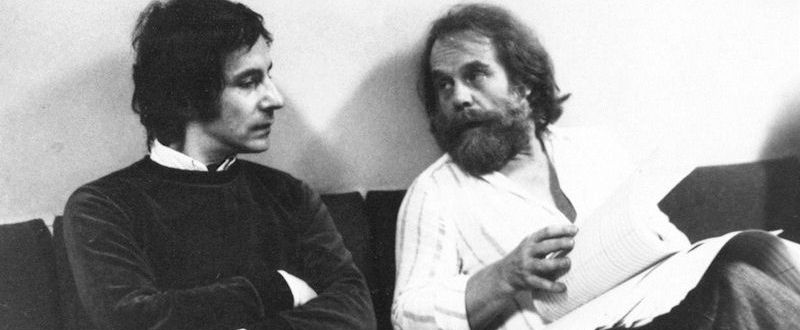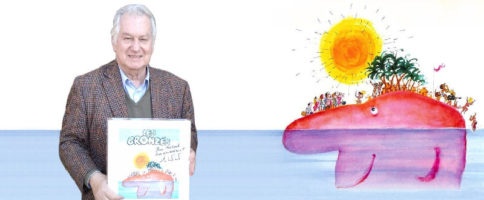Les années 90 ouvrent à Eric Demarsan de nouvelles perspectives à travers de nombreuses collaborations pour le petit écran, de Pierre Granier-Deferre à Jacques Deray en passant par La Légende des Sciences de Robert Pansard-Besson et, plus récemment, les séries prestigieuses d’Hervé Hadmar telles que Les Oubliées, Pigalle la Nuit et Signature. Tout cela, bien entendu, sans abandonner totalement le cinéma, comme en témoignent ses compositions pour les films de Guillaume Nicloux.
A partir du début des années 90, tu as commencé à beaucoup travailler pour la télévision…
Je ne suis pas une vedette, je ne suis pas une star. Les gens comme moi ont des hauts et des bas, et à cette époque, j’ai du avoir un bas et je me suis retrouvé à faire un peu de télévision. J’ai quand même choisi ce que je voulais faire en télé, parce qu’il y a des choses que je ne ferais jamais. Mais j’ai eu la chance de faire des choses assez intéressantes, avec des gens intéressants, pour Pierre Granier-Deferre, Jacques Deray… C’était plutôt des films de cinéma écrits pour la télé.
Granier-Deferre, c’était pour La Dernière Fête ? Tu avais travaillé pour son fils avant, pour deux téléfilms…
Oui, mais ce n’est pas du tout par son fils que je suis arrivé à lui. C’est parce que je le connaissais depuis très longtemps, on se croisait quand je travaillais à Guyancourt, sur des films différents, et je lui disais : « Bonjour, toujours Sarde ? » et il me répondait : « Toujours Sarde ! » Et un jour, je crois que c’est lui qui m’a appelé, et il m’a dit : « On n’a jamais travaillé ensemble, est-ce que tu veux faire La Dernière Fête ? » J’ai répondu : « Avec grand plaisir ! » J’aimais beaucoup Granier-Deferre, c’était un type que j’adorais. J’aimais cette faconde qu’il avait alors qu’en même temps, il était un peu discret… Il avait une gueule folle avec son cigare. Je suis allé plusieurs fois sur le plateau de La Dernière Fête, et la première fois où j’y suis allé, je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas de la télé ça ! » Il m’a dit : « Mais qu’est-ce que tu crois ? A la télé, je fais du cinéma ! » Il avait plusieurs caméras, un décor magnifique dans un château… Quand tu vois un mec comme ça, ça te pousse à écrire une belle musique. La productrice m’avait donné assez de moyens pour le faire. Ce n’était pas vraiment une musique d’époque, mais quand même un peu. On l’avait enregistrée à Varsovie. En tout cas, avec Deray, ce sont deux metteurs en scènes avec qui je n’avais jamais travaillé au cinéma, que je connaissais depuis longtemps, deux personnages pour qui j’avais beaucoup d’admiration, qui m’ont chacun appelé pour faire de la télé. Mais ça aurait pu être du cinéma.
Tu as donc continué à composer à la télé comme si tu écrivais pour le cinéma ?
Oui, absolument, et tout ce qu’on me proposait où il n’y avait pas de budget, ou bien où l’on me demandait de faire de la musique de télé, je refusais systématiquement.
Et la musique de La Légende des Sciences ?
C’était toujours pour la télé, mais c’était assez spécial parce que c’était une série d’émissions initiées par Michel Serres sur la vulgarisation de la science. C’était une sorte de docu-fiction. Là, j’avais un metteur en scène fou – je le dis car on a eu beaucoup d’empoignades tous les deux – mais on s’est bien aimés aussi, et on a bien travaillé. Il y a un côté très positif quand je dis fou : lui, ce qu’il voulait, c’était six ou huit thèmes différents qu’il monterait comme il voudrait. J’écrivais les thèmes et j’allais les jouer chez lui. Ce n’est pas un musicien, je ne sais pas si c’est quelqu’un de mélomane, en tout cas c’est quelqu’un d’inspiré, et quand je jouais, il me disait : « Non, non, là tu dois continuer à monter, monte encore, monte encore ! » et je montais d’une note, d’une note… et il me disait : « Oui, oui, oui c’est comme ça ! » C’était incroyable ! Ça ne m’est arrivé qu’une fois dans ma vie d’avoir un mec comme ça, qui sentait qu’il voulait aller quelque part, mais qui ne savait pas l’écrire lui-même. Malgré bien des empoignades qu’on a pu avoir – qui n’étaient pas très drôles – ça, j’en ai un super souvenir ! Et ma composition, franchement, s’en ressent. Il m’a donné son souffle : je ne serais pas allé aussi loin dans le lyrisme, par moments, sur certains thèmes de cette série… Ça m’a permis de faire quelque chose de beau.
Vous êtes allés à Moscou pour enregistrer : ça s’est passé comment là-bas ?
Ça s’est très bien passé avec les musiciens, et avec le chef, que je ne connaissais pas mais qui était génial, mais plutôt mal passé avec le metteur en scène. J’avais écrit pour un orchestre symphonique et lui, à chaque fois qu’on jouait un morceau, il voulait une version dans laquelle on retirait les bois et les cuivres : il ne voulait que les cordes. Il y a eu des engueulades, mais ça s’est bien terminé.
Il y avait un orchestre pluttôt imposant, ce qui est assez rare pour la TV…
Oui, je crois qu’ils étaient 90. Le metteur en scène, c’était un mégalomane : il a titillé tout le monde, le producteur, l’éditeur… Il y allait à fond. Il voulait ça et ça tombait bien parce que moi je le voulais aussi. Il les a vraiment bousculés pour avoir ce qu’il voulait… On a eu de belles séances ! J’ai au moins dix mails par mois qui me demandent où on peut trouver cette musique. Ça vaudrait le coup de la ressortir.
Comment t’es-tu retrouvé à travailler avec Guillaume Nicloux en 2002 pour Une Affaire Privée ?
Il faut que je rende hommage à Stéphane Lerouge. J’ai ouvert la collection de musique de film chez Universal, puisque L’Armée des Ombres était le premier numéro, et Guillaume a écouté cette musique, parce que dans son scénario, il avait mis que Thierry Lhermite regarde L’Armée des Ombres à un moment à la télévision. Guillaume a cherché le compositeur, il a écouté le disque et il a dit « C’est lui que je veux ! » C’est comme ça qu’on a commencé à travailler ensemble.
Comment avez-vous collaboré sur ce premier film?
Guillaume est quelqu’un de très mélomane, très intelligent et très fin. Ce qu’il adore surtout, c’est la musique dans le style d’Arvo Pärt : il m’en a rebattu les oreilles pour tous les films qu’on a fait ensemble. Moi, ça m’a éclairé aussi, parce que c’est vrai que cet esprit de musique, avec ses longues tenues, ces choses qui planent et ne bougent presque pas, ça va très bien sur le polar et ce genre de films. Ça s’est très bien passé, il a été content, moi j’ai été super content aussi, et après ça a donné lieu à d’autres films avec lui.
Tu t’es donc retrouvé de nouveau dans l’univers du polar que tu avais exploré, trente ans avant, avec Melville ?
Oui, mais ce n’était pas du tout le même genre de musique que j’avais fait pour Melville. Avec Guillaume, c’est un style de polar qui tendrait plus vers Howard Shore que vers John Lewis. C’est plus classique, dans la mesure où ce n’est pas jazz.
Est-ce que votre collaboration a évolué, ou avez-vous continué à travailler ensemble de la même façon ?
Non, on a travaillé à peu près de la même façon, sauf sur un film de commande, Le Concile de Pierre, où l’univers sonore était complètement différent des films que lui avait écrits.
Nicloux étant aussi un romancier, est-ce que ça a un impact sur sa façon de concevoir la musique à l’image ?
Je pense que oui. C’est quelqu’un qui écrit avec de la musique dans les oreilles tout le temps. Pas seulement un style de musique : il écrit avec n’importe quel style de musique. Je pense qu’au final la musique a pour lui une grande importance.
D’une certaine façon, il te laisse moins de liberté ?
Oui, il est plus directif. Mais je trouve ça bien. Je préfère quelqu’un qui me dit : « Voilà ce que je voudrais » plutôt que quelqu’un qui me dit : « C’est ton métier, tu fais comme tu veux » et qui, une fois que tu as écrit, te dit : « Non, ce n’est pas ça ! »
Les dernières réalisations de Nicloux se sont faites sans ta musique. Pourquoi ?
Pour La Clef, il n’avait pas envie de mettre de musique originale, il ne voulait mettre que des musiques de source. C’est son choix. Moi j’aurais bien aimé faire la musique, ne serait-ce que pour faire une trilogie, et je pense que ça aurait été bien. Mais lui n’avait pas envie : c’est en cela qu’il a une vraie personnalité et une vraie réflexion sur la musique au cinéma. Dès le départ, il m’a dit : « Non, La Clef, tu ne vas pas le faire parce que je ne veux pas mettre de musique. » Après il s’est un peu fourvoyé dans de la musique de film qui n’est pas de la musique de film… Ça, c’était bien après Le Concile de Pierre. On ne travaille pas ensemble pour le prochain, car c’est une coproduction avec l’Allemagne et des fonds européens, donc les musiciens doivent être allemands…
Comment se fait-il que les coproductions ne soient jamais à l’avantage des français ?
Moi j’ai une petite idée : il y a des postes-clé dans un film, comme par exemple le directeur de la photo, les comédiens, le scénariste, et il faut qu’à ces postes-clé, on trouve des gens que le metteur en scène connait bien. Et le dernier poste-clé existant, c’est la musique… Ah ben zut, tant pis pour la musique ! Je pense qu’il s’assure pour lui des postes qui sont les plus importants, et après il fait des concessions. Le poste musique est important, mais aux yeux du metteur en scène celui de directeur de la photo est plus important, ce que je comprends.
Après Nicloux, tu as commencé à travailler avec Hervé Hadmar : comment vous vous êtes rencontrés ?
On s’est rencontrés par la compagne de mon fils : ils sont tous deux comédiens, et Hervé connaissait Florence et un jour elle lui a dit qu’elle vivait avec un type qui s’appelait Swan Demarsan, et il lui a dit : « Quoi ? Mais qui c’est ? » et elle a répondu : « C’est le fils d’Éric Demarsan. » Et il lui a dit : « Mais moi, j’aimerais bien travailler avec lui ! » On a déjeuné ensemble. Il devait faire un long métrage… Moi j’étais très content aussi de travailler avec ce type qui avait fait un film qu’il n’aime pas du tout, Comme un Poisson Hors de l’Eau, que moi je trouve pas mal du tout, une bonne comédie. Il n’aimait pas ce film et je crois que c’est à cause de ça que, pendant un certain temps, il n’a plus voulu faire de cinéma. Il s’est lancé dans la série et quelque temps après il m’a dit : « Écoute, je ne vais pas faire mon long métrage, mais est-ce que tu serais contre faire de la télé avec moi ? » J’ai dit : « Évidemment que non ! » Et il m’a proposé Les Oubliées. C’était une très belle série, et là on a fait aussi un gros travail de préparation de musique. Lui était plus branché Howard Shore qu’Arvo Pärt : on a beaucoup parlé de la musique de Shore, d’autres musiciens qu’il aime bien, et je lui ai proposé des thèmes dans cet esprit et on a commencé à travailler comme ça.
Pour Les Oubliées, as-tu essayé de compenser le côté gris et pesant du Nord ?
Non, je ne me suis pas attaché à ça. C’est vrai que c’était une image un peu verte, un peu bleue, mais pas triste ni monotone, c’était une belle lumière, donc pour moi ça n’entrait pas en ligne de compte. Je me suis attaché surtout aux personnages, à Gamblin et à sa folie naissante. J’ai essayé de faire que la musique ne soit pas une musique de film normale, mais que ce soit la voix intérieure du héros. D’ailleurs c’est ce que j’ai fait après avec Hervé pour Pigalle, la Nuit. Je trouve que c’est intéressant d’essayer de faire parler un peu l’âme du héros par la musique.
C’est ce que tu as essayé de faire depuis toujours ?
Oui, c’est ça… Enfin, ça s’est aggravé, si je peux dire (rires). Pour moi, c’est une vision de la musique au cinéma, de viser plus ça que de faire de la redondance, et de juste faire de la musique joyeuse quand c’est une comédie, juste de la musique triste quand c’est un drame…
Est-ce pour ça aussi que tu t’appuyais sur le film, plutôt que de t’imprégner de l’ambiance sur les tournages ?
Oui, pendant longtemps, je n’allais pas sur les plateaux parce que je trouvais que tout le côté technique, obligatoire sur un plateau – reprendre une scène 6 fois, 7 fois – me déflorait un peu l’histoire, l’ambiance, les sentiments… Je n’aimais pas trop ça. Je préférais prendre le film en pleine tête à la première projection ou au premier montage. Maintenant, de plus en plus, comme je travaille en effet souvent sur le scénario, ça me permet, une fois que les thèmes sont faits et qu’on sait qu’on ne va plus y toucher – du point de vue de la thématique – d’aller sur les plateaux, de respirer l’ambiance et de trouver des petites choses dans l’instrumentation, des idées, un instrument auquel je n’avais pas pensé et me dire : « Tiens, ça ce serait bien… » Maintenant, j’y vais de plus en plus, sur les plateaux ! Du coup, pour Hervé, je fais une bibliothèque musicale, j’écris la musique pendant le tournage. Ça ne m’était jamais arrivé. En même temps, c’est un autre genre d’exercice, assez amusant quand même à faire. Il faut écrire plus, il faut donner plus de matériau au metteur en scène, donc il faut plusieurs versions du même thème, décliné avec des sensations différentes, des émotions différentes, plus lyrique, plus minimaliste… Mais c’est marrant à faire, et puis lui puise dedans. Pour Signature, je lui ai donné la musique alors qu’il était encore à la Réunion, il avait encore un mois ou un mois et demi de tournage, et il écoutait la musique. Il m’a dit : « J’écoute tout le temps, ou bien je la balance sur le tournage, ou bien je l’ai tellement dans la tête que je tourne avec la musique en tête. » C’est intéressant. Et ça a une influence sur le tempo du film.
Ce n’est pas un peu frustrant de se dire que le monteur musique va faire de ta musique un puzzle à sa façon ?
Tout dépend avec qui on travaille. Tout le monde n’est pas capable de le faire, et de le faire bien. Avec Hervé Hadmar ou Guillaume Nicloux, ce sont des gens qui aiment la musique, la connaissent, donnent au départ des directions musicales. Avec des gens comme ça, c’est bien de le faire. Mais avec des ignares, ce qui arrive aussi, là on peut avoir peur.
Pigalle, la Nuit a été tourné en décor réel. Ça t’a inspiré ?
Avec Pigalle, la Nuit, on a commencé à travailler en amont : au départ, Hervé voulait une formation, je ne dirais pas minimaliste, mais assez réduite, et il pensait plus à une sorte de quartet, de quintet à base de piano et peut-être d’un instrument… On est partis sur cette l’idée que le piano ce serait pour Pigalle le jour et le Fender pour Pigalle la nuit : c’était l’idée un peu grossière. Et puis ça s’est amélioré, j’ai un peu travaillé là-dessus, sur l’instrumentation, et en définitive c’est devenu un peu symphonique quand même ! En fait, de l’idée, je n’ai gardé que les pianos et les Fender. J’ai retiré toute la partie batterie qui aurait pu être rythmique, jazz, et qui n’allait pas du tout dans l’esprit des personnages de Pigalle, la Nuit, qui même n’aurait pas fonctionné du tout sur Pigalle, sur le quartier lui-même. A mon avis, ça n’aurait fait que vieillir un peu l’ambiance et ce n’était pas le but. Il n’est resté que l’idée des deux claviers, et de là, on a élargi. Au bout du compte, on s’est dit : « On a Archie Shepp qui est comédien dans le film, ça serait bien qu’il joue là-dessus ! » et donc on a demandé à Archie s’il jouerait quelques-uns des thèmes, et évidemment il a dit tout de suite oui. Outre son talent, c’est un type extraordinaire, d’une humanité et d’une gentillesse extrême. Il a donc joué certains des thèmes et dans l’ensemble de la musique de cette série, il y a cinq ou six morceaux qui sont joués par lui.
Donc vous aviez un processus créatif différent de ce que tu faisais avant de travailler avec Hadmar ?
Oui et non, parce que j’ai procédé de la même façon sur Le Cercle Rouge, où je suis parti du Modern Jazz Quartet et qu’après je suis allé plus loin. Donc c’est un peu la même chose qui s’est passée là.
Pigalle, la Nuit a rencontré pas mal de succès, c’était une grosse série. Ça t’a amené de nouveaux contacts ?
Non, je n’ai pas forcément écrit plus de musique qu’après avoir fait un film. Ça vient comme ça… Puis on a fait Signature, qui a bien marché aussi, peut-être un peu moins car le format n’était pas le même, c’était six épisodes alors que Pigalle, la Nuit c’était huit. Mais c’était une belle série qui a été bien accueillie aussi.
Signature se passe à la Réunion : est-ce que le côté exotique t’a influencé pour la musique ?
Pas du tout. Et Hadmar ne le voulait pas. Il m’a donné comme indication Morton Feldman : c’est un musicien qui fait presque partie des contemporains et de cette école de musique minimaliste de Steve Reich, Philip Glass… C’est très particulier par rapport à ce que j’avais déjà écrit. Il ne m’a pas demandé d’aller vraiment dans cette direction, mais de réfléchir au personnage, qui est analphabète, pas du tout intellectuel, vraiment sensitif, et il m’a demandé de trouver des sonorités qui étaient presque plus des sonorités de bruitage musical qu’autre chose, comme par exemple du bois qui craque… Je suis donc allé dans ce sens là. Dans Signature, il y a trois thèmes : le thème de la journaliste (Sandrine Bonnaire), le thème de Toman, le héros (Sami Bouajila) et le thème de l’ile de la Réunion. Et en fait le seul thème des trois qui soit un peu mélodique, c’est celui de la journaliste. Le thème de Toman se résout à un accord.
Tu as eu l’occasion de faire jouer ta musique en concert au festival d’Aubagne. Comment ça s’est passé ?
Ça s’est super bien passé ! C’est une première mondiale, la première fois qu’un musicien de cinéma est joué par la Légion Étrangère. Il faut quand même le souligner ! On a réorchestré tout ça avec mon orchestrateur pour l’Harmonie d’Aubagne et j’ai fait pratiquement une heure et demie de concert avec les films les plus importants que j’ai pu faire et qui, en tout cas musicalement, étaient les plus adaptés à l’Harmonie. On a fait des choses assez marrantes, le chef de musique était ravi et moi aussi, ça s’est vraiment très bien passé. La seule chose que je peux regretter c’est qu’il n’y a pas eu de communication sur cet événement qui était une vraie première !
Est-ce que tu peux parler de ton travail avec Stéphane Lerouge pour l’édition de tes musiques chez Universal ?
Mon travail, c’est son travail. Bien sûr, on va en studio pour choisir les morceaux. Stéphane a son idée à l’avance sur des films, mais il y en a où je lui dis : « Non, cette musique, on ne la met pas. » Il y a des musiques que je ne trouve pas forcément bien ou qui vieillissent mal, que je ne souhaite pas mettre.
Tu as aussi travaillé avec Music Box : tu es impliqué dans la production des albums, le choix des morceaux ?
Oui. Music Box, c’est deux personnes que j’aime bien. Un peu comme Stéphane, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand on a fait le CD de Pigalle, la Nuit, je leur ai donné toute la musique et ce sont eux qui ont fait un premier choix. Il n’y a pas eu grand-chose à changer, ils ont bien compris. On a décidé tous les trois ensembles, même si c’est moi qui ai eu le final cut, et ça s’est passé sans problème. Ce sont des gens bien, que j’aime beaucoup.
Au global, il y avait combien de musique dans Pigalle, la Nuit, par rapport à ce qu’il y a au final sur l’album ?
Il devait y avoir trois thèmes principaux, puis de ces thèmes j’ai fait énormément de déclinaisons dans toutes les humeurs, dans tous les sentiments, dans toutes les durées. Il y avait peut-être deux heures de musique, ce qui, avec les différents mixages, a abouti à 4 ou 5 heures. Ce sont vraiment des mixages très différents les uns des autres et on n’a pas l’impression d’avoir déjà entendu le morceau. Ça a été fait et pensé pour que ça fasse quatre heures de musique originale. Sur le disque, il doit y avoir 59 minutes…
Tu disais que tu travaillais pas mal en ce moment pour des films d’étudiants…
Oui. Mon fils est comédien et il a fait un court-métrage pour un copain (dont c’est le troisième court-métrage) avec Philippe Nahon. Moi j’adore Philippe Nahon ! Et comme j’aime mon fils aussi (rires), j’ai dit : « Je suis d’accord pour faire la musique de ce court-métrage ! Mais on va la faire avec les moyens du bord, parce qu’il n’a pas beaucoup d’argent pour ça. Mais oui, on va le faire ! » Et puis il y a un autre jeune metteur en scène qui m’a écrit aussi. J’ai voulu l’aider. Je trouve qu’en plus ce sont deux jolis films. C’est d’ailleurs la troisième fois que je fais de la musique de court-métrage pour des metteurs en scène comme ça. Je ne dis pas que je vais en faire tous les jours, mais quand on peut aider quelqu’un, il faut le faire !
Est-ce que tu peux me donner ta propre définition de la musique de film ?
En synthétique du synthétique, je dirais que la musique d’un film, c’est le scénario parallèle du film. Cela ne veut pas dire faire de la redondance, mais je pense que la musique d’un film, c’est la musique du ou des personnages, leur musique intérieure. Dans les comédies, c’est la même chose : du moment qu’on ne fait pas de l’illustration, il faut être dans le personnage, au fond de lui-même. En même temps, c’est être au service du film et du metteur en scène. Quand on fait de la musique de film, on participe à une construction, à une cathédrale… Le tailleur de pierres n’est pas celui qui termine l’ébauche de la cathédrale, c’est celui qui taille les pierres. Ce n’est pas l’architecte, c’est le sous-architecte.
A ton avis, qu’est-ce que c’est qu’une mauvaise musique de film ?
Je trouve qu’il y a plusieurs styles de mauvaises musiques de films : il y a celles, tonitruantes, qui nous fatiguent d’un bout à l’autre, où il y en a trop. Quand une musique est « trop » tout le temps, trop présente, même insidieuse, je trouve que ça pollue. En même temps, je dis ça, c’est vrai et pas vrai : quand on entend la musique d’Herrmann dans les films d’Hitchcock, il y a pratiquement de la musique d’un bout à l’autre et ça ne pollue pas du tout.
Quelle est la partition dont tu es le plus fier, parmi tout ce que tu as écrit ?
C’est difficile à dire. J’ai le souvenir d’une partition où, après l’enregistrement, je me suis dit : « Bon, c’est le mieux que j’aurais pu faire. Je la trouve bien comme ça, j’ai rien à dire dessus. » C’était la musique de Roberte, le film de Pierre Zucca. J’ai beaucoup aimé Zucca, c’était un type extraordinaire. Il y a eu quelque chose qui s’est passé entre nous. Il était extrêmement gentil, il avait de l’humour, il était aussi très sérieux par moment. Il m’a montré son film et il m’a dit : « Dans mon film, je vois bien une musique de cirque. » Et en définitive, j’ai fait un tango jazz. On est allés enregistrer ça en Angleterre. C’était une musique à l’image du film, qui était inventive, qui sortait justement de mes habitudes. Même l’instrumentation était assez différente et assez osée par rapport aux autres films que j’avais fait avant. Il y avait douze violoncelles et deux saxophones, qui étaient les pôles principaux de la musique. J’avais écrit des choses impossibles à jouer pour les violoncelles… et ils les ont jouées ! Ça, je le tenais de Michel Magne, qui m’avait donné un jour un tuyau: « Les violons, il faut les écrire le plus grave possible, et les violoncelles, le plus aigu possible. Tu verras que ça sonne vraiment et que l’instrumentiste se donne encore plus. » Après, j’ai fait mes petites expériences et, justement, dans Roberte, j’avais écrit des choses très difficiles : il y avait des sextolets, avec des double-croches, des triple-croches, tout ça joué ensemble et tout ça « tout en haut ». On était en Angleterre pour ça, et j’ai dit : « Je voudrais que vous jouiez ça le mieux possible. On sait que physiquement c’est impossible, mais faites-le ! » Ils l’ont fait. Après ils ont écouté et ils ont dit : « Ah, on a compris pourquoi ! » En fait, c’était une musique à effets.
Ce n’est pas entièrement de l’improvisation du côté des sax, il y a aussi un thème…
Oui, par moment ils reprennent le thème que tout le monde joue, mais il y a quand même une grande partie où ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Sur la partition, ils avaient le thème lui-même, d’un bout à l’autre, les harmonies, et il y a des endroits où c’était marqué : « Huit mesures, là vous faites ce que vous voulez à partir des harmonies », comme toute improvisation. Ils ont déliré et ils m’ont dit : « Ce n’est pas trop ? » J’ai dit : « Non, au contraire, c’est très bien ! » Et ça a donné une couleur vraiment inhabituelle à cet orchestre. Je n’ai pas dirigé moi-même, j’avais pris un chef extraordinaire qui s’appelait Avel Arbinovitch. Je le reverrai toujours diriger, il sautait en l’air comme s’il dansait, il avait les cheveux un peu roux avec une petite barbe rousse… Il était génial ce mec, formidable ! Tout ça, ce sont des bons souvenirs sur ce film. J’ai pris du plaisir à l’écrire, j’y ai mis des sortes de citations courtes… A un moment, il y a toute une montée chromatique de clarinettes qui peut faire penser à Rhapsody In Blue. Puis il y a des côtés que j’ai bien aimés, entre le jazz et le tango argentin. Je me suis amusé à la faire, voilà !
Est-ce qu’il y a aussi des partitions que tu as écrites et dont tu as honte ?
Non, pas à ce point. Mais il y a des partitions que j’aime moins parce que certaines datent un peu ou d’autres dont je ne suis pas content de l’enregistrement et du rendu. Soit parce qu’on n’avait pas assez de temps à passer sur chaque morceau, soit que les musiciens n’étaient pas assez entrainés à ça. J’ai fait une ou deux musiques avec des musiciens de dernière année de Conservatoire. C’était de bons musiciens, mais les musiciens de studio sont tellement entrainés que pratiquement, à la première lecture, on pouvait enregistrer. Et il y a juste certaines musiques que je n’ai pas envie de réécouter.
Quel est pour toi le meilleur souvenir de ta carrière, si tu devais en choisir un seul ?
C’est la première lecture du premier morceau de L’Armée des Ombres où, une fois que j’ai fini le morceau, je me suis retourné vers la cabine et Melville a levé son pouce vers le haut ! Je crois que ça, c’est le plus beau souvenir. J’étais tellement dans le 36ème dessous en dirigeant cette musique, en me demandant ce que ça allait donner, que ce fut un grand soulagement et une grande joie ! C’est un beau souvenir, peut-être pas le seul…
Et ton pire souvenir ?
Le pire, c’est l’incompréhension entre un metteur en scène et un musicien. Le pire, c’est de se faire jeter sa partition à la tête alors qu’on sait qu’on a raison. Ça m’est arrivé, je crois, deux fois.
Est-ce qu’il y a des genres cinématographiques pour lequel tu apprécies particulièrement de travailler ?
Non… Jusqu’à maintenant, j’ai surtout travaillé pour des films qui n’étaient pas des comédies. Mais c’est amusant aussi de faire une comédie. Mais c’est autre chose dans l’écriture, dans l’idée… Par exemple, le court-métrage dans lequel Swan joue, c’est une comédie un peu grinçante : je vais certainement y mettre des choses presque gaies, un peu enlevées, mais en même temps qui grincent un petit peu… Non, moi j’aime bien toute la musique.
Est-ce qu’il y a un réalisateur avec lequel tu aurais voulu travailler ?
Il y en a un auquel je pense, même si ce n’est pas forcément lui que je mettrais en premier : j’aurais bien aimé travailler avec Alain Corneau. Il y en a d’autres, mais je ne les trouve pas comme ça…
Quelle est la dernière musique de film que tu aies vraiment appréciée ?
Le dernier que j’ai écouté et où j’ai trouvé que la relation images/musique était bien, je crois que c’est Le Discours d’un Roi d’Alexandre Desplat.
Que penses-tu de l’état de la musique de film aujourd’hui, par rapport à quand toi tu as commencé ?
Tout dépend si on parle des musiciens qui travaillent pour le cinéma aujourd’hui ou si on parle de l’évolution de la musique de film sur le plan économique ou sur le plan artistique… Ce peut être un peu tout ça… Je trouve aujourd’hui que c’est un peu éclaté. Quand on regarde les films des César, je suis terrifié moi-même de ne pas connaître les trois quarts des films, des metteurs en scène et quelquefois des comédiens qui sont dans les films de l’année. Il y a des tas de petits films qui se montent quand même, qui sont produits, et on ne va peut-être jamais en entendre parler ! C’est là où c’est difficile : tant mieux, plus il y aura de films produits, mieux ça vaudra, mais en même temps il ne faut pas produire n’importe quoi ! Je n’ai pas encore pu voir tous les films des César, car il faudrait y passer presque un mois, mais je pense qu’il y en a qui ne sont pas à leur place. En revanche, il y en a d’autres dont on sait qu’ils sont de très bons films et qui vont passer comme ça, inaperçus…
Et l’état de la musique de film au niveau artistique ?
Je pense qu’il y a des musiciens qui font de la musique de film qui feraient mieux de s’abstenir, de même que les metteurs en scène qui viennent les chercher… Ça n’apporte rien. Quand même, faire de la musique de film, c’est quelque chose d’aussi difficile, peut-être même plus, que de faire la musique d’une chanson. Il y a des bonnes choses dans les chansons, mais quand un auteur-compositeur de variétés se mêle de faire de la musique de film, la plupart du temps il aurait mieux fait de s’abstenir. Je n’ai rien contre eux, mais on est dans un milieu de cinéma où il faut vraiment avoir des connaissances et des capacités spécifiques. Tout le monde ne peut pas s’improviser comme ça… Il y a quelques bonnes surprises de temps en temps, mais la plupart du temps ce n’est pas bien. Ce n’est même pas leur talent qui est en cause, c’est qu’ils sont dans une autre sphère. Moi je ne sais pas si je saurais faire des chansons. J’en ai fait plein évidement, mais je ne sais pas si je saurais faire de la chanson qui va marcher pour un ou une chanteuse précise… Ce n’est pas vraiment mon métier, donc je ne rentre pas là-dedans. Si un jour on me demande, j’essaierai, mais bon… Il y a un carnet d’adresses pour les chanteurs, un autre pour les musiciens, un autre pour les scénaristes…
Est-ce que t’as l’intention d’arrêter un jour de composer ?
Jamais ! Je mourrai avec un crayon à la main, sans oublier une gomme et un papier ! Même si je travaille avec les moyens d’aujourd’hui, il ne faut pas négliger le papier, la gomme et le crayon…
Entretien réalisé le 24 janvier 2012 par Olivier Desbrosses.
Transcription : Hélène de Monbazillac
Illustrations : © UnderScores / DR
Remerciements à Eric Demarsan pour sa gentillesse, sa bonne humeur et son extraordinaire patience.