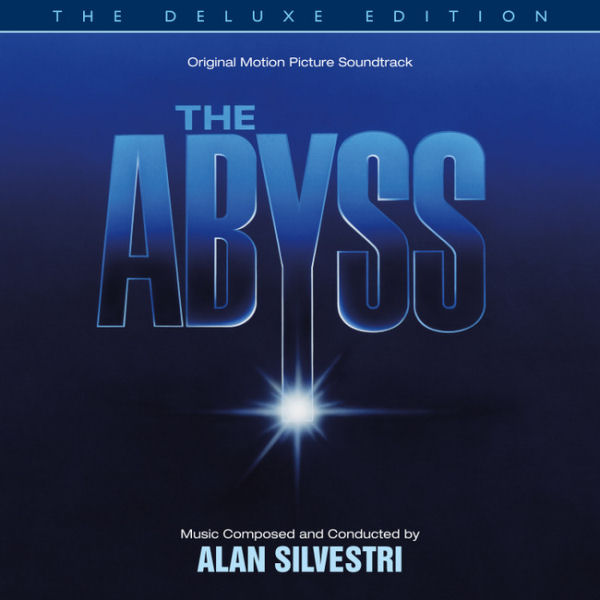PREDATOR 2 (1990)
PREDATOR 2 (1990)
PREDATOR 2
Compositeur : Alan Silvestri
Durée : 104:56 | 29 pistes
Éditeur : Varèse Sarabande
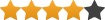
Ce serait exagéré de parler d’un filon à part entière. Plutôt une micro-tendance apparue au début des années 90, qui fit de Jamaïcains folkloriques et grimaçants la nouvelle chair à canon du cinéma d’action américain. Avec leur crinière nouée en torsades épaisses, les vapeurs du cannabis dessinant au-dessus de leur crâne une perpétuelle auréole et, bien entendu, leurs accointances avec les sinistres mystères du vaudou, de tels bad guys ne pouvaient que s’attirer le courroux du vigilante Steven Seagal, qui leur dispense quelques leçons d’anatomie bien senties dans le crétin mais teigneux Marked For Death (Désigné pour Mourir). Le superflic Danny Glover, qui prend la relève de Schwarzenegger pour cette seconde mouture de Predator, doit en découdre avec ce type d’engeance. Autant dire que les kyrielles de percussions ostensiblement tribales que déballe Alan Silvestri, de retour derrière son pupitre, ne résultent pas entièrement de la tentation un peu futile du simple clin d’œil. Il en va de même pour cet ample travelling aérien survolant palmiers et rangs d’arbres serrés, illusoire promesse d’un nouveau trek dans les entrailles de l’enfer vert. Cette fois, la jungle n’est pas celle de l’Amérique du Sud, mais lance vers le ciel les orgueilleuses tours de verre et d’acier de Los Angeles. Accablée d’une épouvantable chaleur, résonnant des sanglantes escarmouches entre policiers dépassés et narco-trafiquants armés jusqu’aux dents, la Cité des Anges n’a jamais aussi peu mérité son sobriquet. Mais dans le chaos urbain rôde un chasseur plus terrible encore que les hordes de Jamaïcains…
Parmi les listes censément idéales des meilleure suites de l’histoire du cinéma que les amateurs têtus se plaisent à fréquemment remettre sur le métier, vous avez peu de chance de voir figurer Predator 2. S’il ne peut en aucun cas revendiquer l’indestructible prestige du classique de John McTiernan, le film, charpenté avec énergie par le zélé Stephen Hopkins, vaut cependant mieux que l’infamante étiquette de séquelle au rabais qu’on lui a collé sans autre forme de procès. La moindre de ses vertus n’étant pas le respect avec lequel il étoffe la nature, volontairement ambiguë, de sa créature vedette. Impitoyable guerrier venu de l’espace, le Predator est aussi, aux yeux de ses victimes pétrifiées, une entité infernale engendrée par les mythologies les plus noires. Le prodigieux crescendo de Truly Dead ne dit pas autre chose, avec ses cuivres chauffés à blanc, ses grondements caverneux et sa fantomatique litanie, qui grandit telle une houle alors que le monstre se débarrasse peu à peu de son manteau d’invisibilité. Au sein de cette terrassante tempête, les sonorités synthétiques, aussi macabres qu’insolites, témoignent d’une inventivité pas mois fiévreuse, dont le Silvestri parcheminé du récent et atroce Red 2 semble avoir bel et bien égaré la recette.
Si King Willie, l’étrange leader des Jamaïcains, obtient le redoutable privilège de contempler la mort en face, le menu fretin ne peut pas en dire autant. Jaloux peut-être des seyants dreadlocks qu’arborent ses proies, le Predator les décime en usant de toute sa furtivité fatale. Du pain béni pour notre compositeur affamé d’action, auquel la présente intégrale rend un pieux hommage en exhumant (« Enfin ! » vociféreront les fans à la patience érodée) plusieurs tours de force longtemps guettés au tournant. L’attente était-elle légitime ? Pour ne rien cacher, un doute insidieux s’installe dès la seconde piste, Chat, qui, pour inédite qu’elle soit dans un tracklisting copieux, ne réussit pas à se séparer d’un air tenace de déjà-entendu. Et pour cause : ces frénétiques ostinati de cordes où s’infiltre sournoisement le thème du Predator figuraient déjà dans le End Title, homérique pièce de résistance du disque paru il y a vingt-cinq ans. Quelques plages plus loin, Swinging Rude Boys, alléchant de par les trois bonnes minutes dont on l’a rembourré pour l’occasion, ne dévoile comme matière « neuve » que des reprises carbone de morceaux piochés au petit bonheur par Silvestri dans ses deux scores. Et puis il y a le fameux compte à rebours, précédant chacune des explosions nucléaires sur lesquelles se concluent les films, et que les cordes et les cuivres égrènent de concert. Laminé, délayé, surexploité (au moins une demi-douzaine de reprises dispensables), il perd dans cette Deluxe Edition une grosse part de son impact cathartique.
De spectaculaire exercice de réinterprétation suintante et de variations primitives axées autour d’un chapelet de thèmes mythiques qu’il était jusqu’alors, ce Predator 2 customisé par Varèse serait-il passé au remplissage tous azimuts ? Qu’on se rassure, il y a encore assez loin à le penser. Silvestri a beau tourner et retourner sans discontinuer les mêmes figures, il s’y emploie avec une férocité viscérale faisant régulièrement mouche. Bardé de percussions ébouriffantes, Tunnel Chase bénéficie à plein régime de la violence rentre-dedans dont rugissent les réussites majeures du compositeur, et avec lui tout le début du second CD, qui couvre la longue traque finale de notre extraterrestre rasta à grand renfort de ces rythmes syncopés tellement caractéristiques du style inimitable de leur géniteur. Surtout, le nouveau mixage accomplit des merveilles. Sans chercher, Dieu merci, à amplifier le mitraillage des cuivres au point d’assourdir l’auditeur, il met tout particulièrement en valeur le bouillonnement d’un arrière-fond hirsute. Le hose-oon, co-star singulière de la partition, n’allait pas laisser filer l’aubaine de briller avec une intensité accrue.
Derrière ce néologisme nasillard se cache le bricolage pas ordinaire du jazzman Ray Pizzi. On ignore comment a pu lui venir l’idée a priori saugrenue d’encapuchonner un basson d’un tuyau d’arrosage sectionné (et pour un résultat qu’on suppose n’être guère esthétique), mais les bruits stupéfiants qu’il parvient à tirer de cet instrument contrefait sont de nature à faire taire tous les sarcasmes. Plus inquiétant que jamais grâce à la précision chirurgicale du son, vibrant du sinistre écho de grincements inhumains, First Carnage demeure, entre autres, une démonstration ô combien éloquente du brio de Pizzi, que les membres enthousiastes du Skywalker Symphony Orchestra épaulent sans fléchir un seul instant. Tout ce joli monde ouvre béants les vantaux noirs du royaume des enfers, livrant passage à l’un de ses plus monstrueux rejetons (dont les stridulations mouillées font d’ailleurs l’objet d’un sympathique bonus). Sa gueule ne ressemble toujours pas à un porte-bonheur, mais rien ne pouvait autant aiguillonner la fougue et l’inspiration d’Alan Silvestri qu’un pareil délit de faciès.