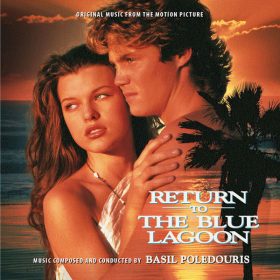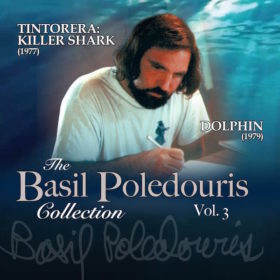Vous avez également établi une collaboration fructueuse avec Paul Verhoeven. Comment avez-vous été amené à travailler pour ce grand réalisateur ?Et quel est votre processus créatif avec lui ?
C’est très différent. Alors qu’il cherchait une musique pour Flesh+Blood (La Chair et le Sang), Paul contacta Luc Van de Ven, de Prometheus Records, lui disant «Quelle musique devrais-je utiliser ?», et Luc lui fit écouter Conan. C’est ce score qui m’a mis en contact avec Paul. Je crois qu’il avait d’abord montré le film à James Horner, qui a dit «Je ne peux pas accepter, ce film est épouvantable». De mon côté, j’ai immédiatement déclaré : «Je dois le faire, c’est le meileur film que j’aie jamais vu de toute ma vie !».  Et franchement, c’était le cas. Le film est honnête, sans pitié, affreusement brutal, mais n’était-ce pas ainsi ? Le mariage entre politique et religion est parfait, de même que la façon dont Martin manipule sa bande, presque une bande de bohémiens, ou plutôt des pirates, d’une certaine façon, dans leur chariot, presque comme un voilier terrestre, une goélette terrestre naviguant à travers le pays. D’ailleurs, aux Etats-Unis, on appelait prairie schooners (goélettes de la plaine) les chariots allant vers l’ouest. Le film me fit donc immédiatement penser à un film de pirates, exubérant et plein de vie. Et bien sûr, ce sont des mercenaires. Même si les gens aiment à romancer cette époque, c’est probablement ainsi que les choses se passaient. Horrible ! Quand ils enterrent le bébé dans le tonnelet de vin, il y a une extraordinaire humanité dans tout ça. Et quoi, ça n’est jamais arrivé ? Il n’y avait pas d’hôpitaux, de médicaments… Bref, j’ai donc dit immédiatement : «Je dois faire ce film !».
Et franchement, c’était le cas. Le film est honnête, sans pitié, affreusement brutal, mais n’était-ce pas ainsi ? Le mariage entre politique et religion est parfait, de même que la façon dont Martin manipule sa bande, presque une bande de bohémiens, ou plutôt des pirates, d’une certaine façon, dans leur chariot, presque comme un voilier terrestre, une goélette terrestre naviguant à travers le pays. D’ailleurs, aux Etats-Unis, on appelait prairie schooners (goélettes de la plaine) les chariots allant vers l’ouest. Le film me fit donc immédiatement penser à un film de pirates, exubérant et plein de vie. Et bien sûr, ce sont des mercenaires. Même si les gens aiment à romancer cette époque, c’est probablement ainsi que les choses se passaient. Horrible ! Quand ils enterrent le bébé dans le tonnelet de vin, il y a une extraordinaire humanité dans tout ça. Et quoi, ça n’est jamais arrivé ? Il n’y avait pas d’hôpitaux, de médicaments… Bref, j’ai donc dit immédiatement : «Je dois faire ce film !».
Flesh+Blood était un petit budget. Je me souviens que Paul Verhoeven et Gijs Versluys, son producteur à l’époque, arrivant de Hollande, se déplaçaient en métro parce qu’ils ne pouvaient s’offrir le taxi, et que je me sentais coupable… Et Paul fit une chose extraordinaire, que beaucoup de réalisateurs ne font pas : il paya de sa poche pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de temp track. Il ne voulait pas que je sois influencé par une quelconque préconception sur ce que la musique devait être. Je savais qu’il était plus artiste que la plupart des metteurs en scène. Et il était européen, et j’ai toujours réagi plus positivement aux réalisateurs européens, à l’exception des gens avec qui j’étais à l’USC, parce que nous étions en train d’évoluer dans un environnement européen, Antonioni, Fellini, nous avons grandi dans cet univers.
Flesh+Blood étant un film d’époque, je n’allais pas faire appel aux synthétiseurs, ou faire du rock’n roll, donc le style général de la partition était défini d’emblée. Paul voulait que l’on utilise un grand orchestre, et ce fut le London Symphony Orchestra qui fut choisi. Après que j’aie composé la mélodie qui allait devenir le point de départ de la partition (il chante le Main Title de Flesh+Blood), Paul retourna en Hollande. Et il commença alors à me faxer des pages et des pages de notes. Et à la fin, il finissait toujours par «Si je dis des conneries, oublie tout !».  C’est ainsi que ça se passait. Si vous n’étiez pas d’accord avec ce qu’il écrivait, il vous autorisait à laisser parler votre instinct. Mais la plupart du temps, j’étais d’accord avec lui, parce que ce qu’il disait était juste. Je l’ignorais à l’époque, et je n’ai appris que Paul a un doctorat en mathématiques appliquées que lorsque nous faisions RoboCop. C’est pour cette raison qu’il est capable d’aborder une scène sous tant d’aspects et de points de vue différents. Il est totalement brillant ! Il l’a fait pour The Fourth Man (Le Quatrième Homme), pour Total Recall, avec cette séquence où le psy tente de convaincre Schwarzenegger qu’il est fou. Cette scène est exceptionnelle ! Même chose avec Basic Instinct. C’est là que réside son génie.
C’est ainsi que ça se passait. Si vous n’étiez pas d’accord avec ce qu’il écrivait, il vous autorisait à laisser parler votre instinct. Mais la plupart du temps, j’étais d’accord avec lui, parce que ce qu’il disait était juste. Je l’ignorais à l’époque, et je n’ai appris que Paul a un doctorat en mathématiques appliquées que lorsque nous faisions RoboCop. C’est pour cette raison qu’il est capable d’aborder une scène sous tant d’aspects et de points de vue différents. Il est totalement brillant ! Il l’a fait pour The Fourth Man (Le Quatrième Homme), pour Total Recall, avec cette séquence où le psy tente de convaincre Schwarzenegger qu’il est fou. Cette scène est exceptionnelle ! Même chose avec Basic Instinct. C’est là que réside son génie.
RoboCop fut un peu différent, parce qu’il y avait énormément de pression. Paul voulait obtenir une carte verte, et il savait que RoboCop signerait son entrée aux Etats-Unis. Mais il rencontrait d’énormes problèmes. Il était très secoué par le fait qu’on lui impose des changements sur le film. La MPAA (Motion Picture Association of America) trouvait le film tellement violent qu’ils voulaient qu’il soit classé X. Et il était en effet très violent. Mais c’était volontaire, dans un esprit très comic book. Et ils tentaient d’en faire un film réaliste ! Ils demandaient de nombreuses coupes, en particulier dans la séquence du début, celle dans laquelle Murphy est abattu. Paul était tellement anéanti qu’on lui dicte ce qu’il devait faire que j’ai du appeler John Milius, parce qu’il n’y a probablement qu’une personne capable de calmer Paul Verhoeven, et c’est John. Et peut-être Francis Coppola. Mais Francis, c’est Dieu. Nous avions d’ailleurs l’habitude de dire que John (Milius) parle à Francis (Coppola) et que Francis parle à Dieu ! Donc Milius appela Verhoeven, et l’aida à comprendre comment fonctionne la machine hollywoodienne. Cela dit, Paul avait d’excellentes relations avec Orion Pictures, et avec Mike Medavoy, qui était un excellent producteur exécutif. Il l’est d’ailleurs toujours. Il ne reste plus beaucoup de types de cette carrure, maintenant…
Nous avons enregistré RoboCop à Londres, et ce fut là ma première utilisation intensive d’éléments électroniques mixés à la partie acoustique. A Abbey Road, j’avais une pièce remplie de synthétiseurs. Derek Austin, génial musicien électronique britannique, était l’assistant synthés.  Il disposait de tous les éléments présequencés : c’était l’époque où les séquenceurs midi commençaient à apparaître, et la première fois où l’on pouvait jouer d’une centaine d’instruments avec un ordinateur. Derek était à l’étage dans le studio C, avec sa propre console de mixage et son propre ingénieur du son. Au rez-de-chaussée, j’avais le London Philharmonic, où l’un de ces orchestres de sessions londoniens, en tout cas ce n’était pas le LSO, et Howard Blake dirigeait. J’étais dans la cabine avec Eric Tomlinson. Les mixeurs descendaient tous les éléments electroniques, et nous faisions le mixage en direct. Et je vous le promets : il y a un fantôme à Abbey Road ! A une heure du matin, la température chutait de 15 degrés, comme ça ! Et les gardes disaient entendre des bruits de pas ! Scott Smalley, qui était mon orchestrateur, et moi-même y travaillions chaque nuit, et chaque nuit la température baissait de 15 degrés. Alors un soir, je me suis adressé au fantôme, et je lui ait dit : «Soit tu dégages, soit tu nous tues, mais cesse de jouer avec nous !». Et je vous jure, encore aujourd’hui, j’entends cette piste, sur laquelle il y a une voix étraaaaange, j’ignore d’où elle venait, mais ce n’est pas quelque chose que j’ai écrit. Si le fantôme voulait chanter en chœur, ok, mais qu’il ne se mette pas dans nos pattes ! Finalement, nous avons fait la paix avec lui…
Il disposait de tous les éléments présequencés : c’était l’époque où les séquenceurs midi commençaient à apparaître, et la première fois où l’on pouvait jouer d’une centaine d’instruments avec un ordinateur. Derek était à l’étage dans le studio C, avec sa propre console de mixage et son propre ingénieur du son. Au rez-de-chaussée, j’avais le London Philharmonic, où l’un de ces orchestres de sessions londoniens, en tout cas ce n’était pas le LSO, et Howard Blake dirigeait. J’étais dans la cabine avec Eric Tomlinson. Les mixeurs descendaient tous les éléments electroniques, et nous faisions le mixage en direct. Et je vous le promets : il y a un fantôme à Abbey Road ! A une heure du matin, la température chutait de 15 degrés, comme ça ! Et les gardes disaient entendre des bruits de pas ! Scott Smalley, qui était mon orchestrateur, et moi-même y travaillions chaque nuit, et chaque nuit la température baissait de 15 degrés. Alors un soir, je me suis adressé au fantôme, et je lui ait dit : «Soit tu dégages, soit tu nous tues, mais cesse de jouer avec nous !». Et je vous jure, encore aujourd’hui, j’entends cette piste, sur laquelle il y a une voix étraaaaange, j’ignore d’où elle venait, mais ce n’est pas quelque chose que j’ai écrit. Si le fantôme voulait chanter en chœur, ok, mais qu’il ne se mette pas dans nos pattes ! Finalement, nous avons fait la paix avec lui…
Paul est un réalisateur merveilleux, j’aime énormément travailler avec lui. Malheureusement, quand il a fait Total Recall, j’étais déjà engagé sur The Hunt For Red October (A La Poursuite d’Octobre Rouge), et c’est pourquoi il choisit Jerry Goldsmith. Et c’était un bon choix. Mieux vaut Jerry que James Horner ! Et Jerry a fait un travail formidable avec Paul. Basic Instinct est exceptionnel, un très grand score. Mais c’est alors que Paul devint de plus en plus exigeant. Pas vraiment un micro manager, mais sur Starship Troopers, les choses devinrent difficiles, et je sais que ce fut aussi le cas sur les films mis en musique par Jerry. Dieu merci, aucun d’entre nous n’a fait Showgirls. C’est très curieux : Paul pensait qu’il allait faire avec ce film une version moderne de All About Eve (Eve). C’est triste. L’aspect culturel de tout ça a dû se perdre dans la traduction…
Starship Troopers était un film à 125 millions de dollars, ce qui représentait beaucoup d’argent pour un seul film. Je pense même qu’il est monté jusqu’à 150 millions. Il y avait beaucoup de pression, et Paul était très investi dans son travail avec Rob Bottin, sur les insectes, et toute la technologie autour des CGI, et il devint incroyablement impliqué dans le travail de tout le monde.  Il se retrouva dans une position où il subissait plus de pression qu’il n’aurait dû. Il insistait pour que j’attende, parce qu’il ne voulait pas que je travaille sur les animatronics, il voulait que je compose sur les effets terminés. C’est pourquoi je suis resté sur le film pendant 9 mois. C’était très difficile, parce qu’il débarquait à 9 heures tous les matins pour écouter ce que j’avais composé, jusqu’à 10 heures – 10 heures 30. Il approuvait, ou me demandait de retravailler. Et il revenait le soir à 9 heures, et nous nous remettions au travail jusqu’à minuit. Je ne dormais jamais ! Je n’ai vraiment pas dormi pendant 9 mois, c’était une période très difficile. J’aime travailler avec lui, j’ai toujours beaucoup aimé. Mais à ce moment-là, nous avions la possibilité de faire des démos, que nous n’avions pas au moment de RoboCop ou de Flesh+Blood, il n’y avait que le piano, pas de synchronisation avec l’image. Mais pour Starship Troopers, tout était séquencé, et nous avions une relation en tête-à-tête… Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si j’apprécie vraiment ça, mais tous les films sont faits comme ça, de nos jours. Ainsi, le réalisateur peut voir ce qu’il va obtenir. Mais on perd aussi la passion de l’interprétation, le feu provenant d’une performance en live. Ce n’est pas exactement stérile, mais c’est perturbant. Et bien sûr, il y a eu toutes les répercussions politiques autour du film aux Etats Unis. Vous l’avez mieux compris en France. C’est un film très drôle, et très effrayant… «Le seul bon insecte est un insecte mort !». Malheureusement, c’est la dernière fois que nous avons travaillé ensemble. RoboCop est un des scores les plus diffciles qu’il m’ait été donné d’écrire, Starship Troopers également. Et je pense que chacun de ces scores est unique. Ils ne ressemblent à rien d’autre de ce que j’ai pu écrire.
Il se retrouva dans une position où il subissait plus de pression qu’il n’aurait dû. Il insistait pour que j’attende, parce qu’il ne voulait pas que je travaille sur les animatronics, il voulait que je compose sur les effets terminés. C’est pourquoi je suis resté sur le film pendant 9 mois. C’était très difficile, parce qu’il débarquait à 9 heures tous les matins pour écouter ce que j’avais composé, jusqu’à 10 heures – 10 heures 30. Il approuvait, ou me demandait de retravailler. Et il revenait le soir à 9 heures, et nous nous remettions au travail jusqu’à minuit. Je ne dormais jamais ! Je n’ai vraiment pas dormi pendant 9 mois, c’était une période très difficile. J’aime travailler avec lui, j’ai toujours beaucoup aimé. Mais à ce moment-là, nous avions la possibilité de faire des démos, que nous n’avions pas au moment de RoboCop ou de Flesh+Blood, il n’y avait que le piano, pas de synchronisation avec l’image. Mais pour Starship Troopers, tout était séquencé, et nous avions une relation en tête-à-tête… Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si j’apprécie vraiment ça, mais tous les films sont faits comme ça, de nos jours. Ainsi, le réalisateur peut voir ce qu’il va obtenir. Mais on perd aussi la passion de l’interprétation, le feu provenant d’une performance en live. Ce n’est pas exactement stérile, mais c’est perturbant. Et bien sûr, il y a eu toutes les répercussions politiques autour du film aux Etats Unis. Vous l’avez mieux compris en France. C’est un film très drôle, et très effrayant… «Le seul bon insecte est un insecte mort !». Malheureusement, c’est la dernière fois que nous avons travaillé ensemble. RoboCop est un des scores les plus diffciles qu’il m’ait été donné d’écrire, Starship Troopers également. Et je pense que chacun de ces scores est unique. Ils ne ressemblent à rien d’autre de ce que j’ai pu écrire.