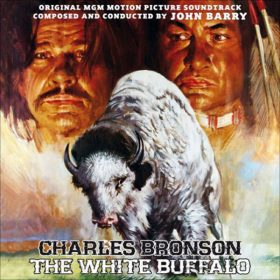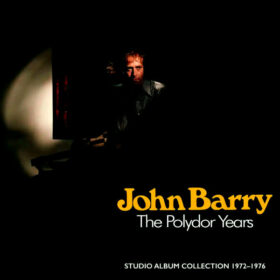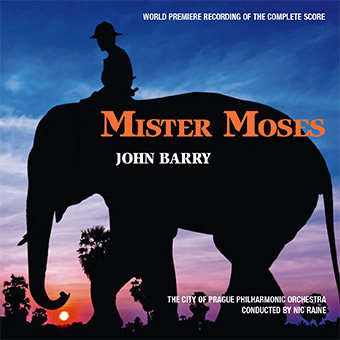UnderScores se propose de dessiner dans cette série les portraits de 50 maîtres de la musique de film, de la glorieuse génération des compositeurs hollywoodiens du passé à ceux d’une époque plus récente, sans négliger les grandes figures de la nouvelle vague européenne. Bien sûr, c’est aussi l’occasion d’aborder des personnalités plus atypiques, loin du feu des projecteurs, mais qui se révèlent tout aussi indispensables.
« Je déteste les coups tordus, ces recettes pour émouvoir. Je les sens venir de loin, elles ne me touchent pas et me dégoûtent même. Il faut aller plus loin que ces simples tours de passe-passe de surface pour vraiment toucher les gens. C’est pour ça que je trouve que la plupart des B.O. sont des ramassis de clichés et de recettes éculées. »
John Barry
Principal artisan du son pop des années 60, John Barry fait partie de cette nouvelle génération de compositeurs comme Henry Mancini, Ennio Morricone ou Michel Legrand, dénués de tous complexes. Avant eux, la musique de film était encore plutôt assujettie au répertoire classique traditionnel. Par le choix d’instrumentations inédites et d’arrangements modernistes, John Barry a réussi à créer un véritable univers sonore qui perdure encore aujourd’hui. Un mélange de guitares électriques, de cuivres majestueux et de cordes envoûtantes, ponctuées par des touches de flûte, de harpe, de piano ou d’instruments intrigants. En confrontant l’écriture jazz au modèle symphonique, l’anglais aux doigts d’or a popularisé de nouvelles techniques de compositions comme l’écriture minimaliste romantique et la chanson de variété. Débarrassé des effets encombrants, son style cultive un sens très personnel du lyrisme et de la mélodie qui accroche instantanément la mémoire. Écoutées en série, ses partitions peuvent apparaitre comme les pièces d’une même œuvre en devenir, grâce à un choix délibéré de reproduire les mêmes formes musicales, mais toujours sous des aspects différents. Doté d’une approche émotionnelle, John Barry a également démontré que sa musique, en dépit de sa simplicité apparente, pouvait parfaitement survivre aux images et avoir une vie propre.
Né à York, au nord de l’Angleterre, John Barry est le fils d’une pianiste et d’un gérant de cinéma. Sa voie est déjà toute tracée lorsqu’il découvre à l’âge de quatre ans les premiers dessins animés de Mickey Mouse dans le cinéma de son père. Très jeune, il se prend d’affection pour le répertoire classique, les mélodies pour piano de Frédéric Chopin et les symphonies de Jean Sibelius. Il prend conscience de la brutalité de la guerre lorsque la Luftwaffe bombarde son école, tuant quarante personnes et plusieurs de ses amis. Il doit alors quitter son domicile familial pour se réfugier avec sa sœur dans un couvent. De là lui viendra cette part de lyrisme grave et de mélancolie qui traverse une grande partie de son œuvre. À l’adolescence, grâce au cinéma de son père, il découvre le cinéma hollywoodien et ses grands compositeurs (Erich Wolfgang Korngold, Alfred Newman, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann). Il remarque déjà certaines musiques comme la partition dramatique de Max Steiner pour The Treasure Of The Sierra Madre (Le Trésor de la Sierra Madre – 1948) et le thème à la cithare d’Anton Karas pour The Third Man (Le Troisième Homme – 1948).
Barry envisage d’abord une carrière de pianiste de concert. À l’âge de 15 ans, il prend des cours d’harmonie, de piano et de chant avec l’organiste Francis Jackson, mais se révèle plus à l’aise dans le travail de composition en solitaire. Á la fin des années 50, il est attrapé par le démon du jazz moderne et se passionne pour les musiques de Charlie Parker, Miles Davis, Chet Baker et du Gerry Mulligan Quartet. Il apprend la trompette et suit par correspondance les cours du renommé Bill Russo (l’arrangeur de Stan Kenton) et de Joseph Schillinger, auteur d’une méthode musicale par les mathématiques. Au moment où le jazz commence à décliner au profit du rock’n roll, Barry lance sa formation musicale, le frétillant John Barry Seven. Il en profite alors pour intégrer une basse électrique à la place de la contrebasse habituelle. Leader du groupe, il joue de la trompette et chante sur plusieurs titres. Le John Barry Seven obtient un certain nombre de succès, dont Walk Don’t Run et Hit And Miss. Il restera l’un des groupes les plus populaires en Angleterre avant l’arrivée des Beatles.
Chez EMI, John Barry a rencontré le chanteur Adam Faith, sorte de Johnny Hallyday british de l’époque, dont il a produit plusieurs albums. Quand Faith obtient un rôle dans Beat Girl (L’Aguicheuse – 1960), il demande à Barry de composer la musique. Le film ne restera pas dans les mémoires mais sera la première bande originale à sortir en Angleterre. L’impact de la musique de Barry est d’ailleurs immédiat dès le générique d’introduction, un long plan séquence où des jeunes se trémoussent au son d’une musique rock énergique. C’est cette couleur musicale qui va alors taper dans l’oreille des producteurs de James Bond, Albert R. Broccoli et Harry Saltzman. Ils cherchent un arrangeur dans le vent, pour redonner du lustre aux mélodies de Monty Norman. Ce dernier, essentiellement un auteur de chansons, a rejoint l’équipe du film Dr. No (James Bond 007 Contre Dr. No – 1962) en Jamaïque pour enregistrer quelques airs du cru. On lui doit notamment le délicieux Underneath The Mango Tree, que fredonne Ursula Andress (doublée par Nikky van der Zyl) au sortir de l’eau. Il a surtout composé un morceau joué au sitar indien provenant d’une obscure comédie musicale jamais enregistrée : A House For Mr. Biswas. Un thème à des années lumières du mythe de Bond et qui accompagne la complainte d’un petit homme malingre souffrant d’éternuements chroniques. Séduits par la ritournelle, les producteurs souhaitent alors l’utiliser comme thème principal pour Dr. No.
En un week-end, et sans même voir le film, John Barry se charge de l’arrangement. Il retravaille le morceau intégralement, modifie les dernières mesures et crée toute l’orchestration. Un big-band à mi-chemin entre le jazz, le swing et le rock. C’est Vic Flick, guitariste du John Barry Seven, qui interprète le riff musical de Monty Norman sur une Clifford Essex Paragon De Luxe, dans un style proche de Duane Eddy (accentuation des graves et grosse réverbération). Le titre fait un tabac dans le monde entier et sera utilisé à chaque ouverture des films de la franchise, lorsque le canon du pistolet apparaît à l’écran face au célèbre agent britannique. Il faut noter que dans le cas de Dr. No, c’est une composition électronique de Daphne Oram qui ouvre ce gun barrel, la musique n’intervenant qu’à la fin. Si l’habillage musical est remarquable et insuffle une tension dramatique moderne, il n’est pas vraiment original compte tenu de l’effervescence musicale qui règne alors à cette époque. John Barry n’a eu qu’à puiser son inspiration dans le jazz de Dizzie Gillespie, le rock des Shadows, les musiques d’Henry Mancini (Peter Gunn) ou celles d’Edwin Astley (Danger Man). Contractuellement, il n’est pas crédité comme compositeur au générique de Dr. No et c’est Monty Norman qui perçoit les droits de la musique de ce premier Bond. Il obtient néanmoins la promesse des producteurs de composer les autres musiques de la série. Dans tous les autres films, le thème de James Bond sera également décliné en de multiples variations et restera dans l’inconscient collectif associé aux aventures de l’espion britannique.
En 2001, une bagarre juridique a lieu entre Monty Norman et John Barry. Tous deux revendiquent être l’auteur du fameux thème. Monty Norman finit par obtenir gain de cause, pourtant la paternité en revient tout autant à Barry, la difficulté venant du fait que le James Bond Theme est en fait constitué de plusieurs motifs mélodiques. Il y a le riff de guitare qui peut être légitimement attribué à Monty Norman mais on trouve aussi deux autres thèmes ajoutés par Barry. Un be bop dynamique joué par les cuivres (Badap ba daaa ba da daaa…) et une contre-mélodie exécutée par des bois, une trompette en sourdine, une basse et un vibraphone. Il s’agit d’un motif à suspens chromatique basé sur quatre notes (Pom pom… Pom pom…). Un « vamp » assez utilisé à cette époque et que l’on retrouve dans la pièce de jazz Nightmare (1938) du clarinettiste Artie Shaw. Barry l’avait déjà lui-même repris avec sa formation sur Poor Me chanté par Adam Faith, ainsi que sur l’instrumental Black Stockings. On retrouve aussi le fameux motif dans la berceuse de L’Oiseau de Feu (1910) d’Igor Stravinski et surtout dans l’introduction du Cassazione (1904) pour orchestre de Jean Sibelius (on peut aussi en percevoir les germes au début du Concerto n°2 pour Piano de Serge Rachmaninov, composé en 1901). Ses quatres notes qui montent et descendent vont ainsi devenir le véritable fil conducteur musical de la série puisqu’on va les retrouver à travers tous les films de la franchise. Elles apparaissent aussi assez nettement sur les chansons génériques de Goldfinger, Thunderball et GoldenEye, ou réharmonisées de manière plus subtile dans le No Time To Die chanté par Billie Eilish.
Les génériques des James Bond, sublimés par l’esthétique de Robert Brownjohn puis de Maurice Binder, vont populariser la musique du compositeur à travers le monde. C’est Goldfinger (1964) qui ouvre le bal de manière éblouissante. Avec ses cuivres barrissant et sa ligne mélodique élégante, la chanson de Shirley Bassey va redéfinir complètement l’esthétique musicale de la série. La diva galloise deviendra même une figure familière de la saga : le fouetté inimitable de son timbre fait également sensation aux génériques de Diamonds Are Forever (Les Diamants Sont Éternels – 1971) et Moonraker (1979). Sur les James Bond, ce qui est aussi très significatif de la Barry’s Touch, c’est la manière de reprendre le thème de la chanson générique et de la redistribuer à travers le film sous des déclinaisons instrumentales diverses. Un peu à la manière de ce qu’avait précédemment fait Henry Mancini avec Breakfast At Tiffany’s (Diamants sur Canapé – 1961) et la célèbre chanson Moon River. Jusqu’alors, musique et chanson étaient généralement indépendants et bien souvent composés par deux auteurs différents.
Parmi les plus belles réussites de Barry, on peut évoquer You Only Live Twice (On ne Vit que Deux Fois – 1967), interprétée par Nancy Sinatra et dont le motif mélodique entêtant trouve ses origines dans le Kullervo de Jean Sibelius. Mais son chef-d’œuvre reste sans doute la superbe ballade We Have All The Time In The World dans On Her Majesty’s Secret Service (Au Service Secret de Sa Majesté – 1969). Chantée par la voix éraillée de Louis Armstrong, elle accompagne l’idylle romantique entre James Bond (George Lazenby) et Tracy (Diana Rigg). L’idée de confier une chanson romantique à un interprète au crépuscule de sa vie était d’ailleurs astucieusement décalée, de même que la manière de reprendre ce même thème en clôture du film, juste après la mort tragique de Tracy. Barry a aussi essayé de coller à la variété de son époque en injectant de la guitare électrique sur le générique de The Man With The Golden Gun (L’Homme au Pistolet d’Or – 1971) interprété par Lulu. Il collabore aussi avec A-ha sur The Living Daylight (Tuer n’est pas Jouer – 1987). Le titre, très différent du style musical de la série, se révèle assez efficace même si Barry garde un mauvais souvenir de ses rapports avec la formation norvégienne. La chanson qui a le plus mal vieilli, en partie à cause de ses sonorités synthétiques, reste celle de A View To A Kill (Dangereusement Vôtre – 1985) interprétée par les Duran Duran, un groupe déjà assez ringard à cette époque. John Barry quitte définitivement la série en 1989, car les producteurs souhaitaient confier la chanson titre à un autre compositeur. Son ami et successeur David Arnold est celui qui reprendra le mieux la relève musicale.
Sur les James Bond, Barry était souvent contraint de faire de la « tapisserie sonore » et de l’exotisme au rabais. Mais il a aussi eu l’occasion de composer des thèmes mémorables particulièrement bien mis en valeur par la mise en scène. Dès From Russia With Love (Bons Baisers de Russie – 1963), il crée un morceau dynamique richement cuivré (007) qui sera utilisé sur d’autres films en tant que thème d’action. Dans Goldfinger, ce sont des percussions martiales qui rythment l’attaque de Fort Knox menées par les aviatrices de Pussy Galore. Pour évoquer les fonds marins, on retiendra aussi la musique de chambre aux contours impressionnistes de Thunderball (Opération Tonnerre – 1965) et la fascinante marche spatiale qui ouvre You Only Live Twice. Les ressources du chœur et du grand orchestre sont également à l’honneur sur le thème majestueux (Flight Into Space) qui accompagne les images spatiales de Moonraker (1979). On peut aussi y voir une référence à la partition symphonique de John Williams pour Close Encounters Of The Third Kind (Rencontres du Troisième Type – 1977). Le fameux motif de cinq notes du film de Spielberg est d’ailleurs utilisé comme digicode pour l’ouverture d’une porte électronique. Pour accompagner les romances de James Bond avec ses différentes conquêtes féminines, John Barry peut aussi développer une fibre plus lyrique. Les solos de flûtes envoûtants dans Octopussy (1983) et A View To A Kill (1985) ou la sensualité des cordes de The Living Daylights figurent parmi ses plus belles réussites. Sur On Her Majesty’s Secret Service, Barry va utiliser des cuivres, une basse électrique et un synthétiseur moog pour rythmer l’incroyable poursuite à ski dans les Alpes Suisse. Le morceau, utilisé aussi comme thème générique, est basé sur une descente chromatique de quatre notes assez similaire au « vamp » que l’on retrouve sur le thème de Bond. Comme sur Goldfinger, on notera les fameux suraigus à la trompette de Derek Watkins, musicien emblématique qui participa à tous les films de la série jusqu’à Skyfall en 2012. Barry reprendra la recette Bondienne sur le film de kung-fu Game Of Death (Le Jeu de la Mort – 1978), qui s’inspire du son du nunchaku comme élément rythmique.
1964 va être un tournant dans la notoriété de John Barry en tant que musicien de films. Il compose pour le film historique Zulu (Zoulou) qui aura un impact fort sur le public britannique. S’il se révèle encore assez peu à l’aise pour exploiter toutes les richesses du grand orchestre, il se montre brillant dans l’écriture du thème principal, ample et dynamique dans la lignée d’Elmer Bernstein. En travaillant tout naturellement pour la publicité, (on lui doit notamment le lumineux The Girl With The Sun In Her Hair), il rencontre Richard Lester sur The Knack (Le Knack… ou Comment l’Avoir – 1965), une comédie anglaise assez loufoque tournée en pleine période des Swinging Sixties. Barry imprime sa griffe dès le générique en composant une mélodie lounge du plus bel effet : cordes langoureuses, rythmique jazzy, orgue hammond et voix féminine sensuelle accompagnent un défilé de jeunes filles en jupes étroites et chandail moulant. Une galerie de mannequins qui pourrait tout aussi bien provenir des fantasmes inassouvis de Colin (Michael Crawford), que de la réalité.
Tournant résolument le dos aux grandes masses symphoniques ayant fait leurs preuves, John Barry préfère mettre en avant les instruments solistes que l’on retrouve dans la pop music. Sa collaboration avec le cinéaste anglais Bryan Forbes l’amène à adopter un style plus chambriste loin de son répertoire lyrique habituel. Sur le thriller psychologique Seance On A Wet Afternoon (Le Rideau de Brume – 1964), il développe une ambiance mystérieuse à base de flûtes, de violoncelles et de vibraphone. Les deux hommes s’apprécient mutuellement et John Barry figure même dans une séquence de Deadfall (Le Chat Croque les Diamants – 1968), en train de diriger sa Romance for Guitar and Orchestra, spécialement écrite pour le film. Pour The Whisperers (Les Chuchoteurs – 1967), The Quiller Memorandum (Le Secret du Rapport Quiller – 1966) et A Doll’s House (Maison de Poupées – 1973), il a recours à un instrumentarium atypique (clavecin, cithare, percussions métalliques) souvent proche des ambiances musicales d’un Maurice Jarre (sur les films de Franju) ou du Mancini de Wait Until Dark (Seule dans la Nuit – 1967).
L’apport de John Leach, propriétaire d’une fabuleuse collection d’instruments rares et exotiques, permet au compositeur de concrétiser certaines de ses ambitions et de créer des mélanges rares et sophistiqués. Il le rencontre sur le thriller The Ipcress File (Ipcress, Danger Immédiat – 1965). Une antithèse aux films de Bond qui lui donne l’occasion de développer un tout nouvel univers musical pour le monde de l’espionnage. C’est en effet un thème nonchalant joué au cymbalum par John Leach qui accompagne les aventures de l’espion Harry Palmer (Michael Caine). Au cinéma, Barry est l’un des tout premiers compositeurs à utiliser cet instrument de manière expressive (la même année, on compte aussi Elisabeth Lutyens qui en fait une utilisation intéressante sur le film d’épouvante The Skull – Le Crâne Maléfique). Suite au succès du film, le cymbalum devient un instrument récurrent du cinéma d’espionnage, idéal pour caractériser les tensions entre le bloc communiste et les pays capitalistes. Lalo Schifrin l’utilise sur plusieurs films et sur la série Mission: Impossible, Quincy Jones sur Ironside (L’Homme de Fer), Maurice Jarre avec The MacKintosh Man (Le Piège – 1973) et même Vladimir Cosma, sous une forme parodique, dans Le Grand Blond avec une Chaussure Noire. John Barry a eu l’occasion d’utiliser le cymbalum sur d’autres productions comme King Rat (Un Caïd – 1965), le thème de la série Vendetta (1966) ou encore le méconnu Boom! (1968) qui intègre les sonorités envoûtantes de l’orgue de barbarie.
D’abord réticent aux mélanges hybrides entre synthétiseur et orchestre, Barry reconnait avoir était décomplexé grâce aux musiques de François de Roubaix, adepte des sonorités insolites et de l’enregistrement multipistes. Sur le générique de la série The Persuaders (Amicalement Vôtre – 1972), il va mélanger astucieusement le synthétiseur moog au cymbalum hongrois. Pour créer la sonorité si particulière du thème, il utilise beaucoup de réverbération et double le cymbalum par un kentele, une mandoline et une mandole, enregistrés sur différentes pistes. Ce thème mythique joue à la fois parfaitement son rôle d’accroche sur le fameux générique en split-screen mais apporte aussi un style décalé et une dimension empreinte de gravité. John Barry reprendra ce type de combinaison instrumentale pour le générique des séries The Adventurer (L’Aventurier – 1972) et Orson Welles Great Mysteries (Les Mystères d’Orson Welles – 1973).
Avec The Chase (La Poursuite Impitoyable – 1966) d’Arthur Penn, une peinture au vitriol sur la fureur collective d’une petite ville texane, Barry signe l’un de ses premiers grands films de fiction. Durant toute la première partie du film, il se révèle particulièrement habile pour ménager la lente progression du drame à venir. Sa partition reste relativement discrète avec l’utilisation d’instruments traditionnels (harmonica, banjo) et d’une musique pop/jazz, utilisée comme fond sonore. Mais au moment du brutal passage à tabac du Shérif (Marlon Brando), Barry casse soudain ce climat d’insouciance et emploie un orchestre chargé de cordes stridentes et de cuivres lourds. Sur la séquence nocturne du cimetière de voitures où s’achève la traque de Bubber (Robert Redford), Barry compose une bouleversante mélopée funèbre (The Junkyard), dans l’esprit du jazz noir d’Alex North. La veine la plus pessimiste du compositeur s’exprime également sur le final terrifiant de The Day Of The Locust (Le Jour du Fléau – 1975) réalisé par John Schlesinger : une composition glaçante, portée par des trémolos angoissés de cordes et des phrasés de flûtes dissonants. Rien ne prépare d’ailleurs à cette atmosphère terrifiante car durant tout le film, la musique adopte un style léger marquée par le jazz et la variété des années trente.
Cette utilisation des contrastes sonores est également à l’œuvre dans Midnight Cowboy (Macadam Cowboy – 1969), signé du même réalisateur. Ce film, l’un des plus importants de la nouvelle vague américaine, retrace l’errance de deux âmes perdues dans les bas-fonds de New-York. Au début du film, Joe Buck (John Voight) venu du Texas, est un doux rêveur qui arpente les rues au son de la magnifique chanson folk d’Harry Nilsson Everybody’s Talking. Puis on entend ce thème mélancolique pour harmonica joué par Toots Thielemans qui semble vouloir dire que ses rêves ne vont pas se réaliser. Midnight Cowboy est d’ailleurs un film où les chansons jouent un rôle aussi important que la musique du film et John Barry s’est particulièrement impliqué dans la supervision musicale. En dehors des James Bond, il faut d’ailleurs rappeler que le gentleman anglais a eu régulièrement l’occasion de composer plusieurs chansons de films. Pour Born Free (Vivre Libre – 1966), il remporte même deux Oscars (musique et chanson), malgré les critiques du réalisateur qui considérait la musique comme nullissime. Parmi ses autres réussites, on peut citer le langoureux Curioser And Curioser pour Alice In Wonderland (Alice au Pays des Merveilles – 1972) et surtout Follow Me! (Sentimentalement Vôtre – 1972) interprété par le duo Roz et John. Un film à l’intrigue relativement anodine mais sublimé par ce thème envoûtant en forme de valse aux atours baroques.
Barry fait souvent appel à des cuivres au timbre rauque et profond qui convient idéalement à des films comme White Buffalo (Le Bison Blanc – 1977), un western à la lisière du fantastique, ou le bien nommé King Kong (1976). Sur la séquence où Dwan (Jessica Lange) est sacrifiée, il reprend brillamment l’héritage de Max Steiner et ajoute à la masse des cuivres sombres et des percussions une flûte ethnique et un chœur incantatoire. Mais c’est dans Dances With Wolves (Danse avec les Loups – 1990) qu’il va le mieux utiliser la part « animale » de sa musique. À travers le lyrisme de la flûte, associée au jeune loup affectueux, et la rutilance des cuivres (cors et trombones), qui rythment de manière flamboyante la superbe séquence de la chasse aux bisons. Avec ce film, Barry va délibérément rejeter la musique de western traditionnelle pour une musique plus intérieure, à l’image du parcours initiatique du lieutenant John Dunbar (Kevin Costner), un homme en fuite qui lutte dans un environnement hostile. Cette approche musicale était déjà appliquée sur Out Of Africa (1985). Plutôt que d’avoir recours à de la musique primitive africaine, John Barry y a privilégié une musique affective, qui lui permet d’exprimer au mieux les passions et les pensées des personnages. Le thème principal du film reste l’un de ses plus célèbres. Il combine des accents de cordes et de cuivres lents et raffinés à la manière des musiques romantiques de l’anglais Richard Addinsell (The Black Rose). C’est aussi une partition qui accompagne admirablement la beauté des paysages naturels du Kenya, à la manière d’un poème symphonique. Une approche musicale que l’on retrouve dans Dances With Wolves sur le splendide Journey To Fort Sedgewick , le thème qui accompagne le long voyage de John Dunbar à travers les vastes plaines du Dakota.
Maître de la musique des grands espaces, John Barry a également restitué avec talent la désolation du désert australien dans Walkabout (La Randonnée – 1970), de Nicolas Roeg. Si le film fut un bide noir, la partition de Barry, au beau souffle lyrique, mérite d’être redécouverte, tout particulièrement dans la version réenregistrée en 2000 par Nic Raine et l’Orchestre Philharmonique de Prague. Barry compose un superbe thème élégiaque pour cordes, volontairement dépouillé, ponctué par des accents de clavecins. Délaissant les cuivres, il privilégie les bois et les lignes vocales éthérées pour mettre en valeur l’innocence des deux adolescents perdus dans le désert. C’est d’ailleurs l’une des rares incursions du compositeur dans la musique chorale. Assez peu enclin à intégrer les voix au sein de l’orchestre, c’est dans les films historiques qu’il en fait la meilleure utilisation. Dans The Lion In Winter (Le Lion en Hiver – 1968), il se réfère au chant grégorien et au néo-classicisme de Carl Orff et d’Igor Stravinski. L’une des compositions les plus marquantes reste la magnifique mélodie lyrique Eleanor’s Arrival, qui accompagne l’arrivée au château d’Aliénor d’Aquitaine (Katharine Hepburn) de retour d’exil.
Pour The Last Valley (La Vallée Perdue – 1971), il compose une vaste partition épique pour chœur et orchestre à la tonalité sombre. Ce film d’aventure dramatique réalisé par James Clavell n’a pas connu le succès à sa sortie mais mérite pourtant d’être réévalué. Il fait aussi partie des films sur lesquels Barry s’est le plus impliqué musicalement. Sur le générique, il a mis en musique le poème allemand Thränen des Vaterlandes d’Andreas Gryphius, qui témoigne des atrocités de la guerre de trente ans (« les tours sont en feu, l’église est renversée (…) les vierges violées, et partout où nous regardons il y a le feu, la peste et la mort qui transperce le cœur et l’esprit »). Dans l’utilisation des cordes chargées de tensions et des masses vocales puissantes qui opposent la rugosité des voix mâles à la sérénité des voix féminines, on peut percevoir l’influence des compositeurs russes que le compositeur affectionne tant. On retrouve aussi le lyrisme d’Antonín Dvorák sur le superbe thème pastoral pour cordes et hautbois qui restitue l’atmosphère paisible du petit village perdu dans la vallée. Avec Mary, Queen Of Scots (Marie Stuart, Reine d’Écosse – 1971), c’est un retour vers une veine plus sentimentale qui permet à Barry de mettre en avant des instruments au timbre fragile (flûte, violon, harpe et clavecin). De manière inhabituelle, le compositeur choisit également de placer comme thème générique, une douce ballade médiévale (Vivre et Mourir) chantée en français par Vanessa Redgrave. Une chanson qui contraste astucieusement avec la pompe orchestrale généralement associée aux films historiques.
John Barry a toujours été attiré par l’expression de la mise en valeur des sentiments des personnages. Cet aspect lui permet d’exprimer sa veine nostalgique et mélancolique qui a toujours était au cœur de sa musique. Le flux lyrique et romantique s’exprime au mieux sur des partitions telles que The Tamarind Seed (Top Secret – 1974), First Love (Premier Rendez-Vous – 1977) ou la musique rejetée de The Appointment (Le Rendez-Vous – 1969). En renforcement des cordes, le piano est également convoqué sur Betsy (1978), Hanover Street (Guerre et Passion – 1979), Night Games (Jeux Érotiques de Nuit – 1980) et le furieusement romantique Somewhere In Time (Quelque Part dans le Temps – 1980), qui reste l’une de ses compositions les plus populaires avec plus d’un million de disques vendus. Dans la même lignée, on pourrait aussi citer Until September (French Lover – 1984), Peggy Sue Got Married (Peggy Sue s’est Mariée – 1986) et Indecent Proposal (Proposition Indécente – 1993).
Sur Petulia (1968), Frances (1982), Masquerade (1988), Swept From The Sea (Au Cœur de la Tourmente – 1997), Barry cultive des ambiances plus troubles, parfois au bord de la dépression. L’anglais sait aussi parfaitement marier le jazz au lyrisme romantique sur Body Heat (La Fièvre au Corps – 1981), qui comprend un somptueux solo de saxophone alto joué par le prodige Ronnie Lang, un musicien particulièrement apprécié par le compositeur et que l’on peut notamment retrouver sur le sublime Downtown Walker au côté du tromboniste Dick Nash et du trompettiste Tony Terran (un morceau enregistré en 1975 par Barry pour le disque Americans). Le thème principal du film, joué dans le style velouté de Paul Desmond, nimbe de mystère et d’érotisme ce thriller psychologique assez médiocre au demeurant dont le principal attrait est de remettre au goût du jour la figure vénéneuse de la femme fatale, héroïne des films noirs des années 40. L’approche éthérée de la partition est relevée par des touches de synthétiseur que Barry va développer sur le film d’angoisse Murder By Phone (Meurtre par Téléphone – 1982) et plus encore dans Jagged Edge (À Double Tranchant – 1985), film policier où le compositeur substitue ses habituelles lignes de cordes à des nappes synthétiques inquiétantes.
John Barry poursuit la veine jazz avec le polar Hammett (1982) réalisé par Wim Wenders et Cotton Club (1984) de Francis Ford Coppola, pour lequel il se contente surtout de signer des arrangements des standards des années 30. Sur Did You Call Me, composé pour The Specialist (L’Expert – 1994), on retrouve le phrasé inimitable de Ronnie Lang pour un morceau d’une grande sensualité qui accompagne l’une des scènes les plus ringardes du film, celle où Sylvester Stallone s’envoie en l’air sous la douche avec Sharon Stone. Il faut d’ailleurs préciser que malgré une filmographie de bonne tenue, John Barry a tout de même participé à quelques navetons assez embarrassants. On peut par exemple y trouver Star Crash (1978), un film de science-fiction qui surfe péniblement sur la vogue du space-opéra et sur lequel Barry semble assurer le service minimum sans grande conviction. Dans le même genre, on peut d’ailleurs largement préférer sa partition de The Black Hole (Le Trou Noir – 1979) et son thème générique en forme de valse tourbillonnante. Et puis il y a l’inénarrable Howard The Duck (Howard… Une Nouvelle Race de Héros – 1985) écrit et réalisé par les époux Huyck et Katz (un couple qui était à l’époque très courtisé par Hollywood et qui deviendra totalement banni des studios américains après le lamentable échec du film au box-office). Assez illustrative et sans grand relief, malgré un thème jazz honorable (Lullaby Of Duckland), John Barry a totalement désavoué sa partition qu’il considère comme la pire erreur de sa carrière. C’est aussi la seule musique qu’il refuse de voir éditer. Elle le sera pourtant après sa mort, grâce aux bons soins du label Intrada qui non content de le publier, en sortira trois disques dans une luxueuse édition CD !
En dehors des musiques de films, John Barry a enregistré les disques Stringbeat (1961) et Americans (1975). On lui doit également deux disques plus introspectifs : The Beyondness Of Things (1997) et Eternal Echoes (2001). Il est aussi l’auteur de plusieurs comédies musicales comme Passion Flower Hotel (1965), Lolita, My Love (1971), Billy (1974), The Little Prince And The Aviator (1981) et Brighton Rock (2004).
À écouter : John Barry – The Collection: 40 Years Of Film Music (Silva Screen), compilation très complète sur 4 CD, The Lion In Winter / Mary, Queen Of Scots (Silva Screen), Dance With Wolves (Epic), The Last Valley (Silva Screen) et Walkabout (Silva Screen), dirigés par Nic Raine (Philharmonique de la Ville de Prague) et David Temple (Crouch End Festival Chorus).