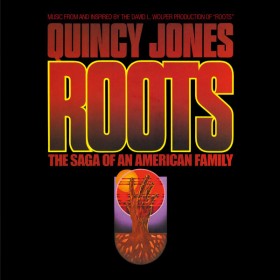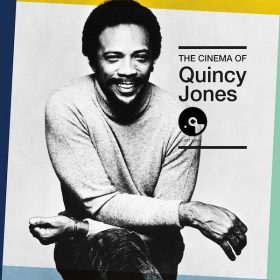UnderScores se propose de dessiner dans cette série les portraits de 50 maîtres de la musique de film, de la glorieuse génération des compositeurs hollywoodiens du passé à ceux d’une époque plus récente, sans négliger les grandes figures de la nouvelle vague européenne. Bien sûr, c’est aussi l’occasion d’aborder des personnalités plus atypiques, loin du feu des projecteurs, mais qui se révèlent tout aussi indispensables.
« Quincy Jones fait partie de cette constellation de compositeurs qui, de Henry Mancini à Michel Legrand, m’a fait comprendre une idée essentielle : il n’y a pas à choisir entre, par exemple, jazz, rythmes sud-américains et École de Vienne. Le cinéma vous permet parfaitement d’amalgamer toutes ces influences, de les convertir en une seule voix : la vôtre. »
Alexandre Desplat
Jazzman accompli et arrangeur hors pair, Quincy Jones a laissé une empreinte marquante dans la musique de film et de télévision de la période 1964-1972. Son expertise du jazz, de la soul, de la musique orchestrale et de la bossa-nova l’ont conduit à la composition de partitions de films. Le grand public connaît peu son travail pour le 7ème art, il est pourtant passionnant, en dépit de sa brièveté. Au milieu des années 60, Hollywood devient un véritable terrain d’expérimentations musicales dans lequel Jones, comme d’autres musiciens pluridisciplinaires tels qu’Elmer Bernstein, Lalo Schifrin ou David Shire, vont s’engouffrer avec délice. Suivant le précepte de son mentor Duke Ellington qui voulait décompartimenter la musique, Quincy Jones va écrire une quarantaine de partitions pour l’écran, dans des styles très variés. En l’espace de huit ans, il va complètement redéfinir la conception de l’espace sonore, combinant le jazz, l’orchestre et le funk, grâce à un jeu subtil sur les timbres et les nuances. Une couleur unique directement issue de son expérience des orchestres de Duke Ellington et de Count Basie. En perfectionnant les schémas mis en place par Alex North, Henry Mancini et Armando Trovaioli, il conçoit un autre jazz du cinéma, en mobilisant sans retenue les qualités d’improvisateurs de ses musiciens. Son succès ouvre aussi la voie à d’autres compositeurs afro-américains comme Oliver Nelson, Benny Golson et Jay Jay Johnson. Totalement polyvalent, il est capable d’écrire indistinctement pour big band ou orchestre classique, à la fois nourri des influences de Stravinski et de Charlie Parker.
Né d’un père charpentier et d’une mère schizophrène internée dans un asile psychiatrique, le jeune Quincy Jones grandit dans l’un des ghettos les plus mal famés du South Side de Chicago. Pour sa sécurité, il avait toujours sur lui un couteau à cran d’arrêt pour se protéger des bandes rivales qui exerçaient la loi dans les quartiers. C’était une petite teigne rachitique qui passait son temps à se bagarrer et à chaparder de la nourriture. Durant la Grande Dépression, les hivers étaient rudes et Quincy devait alors se nourrir de tout ce qui lui tombait sous la main. Gombos, moutarde brune, opossum, poulet ou parfois même du rat que sa grand-mère faisait frire. Un soir, au cours de ses rapines, il découvre un vieux piano droit dans une salle des fêtes. C’est une révélation. En pianotant quelques notes, il a pour la première fois la sensation d’être en paix avec lui-même, comme s’il retrouvait la présence de sa mère. Avant sa maladie, c’était une femme très cultivée qui chantait et jouait des airs de musiques sacrées au piano. Quincy Jones a lui aussi hérité de cette sensibilité musicale. Dès qu’il en a l’occasion, il perfectionne son jeu sur ce piano, inspiré par le blues, le gospel et le boogie-woogie. En 1947, à Seattle, il découvre avec fascination les formations de be-bop, de rhythm and blues et d’orchestre Dixieland. Il s’initie à la trompette au côté de Clark Terry et joue dans l’orchestre junior du vibraphoniste Bumps Blackwell. Un orchestre avec « attractions » comprenant danseurs de claquettes, strip-teaseuses et répertoire comique. Une œuvre de jeunesse, la Suite aux Quatre Vents, lui permet d’obtenir une bourse d’étude et d’attirer l’attention du milieu musical. C’est à l’âge de 18 ans qu’il commence à vivre de son art, en se formant au jazz dans les orchestres de Lionel Hampton et de Dizzy Gillespie. Hyper talentueux, il se fait vite un nom dans l’industrie du disque et devient dans les années 60 un arrangeur que tout le monde s’arrache. Le célèbre Frank Sinatra restera pour lui un fidèle partenaire musical et un conseiller indispensable. À Paris, il travaille pour le label d’Eddie Barclay et prend des cours avec la célèbre Nadia Boulanger qui lui fait analyser L’Oiseau de Feu de Stravinski et Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.
Depuis l’adolescence, Quincy Jones est intéressé par le cinéma. À quinze ans, il découvre le livre théorique de Frank Skinner Underscore. Au cinéma, il arrive déjà à identifier le nom des compagnies de films, à la seule écoute des musiques. Celles d’Alfred Newman pour la Fox, de Victor Young pour la Paramount ou de Stanley Wilson pour Republic. En 1961, lors d’une tournée en Suède, le réalisateur Arne Sucksdorff lui demande de composer la musique de son film Pojken i Trädet (Le Garçon dans l’Arbre). Portée par des voix chaudes et éthérées, la partition jazz témoigne déjà d’une grande habileté dans l’utilisation des parties solistes comme la flûte et le saxophone. L’année d’après, avec le succès de son titre instrumental Soul Bossa Nova, Jones commence à attirer l’attention du grand public. La demande grandissante de la télévision, avec la multiplication des séries policières, et les succès répétés des disques de bande originale vont aussi concourir au développement du jazz.
Le réalisateur Sidney Lumet, intéressé par sa musique, lui donne carte blanche pour The Pawnbroker (Le Prêteur sur Gages – 1964), l’histoire d’un usurier juif new-yorkais, hanté par le souvenir des camps de la mort. C’est un coup de maître pour Quincy Jones qui signe une partition inventive, combinant jazz, rythmes cubains et orchestre à cordes. Il compose la musique en deux mois, et l’enregistre en deux jours dans les studios de son ami Phil Ramone. Pour la partie jazz, il recrute les meilleurs solistes de l’époque comme le fameux Dizzy Gillespie, le trompettiste Freddie Hubbard, le batteur Elvin Jones, le saxophoniste Oliver Nelson et le pianiste Bobby Scott. Pour la partie symphonique, Jones bénéficie d’un orchestre de cinquante musiciens comprenant une harpiste, une section de bois, de cordes et des percussionnistes. Lumet explique que tout le concept de la partition était le nouveau monde contre l’ancien monde, le premier étant représenté par le jazz et le second par les violons. L’intérêt était de montrer comment l’élément jazz de Harlem devenait de plus en plus dominant, au fur et à mesure de l’humanisation du prêteur sur gages (joué par Rod Steiger).
Ce film offre à Quincy Jones l’occasion d’élaborer des orchestrations avec pupitres de cordes, ce qui à l’époque n’était pas évident pour un afro-américain. Il n’y a qu’en France qu’il avait bénéficié de cette liberté : aux États-Unis, dans n’importe quelle maison de disques, les noirs qui souhaitaient écrire pour les cordes se faisaient envoyer direct à la section blues et jazz. Elles étaient alors considérées comme un élément sophistiqué réservé aux blancs. Heureusement pour Jones, le film de Lumet est produit par un indépendant et distribué par une petite compagnie qui lui accordent une totale confiance dans ses choix artistiques. Il ne retrouvera pratiquement plus jamais pareille autonomie sur ses autres travaux au cinéma. Dans le film, les cordes sont principalement utilisées pour accompagner le rêve/flashback du prêteur qui se souvient des jours heureux passées avec sa famille et ses proches. Elles se mêlent avec une grande sensualité à une orchestration raffinée (harpe, clavecin, vibraphone, flûte) digne des partitions lyriques d’Alex North ou d’Elmer Bernstein. Sur d’autres films, l’utilisation des cordes va également être sollicitée à plusieurs reprises sur des chansons génériques telles que Maybe Tomorrow chanté par Evie Sands dans John And Mary (1969) ou The Time For Love Is Anytime par Sarah Vaughan dans la comédie Cactus Flower (1969).
C’est grâce à Sidney Lumet que Quincy Jones devient un véritable professionnel de la musique pour l’image. On le retrouve sur d’autres films du cinéaste comme The Deadly Affair (M15 Demande Protection – 1967), qui contient un thème générique de toute beauté chanté par Astrud Gilberto (Who Needs Forever ?) : un rythme chaloupé de bossa nova enveloppé par un tapis de cordes sensuelles et un saxophone ténor au timbre chaud joué par Zoot Sims. Last Of The Mobile Hot Shots (1970), adaptation d’une pièce de Tennessee Williams, lui permet de retranscrire l’atmosphère musicale du sud des États-Unis par l’emploi du banjo et de l’harmonica intégrés au sein de l’orchestre. La musique est cependant d’un intérêt relatif, un peu à l’image du film qui passe totalement inaperçu. The Anderson Tapes (Le Gang Anderson – 1971), film assez mineur de Lumet, opère quant à lui un virage plus électrique et groovy par rapport à The Pawnbroker. On regrette surtout que Quincy n’ait pas participé à Serpico, film sur la corruption policière dans lequel le grec Míkis Theodorákis s’est révélé peu à son aise pour retranscrire l’atmosphère urbaine de la ville de New-York.
Avec Mirage (1965), thriller paranoïaque hanté par la guerre froide, Quincy Jones élabore un jazz orchestral sophistiqué, assez influencé par le style de Mancini dans le traitement langoureux des cordes, mais avec une touche plus innovante dans l’enchevêtrement des textures sonores et l’utilisation marquée des cuivres et des percussions. Un morceau comme The Naked Thruth reste par exemple assez remarquable par sa richesse instrumentale et sa dimension dramatique. C’est d’ailleurs dans le registre du suspense que Jones se révèle souvent le mieux inspiré. Son travail le plus intéressant en la matière reste In Cold Blood (Meurtre de Sang-Froid – 1967) réalisé par Richard Brooks. Tourné de manière très réaliste, dans un noir et blanc inquiétant, le film est adapté d’une nouvelle de Truman Capote, elle-même inspirée d’un fait divers macabre. Un casse à main armée dans une petite villa familiale qui tourne au meurtre sanguinolent lorsque les deux braqueurs constatent l’absence de butin. Fait assez inhabituel, le réalisateur engage Quincy Jones bien avant les acteurs et l’encourage à innover. Brooks est d’autant plus méritant qu’il résiste aux pressions de la production et de l’auteur Truman Capote qui ne comprend pas l’intérêt d’engager un noir pour un film joué par des blancs. Après avoir vu le film, avec la musique mixée, Capote finira par s’excuser platement auprès de Jones. Rétrospectivement, c’est l’une des partitions dont le compositeur est le plus fier. Pour s’inspirer du profil psychologique des deux meurtriers, il visite la clinique Menninger et écoute leurs interrogatoires. Confrontant le jazz à l’avant-garde, il s’emploie à trouver une couleur musicale inhabituelle. Des violoncelles dans le grave, sombres et inquiétants, et deux contrebasses interprétées par les fameux Ray Brown et Andy Simpkins, qui reflètent la voix intérieure des deux assassins. Le plus intéressant dans la partition reste surtout la manière dont il superpose le jazz à des techniques d’orchestrations sophistiquées incluant claquements de doigts, claques corporelles, cliquetis de bouteilles ou bruits de bouches. L’atmosphère musicale fonctionne comme dans un film d’épouvante avec des titres lourds de menace, comme le remarquable Seduction, aux cordes alanguies. On notera également une utilisation magistrale de l’orgue sur Murder Scene. Un titre qui ne figure curieusement pas sur le montage final du film, sans doute à cause d’un parti pris de réalisme sonore.
En 1968, Quincy Jones participe au téléfilm Jigsaw, qui reprend la trame de Mirage. La tension psychologique de l’histoire, notamment dans la première partie lorsque le personnage principal prend du LSD, lui permet d’élaborer une atmosphère de jazz psychédélique. On y trouve notamment des effets électroniques et des phénomènes d’écho sur les instruments, qui renvoient aux compositions de Jerry Goldsmith. Comme son collègue américain, Jones s’intéresse aux possibilités de l’électronique et utilise un Minimoog en ouverture du thème générique de la série policière Ironside (L’Homme de Fer – 1967). Cette partition est d’ailleurs réputée pour avoir était la première à utiliser un synthétiseur dans une série télévisée. En 1963, on peut déjà relever cependant une utilisation de l’électronique sur le générique de la série Doctor Who, réalisée par la talentueuse Delia Derbyshire. Les cadences de la télévision sont infernales. Devant la somme de travail à abattre chaque semaine pour la série, Jones cède rapidement la main à son ami Oliver Nelson, qui décède quelques années après à l’issue d’une séance d’enregistrement.
Toujours dans l’idée d’ajouter de nouvelles couleurs à son orchestre, il intègre les premiers synthétiseurs, fournis par le meilleur spécialiste de l’époque, Paul Beaver. C’est dans son antre qu’il découvre le Rhodes, le Moog, le Clavinet à touches sensibles et le Novachord, dont les sonorités lui ouvrent de nouveaux horizons. On peut avoir un assez bon aperçu de l’utilisation de cette nouvelle lutherie musicale dans A Dandy In Aspic (Maldonne pour un Espion – 1968) et The Anderson Tapes (Le Gang Anderson – 1971). Quincy Jones tente aussi de sortir des polars et des films de casses traditionnels auquel son nom est régulièrement accolé en composant la musique du western Mackenna’s Gold (L’Or de Mackenna – 1969). Le résultat est honorable mais parait quelque peu daté par rapport au renouveau musical insufflé par le western spaghetti italien. Il signe également quelques court-métrages d’animation réalisés par le couple John et Faith Hubley, comprenant Of Men And Demons (1969), Eggs (1970) et Dig (1972).
L’acteur afro-américain Sidney Poitier est un ami de longue date du compositeur. À partir de The Slender Thread (Trente Minutes de Sursis – 1965), ils vont collaborer sur plusieurs films, dont le plus célèbre reste In The Heat Of The Night (Dans la Chaleur de la Nuit – 1967), réalisé par Norman Jewison. Un polar aux tonalités antiracistes, tourné dans une petite ville du fin fond du Mississippi. Rod Steiger y interprète Gillespie (on notera l’humour des scénaristes dans le choix du patronyme), un flic aux relents racistes qui se retrouve à devoir faire équipe avec un noir, spécialiste des affaires de meurtres. C’est Ray Charles, un vieux copain de Quincy, qui interprète la chanson-générique au côté de ses Raelettes. Tout au long du film, Jones enchevêtre plusieurs couleurs musicales, en faisant cohabiter orchestre classique, cuivres jazzy et blues du sud des États-Unis. Mais ce qui frappe avant tout c’est la manière dont il utilise les pleines ressources de ses musiciens. La contrebasse de Ray Brown, le poly-instrumentiste aveugle Roland Kirk, qui grommelle littéralement dans sa flûte, Don Elliott avec ses effets vocaux ahurissants, le guitariste et chanteur folk Glen Campbell, musicien d’instinct qui ne sait pas lire la musique, et Billy Preston à l’orgue Hammond B3. Pour traduire l’effet de déracinement de l’officier de police, interprété par Sidney Poitier, il ajoute aussi un cymbalum, instrument à cordes frappées d’Europe de l’Est (utilisé notamment sur l’excellente pièce Shag Bag, Hounds & Harvey.) On peut sans doute y voir un clin d’œil à Stravinski, grand amateur de l’instrument, qui en faisait régulièrement usage (les ballets Noces et Renard). En 1957, par l’entremise de Nadia Boulanger, Jones avait d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer le vieux maître lors de son séjour en France alors qu’il n’était qu’un simple arrangeur chez Barclay. Entre les audaces harmoniques d’Agon et l’humour primesautier des chansons d’Henri Salvador, tout un monde les séparait encore.
Quincy Jones va retrouver Sidney Poitier sur plusieurs séries B dans la lignée du film de Jewison, à commencer par la suite de In The Heat Of The Night, They Call Me Mister Tibbs! (Appelez-moi Monsieur Tibbs ! – 1970) réalisé par Gordon Douglas, une partition qui amorce un virage beaucoup plus groove et funky, avec un thème principal efficace dans la lignée de Lalo Schifrin. The Lost Man (L’Homme Perdu – 1969), qui réunit le duo Sydney Poitier et Joanna Shimkus, est également intéressant, en particulier sur le générique d’ouverture. La musique combine deux strates sonores qui se superposent étrangement, un peu à la manière de Charles Ives : d’un côté, une comptine chantée et sifflée par un chœur d’enfants ; de l’autre, un orchestre sombre et tendu rythmé par des percussions. Tout est construit sur un aller-retour entre la naïveté des enfants, et l’impression du drame qui se noue.
En 1968, Quincy Jones signe encore une composition remarquable avec The Split (Le Crime, c’est notre Business), réalisé par Gordon Flemyng. Un solide film de casse, qui préfigure certaines figures de style de la blaxploitation. Outre la chanson-générique interprétée par Billy Preston, on notera la longue séquence musicale du hold-up portée par une formidable ligne de basse et la poursuite de voiture entre Mc Clain (Jim Brown) et Kifka (Jack Klugman), rythmée par les cuivres, la guitare électrique et l’orgue Hammond. Un genre dans lequel Jones va se révéler particulièrement inspiré. Il est idéalement désigné pour Bullitt, film mémorable pour sa séquence urbaine de course-poursuite, mais une appendicectomie l’empêche de composer la musique. L’argentin Lalo Schifrin prendra la relève haut la main et deviendra célèbre après le succès du film. Sans cette opération, on peut sans doute penser que la carrière cinématographique de Jones aurait pu décoller, car il méritait beaucoup mieux que les petits polars d’actions dans lequel les producteurs hollywoodiens vont principalement le cantonner.
En 1969, il débarque à Londres et s’installe dans un minuscule appartement de Marble Arch pour écrire la bande originale de The Italian Job (L’Or se Barre – 1969), une comédie automobile au scénario en roue libre avec le célèbre Michael Caine. Là encore, le compositeur déploie un savoir-faire indéniable dans l’accompagnement musical des courses-poursuites, dont une de pure bravoure, tournée en plein milieu d’un fleuve. Le ton humoristique de l’histoire l’amène toutefois à privilégier une écriture légère et décalée qui confronte le funk au folklore populaire anglais. En 1971, avec Dollars, il récidive avec un film de casse en collaborant à nouveau avec le réalisateur Richard Brooks. Little Richard et Roberta Flack sont conviés à pousser la chansonnette et Jones délivre un thème mémorable avec Money Runner, rythmé par la basse endiablée de Dave Grusin et les prouesses vocales de Don Elliott.
Perfectionniste du son, Quincy Jones finit par délaisser le cinéma, en partie à cause de contraintes techniques. La conversion du son magnétique au son optique mono, sur les copies 35mm, était selon lui tout à fait catastrophique. « Pendant des nuits entières, je chiadais les prises de son, les mixages… et en découvrant le film en salle, je prenais en pleine tronche un son optique compressé, sans grave ni aigu. Sur In Cold Blood, les violoncelles sombres étaient littéralement dissous dans une masse compacte… » Jones a aussi regretté de ne plus avoir la même liberté artistique qu’il entretenait avec Sidney Lumet ou Richard Brooks. En 1972, il compose dans l’urgence The New Centurions (Les Flics ne Dorment pas la Nuit), un très bon polar réalisé par Richard Fleischer, qui aurait mérité une partition nettement plus travaillée et avant-gardiste qu’un score d’ambiance jazz funk fait à la va-vite.
Après l’éviction de Jerry Fielding, il compose The Getaway (Guet-Apens) en seulement une dizaine de jours. C’est Toots Thielemans, déjà convoqué sur Walk Don’t Run (Rien ne Sert de Courir – 1966) et Banning (1967), qui accompagne de son harmonica au phrasé inimitable la romance entre Steve McQueen et Ali MacGraw. Le travail de Jones ne démérite pas, notamment dans la séquence du casse de la banque, où la musique faite de tension électronique, de pulsation vocale et de rythmes funky, épouse parfaitement la dynamique du montage. Un laps de temps supplémentaire lui aurait certainement permis de confectionner une partition plus ambitieuse pour l’un des plus gros succès de Sam Peckinpah. Cette composition marque aussi la fin de sa carrière intense pour le cinéma.
En 1977, Quincy Jones compose la musique du premier épisode de la mini-série Roots (Racines), une fresque sur le destin d’une famille afro-américaine en proie à l’esclavage et aux soubresauts de l’histoire raciale aux États-Unis. À ce jour, elle reste l’une des séries les plus regardées de toute l’histoire de la télé américaine. Inspiré par la musique traditionnelle nigériane, il compose le chant Oluwa, interprété par la diva sud-africaine Letta Mbulu. Les autres épisodes sont mis en musique de manière plus conventionnelle par Gerald Fried. En 1978, Sidney Lumet l’engage comme superviseur musical de The Wiz, relecture moderne du Magicien d’Oz, avec le jeune Michael Jackson dans le rôle de l’épouvantail. Avec lui, Jones participera à trois albums mythiques en tant que producteur musical, dont la pierre angulaire reste le célèbre Thriller en 1982.
Avec Steven Spielberg, il co-produit en 1985 The Color Purple (La Couleur Pourpre), projet qui lui permet de replonger dans la musique noire de sa jeunesse. Sur une demande de Spielberg, il s’inspire assez grossièrement du très beau thème principal de Georges Delerue à la flûte pour Our Mother’s House. Sa fonction de producteur lui laisse peu de temps pour composer et l’oblige à s’entourer de nombreux orchestrateurs/arrangeurs pour finaliser la partition. Il est en revanche plus inspiré dans l’écriture des musiques populaires inspirées par les juke-joint du Mississippi et du jazz de Saint-Louis. On retiendra tout particulièrement le superbe Miss Celie’s Blues (Sister), une chanson co-composée par Rod Temperton (l’auteur de Thriller) qui exprime l’amour de Shug (Margaret Avery) pour Celie (Whoopi Goldberg). Enregistrée par Táta Vega, qui figurait déjà sur le score de The Hot Rock (Les Quatre Malfrats – 1972), la chanson est finement arrangée pour piano honky tonk, harmonica, guitare et mandoline. Fait cocasse à signaler : à la sortie du film, Steven Spielberg, subira un peu la même discrimination raciale que Quincy Jones à ses débuts, une partie du public ne comprenant pas pourquoi un réalisateur juif, et blanc de surcroît, pouvait mettre en scène un film écrit et interprété essentiellement par des noirs !
À écouter :
Le Cinéma de Quincy Jones chez Universal Music
The Pawnbroker / The Deadly Affair chez Verve Records
In The Heat Of The Night / They Call Me Mister Tibbs ! chez Ryko
The Split chez Film Score Monthly
À visionner : Quincy Jones, un documentaire assez convenu réalisé par sa fille Rashida Jones et Alan Hicks.
À lire : La biographie Quincy par Quincy Jones. Pas mal d’anecdotes intéressantes sur l’enfance et l’adolescence du compositeur, mais l’auteur s’attarde très peu sur sa carrière de compositeur de cinéma.