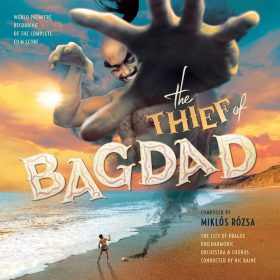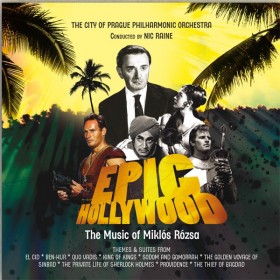THE RED HOUSE (1947)
THE RED HOUSE (1947)
LA MAISON ROUGE
Compositeur : Miklós Rózsa
Durée : 81:45 | 33 pistes
Éditeur : Intrada
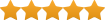
Une forêt interdite où décantent mystère et pulsions primaires. Une maison hantée par un secret familial. Deux jeunes héros encore naïfs (Meg et Nath) confrontés aux sombres échos du passé. Un réalisateur, Delmer Daves, qui juste avant son célèbre Dark Passage (Les Passagers de la Nuit), réalise un thriller campagnard pétri de symbolisme. Les visages familiers d’Edward G. Robinson (Pete) en vieil homme saisi par la folie, et de Judith Anderson, ex-gouvernante de Rebecca. Le noir et blanc quasi expressionniste du chef-opérateur Bert Glennon, à l’atmosphère d’autant plus remarquable que le film a été tourné loin des backlots des studios. Enfin, transcendant l’image, ouvrant un peu plus encore la perception du spectateur vers l’indicible, la musique de Miklós Rózsa.
Petite production presque oubliée, The Red House n’en a pas moins ses fans – au premier rang desquels Martin Scorcese – et de jolies qualités à faire valoir. Adaptation du roman de George Agnew Chamberlain sorti deux ans plus tôt, le film s’inscrit dans la lignée des thrillers psychologiques de l’époque, particulièrement Spellbound (La Maison du Dr. Edwardes) d’Hitchcock, y ajoutant la dimension gothique d’une nature vécue comme projection de la psyché humaine, prairie lumineuse et forêt profonde se trouvant symboliquement opposées à la manière d’un conte. Pas de Chaperon Rouge, de loup ni de sorcière, mais, en dépit de l’atmosphère flirtant avec le fantastique, et sans dévoiler le dénouement, un fait-divers tristement humain.
Le moindre des bons choix de la production n’est pas d’avoir choisi Miklós Rózsa, alors dans sa période « psychologique », pour accentuer les contrastes et l’atmosphère passionnée du film. Mais cela n’a rien d’un hasard. À la demande insistante d’Edward G. Robinson, le compositeur accepte de réutiliser les modulations fantomatiques du thérémine (qui ont déjà fait le succès de Spellbound et The Lost Week-End) afin de souligner un trouble mental, mais aussi, selon les scènes, un orgue électrique, un chœur féminin avec effet d’écho, associés aux traditionnels vibraphone et célesta. Dès la première scène de découverte des bois d’Ox Head où s’aventure le jeune Nath poursuivi par le vent et la nuit, un panneau « Entrez à vos risques et périls » nous avertit. Une menace sourd entre les troncs moussus, s’étire en hurlant dans les branchages, marquant un interdit, une barrière qu’il faudra surmonter. Par les seules forces de la musique et d’une photo sculptant les ténèbres (la caméra restant sage), la nature acquiert une dimension quasi surnaturelle dont l’idée nous renvoie à Blanche Neige et les Sept Nains ou à La Belle et la Bête de Cocteau. Cependant la nature est double, l’apport de Rózsa ne se réduit pas à cette dimension inquiétante. Peut-être encouragé par les références de Robinson au Pelléas et Mellisandre de Maeterlinck, le compositeur hongrois profite des scènes champêtres pour développer ses propres racines, ici nourries par un terreau expressionniste proche de Debussy : le chant positif de la nature, cet éveil bucolique si bien exprimé dans The Jungle Book (Le Livre de la Jungle), Lust For Life (La Vie Passionnée de Vincent van Gogh), ou ses œuvres de concert, tel l’Hungarian Nocturne. Il fallait peut-être un compositeur originaire d’Europe centrale, Rózsa en particulier, pour combiner à ce niveau lyrisme, féerie et rusticité, pour évoquer d’un seul geste le fourmillement coruscant de la nature et, tapie dans l’ombre, la noirceur des contes ancestraux réceptacles de nos songes secrets.
À l’orée du bois d’Ox Head, trois chemins s’offrent au randonneur mélomane. Le plus étroit mène à une futaie de douze minutes dirigée par Rózsa à la tête d’un orchestre de studio, extraits associés au Spellbound Concerto dirigé par Erich Kloss sur un 78 Tours paru à la sortie du film. Disponible sur CD Angel ou en téléchargement chez Naxos Classic Archives, cet enregistrement mono au son bien moins qu’idéal n’est pas le meilleur moyen d’apprécier l’œuvre, malgré la battue caractéristique du compositeur. Les collectionneurs trouveront tout de même leur compte dans ce témoignage d’époque, la musique étant parfois peu audible dans le film lui-même.
Un autre sentier, bien moins caillouteux, nous conduit dans une immense clairière. Celle du Kingsway Hall plein du National Philharmonic Orchestra et des Ambrosian Singers dirigés en 1975 par Charles Gerhardt pour sa série des Classic Film Scores, en LP puis diverses incarnations CD, dont un mix quadriphonique SACD chez Dutton. Le thérémine y est remplacé par un synthétiseur ARP, mais la prise de son spacieuse compense largement ce détail. Le seul vrai défaut de cette clairière magique est sa durée, encore douze minutes, intenses mais qui laissent le défricheur sur sa faim. Sa puissance, les arrangements flatteurs typiques de cette série, le fait qu’il a longtemps été le seul enregistrement moderne disponible, en font néanmoins un indispensable.
Enfin, le troisième chemin s’enfonce au plus profond d’une sylve aux mille mystères, jusqu’à une maison rouge entièrement rebâtie en 2012 par le label Intrada : Kevin Kaska reconstitue les plans d’origine, les artisans du Royal Scottish National Orchestra et du Winchester Cathedral Chamber Choir érigent murs et toit sous les ordres de l’architecte Allan Wilson. Vibrant, dynamique, profond : en quatre-vingt-deux minutes, du Main Title à Pete’s Death, le redux d’Intrada rend toutes ses dimensions à l’œuvre, sa tendresse inquiète (Meg Asks Questions) comme ses miroitements boisés et irruptions de violence (Attack In The Woods). Les très beaux thèmes typiques de Rózsa (principalement la maison, Meg et son amour pour Nath, la ferme bucolique et Pete, incarné par deux motifs complémentaires) trouvent enfin l’espace pour déployer leurs branches, greffés à la canopée tour à tour dense et arachnéenne des orchestrations du compositeur, avant de s’achever par des End Titles qui empruntent leur arrangement (plus développé que dans le film) à la suite de Gerhardt. Un choix que Rózsa aurait à l’évidence applaudi.
Étonnamment, le compositeur passe quasiment sous silence ce très bel opus dans son autobiographie. Sans doute estimait-il que cette production oubliée ne valait pas d’en parler, ou bien en avait-il gardé le souvenir d’une collaboration banale, à moins qu’il n’ait simplement oublié la qualité de son propre travail. Ce ne sera pas votre cas si, cédant au trouble murmure de la forêt, vous décidez d’y entrer.