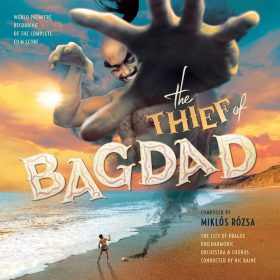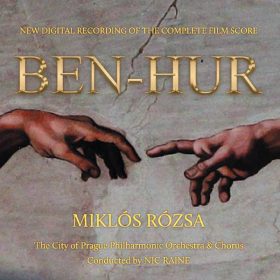Il est des partitions tellement légendaires qu’il est difficile d’en parler. Ben-Hur fait partie de ces œuvres si colossales, si parfaites que la tâche semble herculéenne. Ce qui n’était heureusement pas le cas pour l’auteur de ce chef d’œuvre de la musique de film. La transcription que vous allez découvrir provient d’un enregistrement effectué par le Dr. Rózsa lui-même en 1981, plus de vingt ans après la sortie du film de William Wyler. Un témoignage au cours duquel le compositeur revient avec moult détails sur la production de Quo Vadis et de Ben-Hur et nous propose une plongée au cœur des studios hollywoodiens des années soixante…
J’ai écrit la musique de Quo Vadis. Ce n’était pas une tâche facile, mais j’étais très désireux de faire ce film, et avec le recul, trente-et-un ans après, je dois dire que cela en valait la peine. Le film a été produit en Europe par la MGM. Un film de cette ampleur ne pouvait pas être tourné à Hollywood, même à cette époque. Il y avait des milliers de figurants… Il aurait coûté bien plus cher que son budget final de sept millions de dollars. On considérait alors que c’était le film le plus cher jamais produit ; aujourd’hui, la comédie la plus stupide coûte bien davantage. En fait, j’avais un ange gardien à la MGM, L.K. Sydney. M. Sydney m’appela un jour dans son bureau et m’annonça : « Nous avons un très gros film en préparation, Quo Vadis. J’aimerais que vous en écriviez la musique. Cependant, il y a quelques difficultés. Le film sera tourné en Europe et nous essayons d’avoir autant de scénaristes, compositeurs, acteurs et techniciens européens que possible ». J’ai demandé pourquoi. « Ils sont moins chers », répondit-il. « Voici une liste de compositeurs suggérés par notre directeur financier (j’aime quand les directeurs financiers font des suggestions sur les questions artistiques !). Qu’en pensez-vous ? » Il y avait des compositeurs italiens, anglais, français. J’ai parcouru cette liste et j’ai dit : « Il n’y a qu’un seul nom que j’approuve totalement, c’est Sir William Walton. Si vous pouvez l’avoir, vous n’aurez pas besoin de moi. » Apparemment Sydney l’appréciait, mais il a ajouté : « Oui, mais je veux que ce soit vous ». Je répondis : « J’aimerais beaucoup, mais je dois préciser que ne pourrais pas faire mieux que William Walton. » « C’est entendu, laissez-moi m’en occuper ».
Bien sûr, il y avait dans la liste quelques noms absolument impossibles, des compositeurs de seconde zone. Je lui ai signalé ce point, en expliquant qu’il n’était pas envisageable de les engager pour un sujet aussi sérieux et d’une telle ampleur. Peu de temps après, il m’appelait de nouveau dans son bureau et m’annonçait : « Tout est arrangé, c’est vous qui allez écrire la musique de Quo Vadis.» J’étais enchanté et je me suis mis au travail immédiatement. Il y avait un script et un producteur, qui était l’un de mes vieux amis à Londres, Hugh Gray. Nous avons commencé à travailler sur plusieurs séquences musicales qui devaient être composées avant le tournage. Le réalisateur, Mervyn LeRoy, est entré un jour dans mon bureau et a demandé à entendre quelques extraits de la musique. Je lui en ai joué et il m’a dit « Je n’ai pas beaucoup de temps, j’écouterai le reste à Rome ». « Mais je ne vais pas à Rome », répondis-je. « Pourquoi pas? » « Parce que personne ne m’a dit que que j’allais à Rome ! » « C’est complètement absurde, nous emmenons les techniciens de plateau et pas le compositeur ! » s’exclama-t-il. « Mon cher Mervyn, c’est à vous de voir… » Il s’est précipité dans le bureau de Louis B. Mayer et lui a fait une scène. Mayer, qui n’avait rien à voir dans cette affaire, lui a dit : « Bien sûr, emmenez-le ! ». C’est comme ça que finalement, je me suis retrouvé à Rome.
Pendant ce temps-là, j’avais été convoqué chez un autre responsable de la MGM, Eddie Mannix, un rude petit irlandais, qui m’a dit : « J’ai appris que vous alliez à Rome. D’accord, vous pouvez y aller, mais à condition que vous en profitiez pour faire un deuxième film pour nous à Londres ». « M. Mannix, si c’est le prix à payer pour aller à Rome, j’irai composer jusque sur la Lune ! ». Le film en question était The Miniver Story, la suite de Mrs. Miniver (Madame Miniver). Mais avant, je devais me rendre à Rome, qui est la ville la plus merveilleuse qui soit. Aujourd’hui, avec le terrorisme, le banditisme et toutes ces choses terribles, c’est différent des années 50. Mais à cette époque, cinq ans après la guerre, il y avait une sorte d’euphorie, de bonheur, et tout était extraordinairement bon marché. Je suis donc arrivé à Rome, j’ai fait tout ce qu’il y avait à faire, à commencer par me trouver un assistant, un jeune musicien anglais, Marcus Dodds, qui depuis s’est fait un nom en Angleterre comme compositeur et chef d’orchestre. Et je suis finalement rentré à Hollywood, mais entretemps, je m’étais lié d’amitié avec le producteur Sam Zimbalist. C’était un homme très intéressant, il n’avait pas une grande instruction (il avait été monteur pour les studios, et voyait toujours les choses sous l’angle du montage), mais il connaissait bien le business du cinéma. Il ne connaissait pas grand chose à la musique, mais nous avons discuté, je lui ai joué ma musique (qu’il n’a pas comprise), et il m’a fait confiance, ce qui était suffisant.
Quand tout le monde est rentré, après avoir composé la musique, je suis allé à Londres pour l’enregistrer, car le film étant européen, le studio était autorisé à enregistrer en Europe. J’ai choisi le Royal Philharmonic Orchestra. J’adorais cet orchestre depuis mes années londoniennes, quand j’allais l’entendre sous la baguette de Sir Thomas Beecham. Je trouvais que c’était une superbe phalange de musiciens et c’était eux que je voulais pour ces sessions d’enregistrement. J’ai pu avoir l’orchestre au complet ainsi que les chœurs de la BBC. Et tout ceux qui ont vu Quo Vadis, qui passe souvent à la télévision, et l’ont entendu savent ce qu’est un chœur exceptionnel !
De retour à Hollywood, il y eut la phase du mixage des voix, des effets sonores et de la musique. C’est à ce moment que mon ami Zimbalist se révéla très négatif vis-à-vis de la musique, non qu’il ne l’aimât pas, mais il ne voulait pas trop l’entendre, il préférait les effets sonores. Bien sûr, il n’était pas le seul. C’est d’ailleurs l’un des grands crimes d’Hollywood contre l’art musical que de noyer la musique sous des effets sonores idiots. Je dois ajouter qu’Alain Resnais, avec qui j’ai fait un film à Paris il y a quatre ans (Providence – NDLR), m’a expliqué qu’il utilisait soit des effets sonores soit la musique, mais pas les deux. Je trouve cela très avisé, car les bruitages combattent la musique, et le résultat est qu’on ne les entend pas assez et qu’on n’entend pas du tout la musique. Alors à quoi bon en avoir ? Néanmoins, il fallut en passer par là, le film fut un grand succès et lança une mode nouvelle à Hollywood, celle de la superproduction biblico-historique. Il y en avait eu avant bien sûr, mais pas de cette ampleur, avec toutes les nouvelles ressources de la technique.
Comme je disais, Zimbalist et moi sommes donc devenus amis. C’était la seule personne – et j’insiste sur le fait que je suis resté quatorze ans de ma vie à la MGM – que je pouvais aller trouver à la fin de la journée en lui disant : « J’aimerais discuter, je peux passer dans votre bureau ?». « Venez » répondait-il. J’accourais dans son bureau et on discutait pendant une heure, de tout, pas seulement de cinéma, mais d’art, de musique. Je me souviens qu’il a été très fier quand j’ai écrit mon concerto de violon pour Jascha Heifetz. Il voulait tout savoir à son sujet, comment il jouait, comment nous avions travaillé ensemble, comment l’œuvre avait été reçue…
Quand le projet de Ben-Hur a commencé à émerger, c’est lui qui m’en a parlé, deux ou trois ans avant que la production ne commence réellement. Il m’a dit qu’il travaillait sur le film, mais de n’en parler à personne. Ce que j’ai fait, tout en étant très impatient, passant d ‘un film idiot à un autre, espérant que ces absurdités auraient une fin un jour et que le grand sujet de Ben-Hur allait s‘offrir à moi. C’était un homme secret, Zimbalist. Quand il disposa du script, ou d’une partie du script, il me le donna en me demandant de ne le montrer à personne. Et quand il eut enfin le script tout entier, nous avons commencé à discuter du casting et du réalisateur. Le choix du metteur en scène posait un grand problème : il y avait très peu de réalisateurs à Hollywood capables de s’attaquer à un sujet aussi magnifique. Ils furent nombreux à être suggérés, surtout ceux qui étaient sous contrat à la MGM, mais aucun d’entre eux n’était assez bon pour Zimbalist. Un jour, il m’informa qu’il avait trouvé quelqu’un qu’il était susceptible d’accepter : William Wyler. C’était sans conteste l’un des meilleurs réalisateurs hollywoodiens, dont le nom était attaché à de grands succès, un homme intelligent, de bon goût, bénéficiant d’une éducation européenne. C’était l’homme idéal. Cependant, il avait une personnalité tellement forte, et un nom si imposant dans l’industrie, que je dis un jour à Zimbalist : « Vous avez Wyler, maintenant. Ce ne sera pas un film de Sam Zimbalist : ce sera un film de William Wyler. Il répondit avec modestie : « Ca n’a pas d’importance. La seule chose qui compte est que nous fassions un grand film ».
Le studio estima nécessaire de me prêter à un autre studio, Universal, pour faire A Time To Love And a Time To Die (Le Temps d’Aimer et le Temps de Mourir). C’était un très bon film, un film de guerre, qui ne rencontra malheureusement que peu de succès aux Etats-Unis, mais fut très populaire en Europe, plus proche de la guerre. La star du film était un jeune homme, John Gavin, grand, jeune, sombre, beau gosse, très proche de Ramon Novarro, le premier Ben-Hur. Donc je dis à Zimbalist : « Vous devriez vous intéresser à ce jeune homme. C’est un inconnu, mais je pense qu’il ferait un excellent Ben-Hur ». Lui et Wyler virent donc chez Universal pour voir le film. Je ne connaissais pas personnellement John Gavin, ce n’était pas une question de faveur personnelle, mais je demandit alors à Zimbalist ce qu’il en pensait. Il me répondit : « Oui, il est très bon, il présente bien, il n’a pas une seule mauvaise scène dans le film, mais il n’a pas un nom prestigieux. Nous faisons un film à quinze millions de dollars, il nous faut une star ». Il recommanda donc le Ben-Hur que nous connaissons tous, Charlton Heston, qui venait de jouer Moïse dans The Ten Commandments (Les Dix Commandements).
J’avais terminé A Time To Love And a Time To Die, et je revins donc à la MGM où tout était plus ou moins prêt pour retourner à Rome et débuter ce formidable film. C’était l’été 1958. Zimbalist m’appela dans son bureau pour me dire : « Je suis très embarrassé de vous dire ça, mais le studio ne veut pas que vous alliez à Rome. Là-bas, nous n‘avons besoin de vous que pour une scène, c’est celle de la Bacchanale. Nous n’avons pas encore choisi la compagnie de ballet qui va l’interpréter, et vous pourriez nous conseiller une fois sur place, mais le studio ne veut pas vous y envoyer. » Il y avait donc des forces maléfiques qui essayaient de m’éloigner du film. Zimbalist me dit que quelqu’un du studio, quelqu’un de très influent, apparemment un ami du directeur artistique, voulait faire la musique. J’ai répondu : « Laissez-le faire. Vous n’avez pas besoin de moi. » Et Zimbalist de s’enflammer : « Il faudra me passer sur le corps ! Tant que je suis vivant, c’est vous le compositeur du film ». Donc, il n’y avait pas, malgré les quinze millions de dollars de budget, de quoi payer pour mon voyage à Rome, ce qui était tout de même assez curieux. Le même directeur financier était de nouveau à l’œuvre, répétant au studio : « Qui est ce musicien ? Vous pouvez en avoir un pour presque rien à Rome ! » Donc je dis à Zimbalist : « C’est bien dommage que le studio ne puisse payer mes frais, mais je vais en Italie malgré tout. » A cette époque, mon contrat avec MGM avait été modifié, et je ne devais travailler que huit mois par an : les quatre mois d’été étaient libres. Mon contrat était ainsi, comme je l’avais souhaité. A cette époque, j’écrivais le double concerto, la Sinfonia Concertante pour Heifitz et Piatigorsky, et j’allais donc être à Rapallo (ville italienne de la région de Gênes – NDLR). De là, je pourrai aller à Rome. Zimbalist me dit : « Ça facilite les choses. Je paierai pour toutes vos dépenses de Rapallo à Rome et retour. » Figurez-vous que ça ne coûtait que vingt dollars ! Le directeur financier était ravi de pouvoir m’avoir pour vingt dollars sans payer pour mes frais entre Hollywood et Rome.
Je me suis rendu à Rapallo avec ma famille, j’ai commencé à travailler sur le double concerto, et soudain, un télégramme est arrivé, pendant l’été, au mois d’août, me demandant si je pouvais venir pour deux semaines. J’y suis allé, me suis installé dans un grand hôtel, et Zimbalist et moi avons discuté de la Bacchanale. Il me raconta qu’il s’était rendu à Nice avec le directeur financier pour embaucher une troupe de ballet africain, parce que c’est quelque chose de coloré et d’intéressant, pas simplement des danseurs européens. Je lui dis : « D’accord. Dans l’Empire Romain au temps du Christ, il est tout à fait vraisemblable qu’une troupe africaine ait pu danser au banquet donné par Arrius pour l’arrivée de Ben-Hur à Rome. » Donc la troupe africaine arriva, des danseurs très bien bâtis, et quelques joueurs de tambour. Nous avons travaillé plusieurs jours sur la scène avec un chorégraphe et uniquement des percussions, ce qui était parfait pour moi, parce que je pourrais y ajouter par la suite quelques instruments, ce que j’ai d’ailleurs fait plus tard.
Tout s’est bien passé. La scène se déroule lors d’un énorme banquet, et les danseuses africaines déboulent et dansent sous la fontaine. Wyler avait en tête que les seins des danseuses devaient être nus, ce qui était admis à l’époque. Mais le studio jugea que c’était inacceptable, et que le film ne pourrait pas être projeté aux Etats-Unis (ça a beaucoup changé depuis !). Donc ils ont tourné deux versions, l’une à seins nus et l’autre avec des vêtements. Le caméraman, Bob Surtees, l’un des meilleurs d’Hollywood, filmait de très haut en contre-plongée. Wyler, qui avait une très mauvaise ouïe, lui cria : « Bob, que vois-tu ? ». Et Bob répondit : « Des nichons ! ». Tout le monde rigola, mais Wyler ne comprit pas, répéta la question et reçut la même réponse une seconde fois !
C’était une scène fascinante que j’ai longuement préparée avec le chorégraphe. Deux semaines plus tard, tout était terminé, et je suis retourné à Rapallo pour poursuivre mon travail sur le double concerto. Je suis retourné à Rome en septembre, où le tournage continuait. Il restait encore près de trois mois de prises de vues parce que Wyler, aussi doué soit-il, était très lent : il faisait de nombreuses prises pour chaque scène. Je suis allé sur le plateau alors qu’il tournait la séquence dans laquelle Messala, après l’arrestation de Ben-Hur et de sa famille, va vérifier si la tuile est tombée par accident ou a été délibérément jetée et découvre que Ben-Hur est innocent. Wyler vient me voir et me demande : « Pouvez-vous exprimer musicalement qu’un homme ait sacrifié son meilleur ami pour son ambition personnelle ? » Je répondis que oui, je pouvais. « Très bien, pause déjeuner ! » Après déjeuner, il me dit : « C’était trop rapide. Je vais vous accorder beaucoup plus de temps pendant qu’il regarde dans la cour, monte l’escalier jusqu’au toit, examine la tuile et parvient à la conclusion que Ben-Hur est innocent ». Je répondis : « Très bien, je peux utiliser tout le temps que vous me donnez pour exprimer quelque chose ». L’après-midi, le directeur financier me fait appeler et me dit que ma présence à coûté au studio dix mille dollars parce que tout le travail du matin a été jeté et refait l’après midi, et que si je remets les pieds sur le plateau et que William Wyler est de nouveau tenté de faire des changements, ils me renverront à Hollywood aussi vite que possible. « Merci », répondis-je.
Alors que j’étais de retour à Hollywood fin septembre et que je conduisais sur Sunset Boulevard, j’ai entendu à la radio que Sam Zimbalist, producteur de Ben-Hur, en cours de tournage à Rome, venait de mourir d’une crise cardiaque. Le choc fut terrible, et je faillis emboutir une autre voiture. Je suis rentré chez moi et j’ai appelé le studio, qui m’a confirmé la triste nouvelle. C’était un homme consciencieux qui travaillait avec sérieux, et il savait que ce n’était pas juste un film, mais le plus grand film jamais réalisé. Comme je disais, Wyler était trop lent et ne livrait pas le volume de prises de vues qu’ils voulaient. Pour cette raison, Zimbalist recevait des lettres de New York et d’Hollywood lui disant qu’il gaspillait l’argent du studio. Les responsables du studio vinrent à Rome, et même s’ils étaient d’accord avec Sam pour dire que les rushes étaient absolument magnifiques, ils lui répétaient : « Sam, le succès et le futur de la MGM est entre vos mains ». Le pauvre homme n’en dormait plus, et n’osait pas dire quoi que ce soit à Wyler sur son retard. Il me dit une fois : « Il met un temps fou, mais regardez les plans extraordinaire qu’il délivre. Sous sa direction, le plus petit acteur joue comme une star. Que faire ? » Eh bien, il fit une crise cardiaque… Il n’y avait plus de producteur sur le film, et un exécutif du studio fut donc immédiatement envoyé à Rome pour superviser les coûts. Aux environs de Noël, je reçus un télégramme de Rome indiquant que M. Wyler souhaitait ma présence. C’était la première fois que je parcourais une telle distance, mais je devais partir immédiatement, donc j’ai voyagé jusqu‘à Stockholm et de là, vers Rome. Et Rome en décembre était très différente de la Rome que j’avais connu en été. Il n’y y avait plus de touristes : Rome était revenue aux Romains.
J’ai fait ce que M. Wyler attendait de moi. Il y avait une scène, au moment de la crucifixion, pour laquelle il voulait que des femmes pleurent et chantent un hymne – cette séquence fut plus tard retirée du film. Ce que je fis. Maintenant que j’étais à Rome, Wyler déclara que je devrais rester jusqu’à la fin du tournage, vers la mi-janvier. Je n’avais pas grand-chose à faire, mais je me suis dit que c’était l’occasion d’écrire des choses que je ne pourrais pas faire ailleurs qu’à Rome. Je pensais aux marches, et un jour je me suis rendu au Forum Romanum, où tout s’est déroulé il y a deux mille ans. C’était un dimanche, il n’y avait personne alentour, et j’ai commencé à marcher au pas sur la Via Sacra, là où toutes les grandes parades prenaient place, et je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose dans l’air, qu’un peu d’inspiration me viendrait qui sonnerait authentique, romaine. J’ai noté quelques idées dans le petit carnet que j’ai toujours sur moi, et soudain, j’ai vu deux jeunes filles qui me regardaient avec étonnement, et l’une d’entre elles a alors dit à l’autre : « Un pazzo », un fou ! Donc j’ai vite rangé mon carnet et j’ai recommencé à marcher normalement, et elles se sont enfuies. Cependant, l’idée originelle de la Parade Of The Charioteers est née à ce moment même, et c’est ce que j’ai plus tard développé.
Nous avions besoin de trois marches, que j’ai écrites sur place, et j’ai suggéré qu’elles soient enregistrées avec un orchestre italien pour que ça sonne authentique. Nous avions l’aval d’Hollywood. Pour que j’y reste un ou deux jours de plus, cette permission était nécessaire. C’est toujours ainsi pour les musiciens. Un scénariste, un directeur artistique ou un acteur sont des personnes très importantes qui doivent être présents aussi longtemps que c’est nécessaire, mais quand il s’agit du compositeur… N’importe qui peut écrire la musique, et n’importe quelle musique fera l’affaire. C’était l’attitude générale des soi-disant directeurs de production de l’époque, tant à Hollywood qu’à Rome. Cependant, je suis resté jusqu’à la toute fin, puis je suis rentré. Le film était extrêmement long. Le montage final faisait vingt-quatre bobines, alors qu’un film fait habituellement dans les dix bobines. J’ai alors dit au studio, comme je l’avais fait pour Quo Vadis, que je ne pouvais pas le faire en une nuit, et qu’ils ne s’attendent pas à ce que je livre le score deux semaines après la fin du montage. Ils étaient assez intelligents pour comprendre ça, et j’ai donc commencé à travailler sur la base d’un premier montage fait à partir de ce qui avait été filmé, et qui allait être réduit par la suite. Ca n’avait pas d’importance, je leur ai juste dit que s’ils raccourcissaient le film, je raccourcirais la musique. Le montage dura neuf mois, ce qui à l’époque était inédit, un montage final étant généralement terminé en quatre semaines. Mais ce n’était pas un film ordinaire, et ils avaient besoin de temps.
Le chef monteur de la MGM, Margaret Booth, était avec le studio depuis quarante ans, et dirigeait tous les autres monteurs, qui étaient ses élèves. Je suis devenu ami avec Margaret à Rome, où nous avons souvent dîné ensemble. C’est la plus grande professionnelle d’Hollywood que j’aie connu. Bien sûr, elle travaillait avec Wyler, mais le montage à proprement parler était sa responsabilité (il y avait aussi deux autres monteurs sur le film tant il était énorme). Wyler supervisait le montage au studio, et un jour il déclara vouloir me parler. « Devons-nous parler de la musique ? » lui dis-je ? « Oui », répondit-il, « J’ai une idée concernant la musique ». Tout cela semblait de mauvais augure. Je n’aime pas lorsque les réalisateurs ont des idées concernant la musique, ce sont en général des lieux communs du genre : « Mettons ici The Star-Spangled Banner » ou, si c’est un metteur en scène britannique : « Utilisons God Save The Queen.» Je suis allé dans son bureau, et il m’a dit : « Vous avez vu la scène de la Nativité, qu’en pensez-vous ? » « C’est très beau et émouvant ». Il ajouta alors : « Mon idée est la suivante : la musique devrait être Adeste Fideles. » « Pourquoi ? » « Parce que c’est un chant de Noël ! » J’étais terrifié. Je lui dis alors : « Mais c’est un hymne latin du XVIème siècle ! » « Oh », répondit-il, « ça ne fait aucune différence ». « Mais si ! », et j’ai ajouté : « L’histoire se déroule au premier siècle, et je vais essayer de créer une musique qui ressemble à la musique du premier siècle. Et quelle que soit la valeur de ma musique, elle va être acceptée comme musique de cette période. Si vous voulez un chant de Noël, pourquoi dans ce cas ne pas jouer I’m Dreaming Of A White Christmas, d’Irving Berlin ? C’est aussi un chant de Noël. » Il répondit : « Non, je veux un hymne ancien, et Adeste Fideles l’est suffisamment. » Il me raconta alors que dans Dodsworth (réalisé en 1936 par William Wyler – NDLR), la première scène présentait un businessman new-yorkais qui quittait son bureau, fermait ses tiroirs, lançait un dernier regard triste et s’en allait. Son directeur musical de l’époque était Alfred Newman, et Willy lui dit alors : « Bien entendu, à ce moment-là, il faut jouer Auld Lang Syne (Ce n’est qu’un au revoir en français – NDLR ». Et Alfred Newman répondit : « Pourquoi pas ? »
« Je ne suis pas du tout convaincu », répliquais-je à Wyler. « Je suis tout à fait opposé à l’utilisation d’Adeste Fideles. Je serai la risée du monde entier quand on verra le premier Noël illustré par un chant écrit mille six cent ans plus tard. » Il ne comprenait pas mon point de vue, et je ne comprenais pas le sien. Ceci dura plusieurs mois, pendant toute la période de montage. A chaque fois qu’il me voyait, il me demandait : « Alors ? Y avez-vous réfléchi ? ». Et je répondais : « Oui, j’y ai réfléchi avec soin, et ma réponse est un non catégorique ». Je suis finalement allé voir le responsable du studio et lui ai dit : « Je tiens à ce qu’une chose soit très claire : il veut que j’utilise Adeste Fideles, et je ne vais pas le faire. Je vais écrire ma propre musique, qu’il l’accepte ou pas n’est pas mon problème, mais personne ne peut me forcer à utiliser Adeste Fideles ». Wyler finit par me dire : « Ok, je veux entendre ce que vous avez écrit ». Je répondis : « Venez aux sessions d’enregistrement, et vous l’entendrez ».
Les neuf mois passèrent, pendant lesquels je travaillais fiévreusement, et ce fut une période merveilleuse de ma vie, parce que c’était un sujet immense, un film magnifique, et l’histoire de notre Seigneur. L’enregistrement eut lieu à Hollywood, alors même qu’il s’agissait d’une production européenne, comme Quo Vadis. Mais le studio considérait que nous devions le faire ici pour gagner du temps, ce qui fut le cas. J’ai pu avoir un orchestre de quatre-vingt musiciens, un chœur, tout ce que je voulais. La première pièce à être enregistrée fut The Rowing Of The Galley Slaves. Wyler ne dit pas un mot. Quand arriva la scène de la Nativité, nous avons enregistré la musique que nous connaissons tous, et il me dit : « C’est très joli ». « Merci », répondis-je. Et l’affaire en resta là pour ce qui est de l’usage d’Adeste Fideles. J’ajoute, entre parenthèses, que Newman en souffrit plus tard, ce qui a probablement raccourci son existence. Alors qu’il faisait The Greatest Story Ever Told (La Plus Grande Histoire Jamais Contée), le réalisateur l’obligea à enregistrer le Hallelujah du Messie (de Georg Friedrich Haendel – NDLR). Newman écrivit une très belle musique, que j’ai entendue, pour la scène de résurrection, mais le réalisateur, qui savait tout mieux que tout le monde, déclara : « Non, ce sera le Hallelujah, parce que tout le monde le connait ». Le film sortit ainsi et devint la risée du monde entier : les gens riaient lors de cette scène magnifique où soudain ils entendaient le Messie. Ce pauvre vieux Newman en fut tout retourné, et tout ceci joua un rôle dans la maladie cardiaque qui allait finalement le tuer.
Pendant l’enregistrement, Wyler était là en permanence. Il fit quelques suggestions, généralement avisées, que j’acceptais. Mais à un moment, il commença à me demander pourquoi le hautbois jouait ceci, pourquoi pas la clarinette, ce genre de choses. Il n’y connaissait absolument rien, mais il se croyait musicien parce qu’il avait appris le violon quand il était jeune. Donc je dis à l’orchestre : « Mesdames et messieurs, nous avons désormais un nouveau chef. Voici monsieur William Wyler, qui va maintenant vous prendre en charge. Willy, voici mon bâton ». Il devint tout rouge et me dit : « Non, non, ne soyez pas idiot, continuez ». A partir de ce moment, il n’y eut plus d’interférences.
Nous avons donc poursuivi en toute amitié et avons enchaîné sur le mixage, toujours sur vingt-quatre bobines. C’était très difficile de marier la musique et les effets sonores. Pour The Rowing Of The Galley Slaves, l’enregistrement s’était déroulé en une seule prise, ce qui était très satisfaisant. J’avais mis au point la scène depuis le début. J’avais insisté pour qu’on utilise un métronome sous la forme d’un tambour. Le hortator (le chef des rameurs – NDLR) battait la mesure, il y avait quatre vitesses pour les rameurs au fur et à mesure que la bataille s’accélérait et devenait plus furieuse. J’avais enregistré ces quatre rythmes à Rome avec des timbales, et comme je n’allais pas être présent lors du tournage, j’avais dit : « Il y a quatre vitesses, et au fur et à mesure que l’on progresse, il faudra les diffuser, et ils doivent ramer sur ce tempo, tout doit être synchronisé. » Puis j’ai enregistré la musique sur ces quatre vitesses, quatre sections s’accélérant de plus en plus et menant finalement à la bataille. Mais au moment du mixage, Wyler dit : « Je ne veux pas de musique sur cette scène ». Tout le personnel du mixage ainsi que Margaret Booth s’exclamèrent : « Mais M. Wyler, la séquence toute entière tombe à plat ! » « Non », répondit-il « nous avons le hortator qui donne le rythme, et c’est ce que je veux sur la séquence ». « Pendant quatre minutes ? » « Oui, pendant quatre minutes. » Ils lui ont alors projeté ainsi. Son frère Walter était là, et parce qu’ils étaient nés en France, ils parlaient tous deux français. Et j’ai alors surpris leur conversation – ils ignoraient que je parle français – et Water Wyler dit : « Mais écoute ! Tu es fou. Sans musique, tu n’as pas de scène. C’est la musique qui fait la scène. » Wyler dit alors : « Ecoutons de nouveau, avec la musique en arrière-plan. » Ils lui repassèrent la scène avec la musique très en retrait. « Non, ça ne va pas, essayons avec un peu plus de musique ». J’ai alors entendu le chef mixeur téléphoner au projectionniste pour lui dire : « Remettez le morceau d’origine ». Ils projetèrent alors le film avec le morceau original, celui que nous avions écouté quand il ne voulait plus aucune musique, et Wyler s’exclama : « Voilà ! C’est beaucoup mieux ! »
Le film fut finalement terminé sans que Wyler dise quoi que ce soit au sujet de la musique. Il vint écouter deux semaines d’enregistrement, trois ou quatre de mixage, sans un mot sur le fait qu’il aime ou pas la musique. J’en déduisis donc qu’il n’aimait pas. Nous nous sommes alors rendus à la première du film à Dallas, et ce fut un énorme succès. Je suis allé à de nombreuses premières, mais jamais comme celle-ci : le public resta debout à applaudir pendant de nombreuses minutes, très agité, criant… En sortant du cinéma, Wyler vint vers moi, m’embrassa et me dit : « Vous avez composé un score magnifique ». Je lui répondis : « Mais Willy, vous l’avez déjà entendu, pendant des semaines, et n’avez jamais dit un mot ». Il me dit alors : « Ma belle-mère est une fille du Texas, c’est un professeur de piano qui sait tout de la musique, et elle m’a dit que c’était un score extraordinaire, donc j’accepte son opinion ». Depuis ce jour, je n’accepte plus les plaisanteries sur les belles-mères, parce que la sienne a sauvé ma musique dans le film. Avec Wyler, tout pouvait arriver, il était réputé pour être très difficile avec les compositeurs. Il ne l’a jamais vraiment été avec moi. Il était têtu, mais comme je le suis aussi, il a vu qu’il n’allait nulle part et il a abandonné.
Le film rencontra un succès phénoménal, balayant le monde entier, et il continue encore aujourd’hui de le faire, non seulement à la télévision mais aussi en salles. C’est une des pierres angulaires de l’art cinématographique, pas seulement à Hollywood mais dans le monde entier. A la cérémonie des Academy Awards de 1959, il balaya tout également, recevant onze récompenses, y compris la musique, ce qui est plutôt inhabituel puisqu’il n’y avait que douze récompenses au total. Seul le scénario ne fut pas récompensé. Il avait été écrit pas Karl Tunberg, mais à Rome, Christopher Fry, un excellent et célèbre écrivain britannique, était sur le plateau avec Wyler – je me souviens qu’il était assis à côté de lui – et réécrivait les dialogues pour les rendre plus poétiques, plus dramatiques, plus anglais d’une certaine façon, ou plus archaïques. Wyler tenta de lui faire obtenir un crédit partagé entre les deux, mais la guilde des scénaristes américains refusa, et Karl Tunberg fut le seul à être nominé. Au final, aucun des eux ne fut récompensé, ce qui est désolant puisque les deux le méritaient.
Le reste, comme on dit, est entré dans l’histoire. Le film fut récompensé à juste titre, et pour ce qui est de la musique, je n’ai pas à me plaindre. La Parade Of The Charioteers fut publiée, d’abord pour fanfare, et a été jouée un peu partout en Amérique depuis vingt ans lors de matchs de foot ou dans des écoles. Ensuite, j’ai écrit onze chorus inspirés des thèmes de Ben-Hur, et le film suivant que j’ai fait, King Of Kings (Le Roi des Rois), qui était en fait l’histoire de Jésus-Christ, a été récemment enregistré par le chœur de l’université de Brigham Young, en Utah, après avoir été chanté pendant vingt ans dans les églises. J’y ai ajouté un douzième chorus basé sur un très beau poème hongrois, et l’ensemble va être republié en un seul volume, et j’espère que ce sera joué (ça dure environ quarante minutes) un peu partout sur le territoire.
Les enregistrements de la musique sont nombreux. Il y eut tout d’abord deux albums. Le premier, fait en Italie et dirigé par Carlo Savina, parce que le syndicat américain ne m’autorisait pas à diriger en Italie, et le second à Nuremberg, avec le Nuremberg Symphony Orchestra, qui est l’un de mes favoris en Europe et avec lequel j’ai enregistré beaucoup de mes musiques. Le dernier enregistrement sous ma direction fut pour Decca. Mais comme il y a tant de musique dans Ben-Hur, j’espère qu’un jour l’intégralité du score sera enregistré de nouveau, ce qui remplirait facilement deux albums. Mais il y a un problème : les partitions n’existent plus. C’est difficile à croire, mais MGM a tout jeté, pas seulement Ben-Hur, pas seulement ma musique. Un génie à la tête du département musical a vu tout un tas de scores trainant alentour et a dit : « Jetez-moi tout ça, on n’en a pas besoin ». Ils n’ont même pas eu la courtoisie d’appeler les compositeurs pour leur demander s’ils voulaient récupérer leurs partitions, ou de contacter une université pour leur demander s’ils aimeraient les avoir, alors que c’était très certainement le cas. « Jetez-les ! » Donc, l’album Decca a dû être réorchestré – fort heureusement, j’ai encore les conducteurs – mais le reste du score a disparu. Pour réenregistrer tout ce qui ne l’a pas été récemment, il faut tout réorchestrer, tout recopier, et ça coûte beaucoup d’argent. J’ai une suite en six pièces, publiée par Robbins, qui a été jouée assez souvent, et que j’ai moi-même dirigée il y a deux mois à Detroit, faisant – ou tout du moins c’est ce que j’ai ressenti – forte impression sur le public. Au moment du fameux Rowing Of The Galley Slaves, le public frappait des mains en rythme. Et c’est cette musique que M. Wyler voulait retirer…
Voilà donc l’histoire de Ben-Hur. Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité d’en composer la musique, et je dois remercier le producteur Sam Zimbalist, qui m’a engagé sur le film et a résisté à toutes les intrigues du studio pour m’en détacher, pour des raisons que je ne veux pas évoquer. Et aussi M. Wyler qui, même s’il n’était pas certain que ses goûts coïncident avec les miens, ne m’a pas causé de difficultés, laissant dans le film la musique telle qu’elle avait été écrite. Une chose est sûre : il n’y aura pas d’autre Ben-Hur dans ma vie.
Entretien enregistré en octobre 1981 par le Dr. Rózsa pour John Stevens
Transcription : Paul Packer
Traduction : Stéphane Abdallah & Olivier Desbrosses
Texte original : © Copyright : The Miklós Rózsa Society
Photographies : © MGM / Warner Home Video
Remerciements à John Fitzpatrick, Paul Packer & John Stevens