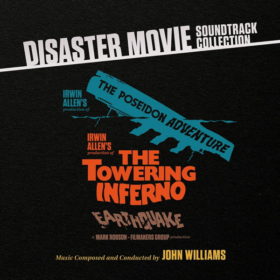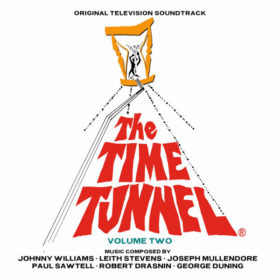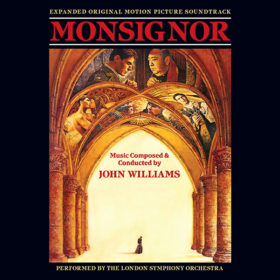JAWS (1975)
JAWS (1975)
LES DENTS DE LA MER
Compositeur : John Williams
Durée : 114:41 | 54 pistes
Éditeur : Intrada
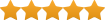
« Quelque chose s’éveille, un grondement inquiétant, un demi-ton s’élève du plus profond des cordes… alors le rythme démarre, lentement, prend peu à peu de l’ampleur… alors peut-être nous ajoutons un tuba… » La petite idée que John Williams soumet ainsi à un Steven Spielberg dubitatif, un jour de printemps 1975, a fait son chemin. Retour sur une partition exemplaire, l’une des plus abouties de son auteur.
Sans doute n’est-ce pas un hasard si Jaws se place en queue du peloton des quelques films catastrophes mis en musique par John Williams au début des années 70. Ce n’est en effet qu’à partir de sa rencontre avec le réalisateur Mark Rydell, pour lequel il signe les partitions de The Reivers (Reivers) puis de The Cowboys (Les Cowboys) que le compositeur a véritablement commencé à se forger une identité musicale à Hollywood (identité alors seulement devinée à travers quelques œuvres de concert, dont une symphonie que Bernard Herrmann jugera « surorchestrée »). En cela, après des films comme How To Steal a Million (Comment Voler un Million de Dollars) ou A Guide For The Married Man (Petit Guide pour Mari Volage), il rompt alors autant avec une carrière de cinéma qui semblait n’être vouée qu’à suivre consciencieusement une voie tracée par un Henry Mancini qu’avec le train-train de ses contributions pour des séries télévisées avec lesquelles, à l’époque, il reste le plus volontiers associé. Parmi celles-ci, on retiendra les Fantasy Worlds d’Irwin Allen, Lost In Space (Perdus dans l’Espace), Time Tunnel (Au Cœur du Temps) et Land Of The Giants (Au Pays des Géants).
Curieusement, Williams restera fidèle au producteur même après cette réorientation de style, au risque de s’encombrer à nouveau d’une étiquette dont il serait difficile de se défaire : c’est en tout cas ainsi qu’il en vient à écrire les partitions de The Poseidon Adventure (L’Aventure du Poseidon) et de The Towering Inferno (La Tour Infernale), tous deux produits par Allen dont l’esprit plane alors également sur d’autres films du même acabit, et en particulier Earthquake (Tremblement de Terre) auquel le compositeur se joint également. Mais l’avenir du cinéma spectacle est ailleurs…
Ce n’est donc pas le John Williams d’Irwin Allen que Steven Spielberg réclame pour son Sugarland Express, mais bel et bien celui de Mark Rydell. Aussi, lorsque le réalisateur s’aventure peu après à son tour sur le terrain du film catastrophe, le compositeur n’a d’autre solution que de s’affranchir presque totalement, et cette fois de manière irrévocable, de ses précédentes incursions pour le genre et des partitions plus ou moins ternes qui en résultaient. Blockbuster retentissant dans l’histoire des salles obscures, Jaws est pour Williams un véritable électrochoc, de ceux qui permettent à un musicien, alors déjà âgé d’une quarantaine d’années, d’accrocher définitivement la destinée hollywoodienne du wonder boy le plus en vue du moment (Spielberg n’a, lui, que 27 ans), et ceci pour une carrière que l’on ne présente plus…
Difficile de ne pas aborder avant tout la partition sous l’angle du requin et de ce thème qui reste indubitablement LA grande idée musicale du film. On a beaucoup spéculé sur les malheurs de Spielberg avec les requins mécaniques construits pour l’occasion et les conséquences de leur malfonction sur la forme définitive du film : la suggestion, sur laquelle repose en grande partie sa force horrifique, tenait-elle entièrement de la volonté première du réalisateur ? Il n’y a par contre aucun doute sur les motivations de John Williams qui, après avoir visionné le film, fait avant tout sienne cette idée de suggérer. On décrit ainsi abusivement le thème musical lié au requin comme un motif de deux notes alors que celles-ci n’en représentent en fait qu’une infime portion. La notion de « signal » paraît alors être d’un emploi plus juste, dans le sens où elle sous-tend l’évocation dudit thème dont l’exposition pleine et entière n’intervient que fort tard dans le déroulement de l’histoire, soit vers la soixante dix-huitième minute seulement.
Mais intéressons-nous donc d’abord à ce « signal » puisque c’est vers lui que se porte toute l’attention… D’un point de vue strictement musical, il est bel et bien constitué de deux notes séparées d’un demi-ton, soit d’un intervalle mélodique de seconde mineure qui, hors contexte cinématographique, n’a aucune valeur évocatrice… C’est plutôt de la structuration rythmique qui l’anime que ce motif élémentaire tire sa force, un tribut que John Williams paye notamment au compositeur Igor Stravinsky dont le Sacre du Printemps vient bien sûr immédiatement à l’esprit. A peu de choses près, le compositeur offre finalement là à Spielberg ce que ce dernier avait à l’origine escompté pour Sugarland Express : « Quatre-vingt instruments et Stravinsky dirigeant l’orchestre ! »
Le principe choisi (une basse obstinée) s’appuie ainsi sur différentes séries de « battements » qui peuvent aisément être rapportés à une pulsation cardiaque : en cela il s’apparente donc au principe d’isochronie, une structuration élémentaire qui peut permettre à un compositeur de provoquer à sa guise une sensation suggestive de peur en agissant de manière tout à fait basique sur les tempos. Le pouls prenant valeur de moyenne, une vitesse de rythme supérieure à celui-ci sera perçue comme plus rapide, faisant naître le sentiment de peur et donc de danger… Ajoutons à cela un souci d’orchestration pour de meilleurs effets « organiques », le motif s’appuyant essentiellement sur le registre des basses dont on sait combien elles résonnent le plus dans le corps… À ce titre, la musique s’impose ici pour le spectateur comme une double donnée qui à la fois le renseigne sur ce qui se déroule à l’écran et lui imprime directement les sensations (physiques) qui régissent son corps. De là provient sans doute également l’idée d’une musique d’essence « primitive », un qualificatif qu’il paraît donc plus adéquat d’appliquer à la manière avec laquelle John Williams suscite la peur chez l’auditeur qu’à une quelconque transcription musicale du requin comme un « envoyé destructeur d’une Nature primitive » (!), comme cela a parfois été suggéré.
On est d’ailleurs alors en droit de se demander ce que symbolise exactement ce motif répété de deux notes… D’aucuns y voient un pur leitmotiv pour le requin, ce qui, au premier abord, semblerait évident dans la mesure où il constitue une sorte « d’abréviation » d’un thème musical complet qui, lorsqu’il est finalement exposé, peut sans équivoque et de façon extrêmement descriptive être attaché à l’animal : il pourrait s’agir en quelque sorte d’un « aileron musical » qui représenterait donc ce que Williams veut bien nous laisser entendre du thème du requin, au même titre que ce que Spielberg veut (ou peut) nous présenter visuellement de son monstre… Cette solution cependant ne saurait satisfaire entièrement car elle n’explique qu’en partie la manière avec laquelle ce motif prend place au sein du discours cinématographique, celle-ci laissant donc supposer un symbolisme plus large. Il apparaît ainsi, et ce dès le début du film, que le motif reste indissociable de la notion de mouvement : si l’ostinato qui le conduit lui confère avant tout un caractère d’inexorabilité, lorsque Williams lui adjoint une troisième note (plus basse), on constate que celle-ci porte systématiquement un accent intensif qui permet immédiatement d’attribuer au rythme une réelle essence motrice.
D’autre part, pendant toute la première moitié du film (générique mis à part), les deux notes ne retentissent essentiellement que lorsque Spielberg nous suggère l’approche du monstre sur une victime ; or, pour nombre de scènes, il nous est souvent permis de penser que le requin est là bien avant. Le motif semble donc ne pas être à proprement parler une simple transcription musicale du requin mais plutôt de la menace et du danger qu’il représente à un moment donné.
On ajoutera à cela que le motif ne se fait qu’assez peu présent de manière directe lors de l’attaque elle-même (hormis la toute première, sans doute dans l’idée de mieux « assommer » le spectateur, cette scène étant l’une des plus chargées sur le plan sonore), entendons par-là la mise à mort de la victime, alors qu’il n’aurait au contraire aucune meilleure raison de s’y trouver pleinement s’il n’était qu’un simple leitmotiv pour le requin. Mais il est vrai qu’alors la phase de pur danger que représente l’approche est déjà accomplie et qu’on assiste seulement à son issue, à l’acte qui en résulte et face auquel il n’y a plus rien à faire…
Enfin, on ne pourra que s’interroger sur la persistance des deux notes juste avant que Quint, sur le bateau, ne détruise la radio du bord : peut-être tout simplement parce que, pour cette scène précise, la menace ne vient pas du requin mais de Quint… Par ailleurs, d’une manière similaire à l’idée précédente, le motif s’interrompt brutalement au premier coup que porte Quint à l’appareil : l’acte s’accomplit en effet mais le danger pour Brody, qui s’est visiblement senti visé, n’existe plus, Quint n’ayant aucune intention de continuer à frapper…
Certes, en tant que tel, le distingo peut paraître flou entre le requin lui-même et le danger qu’il représente (les deux se confondant le plus souvent) mais la notion semble néanmoins la plus adéquate pour expliquer la manière avec laquelle Williams décide ou non de recourir à son thème.
Prenons l’exemple de la longue scène qui voit deux enfants provoquer la panique en se servant d’un faux aileron : le motif ne se fait alors pas entendre puisqu’en effet il n’y a pas de réel danger (il n’y a d’ailleurs aucune musique pendant cette séquence), argument peu convaincant en soi car on peut lui opposer le fait que le requin n’est de toute façon pas présent ! La musique n’apparaît finalement que juste après qu’un autre aileron soit aperçu un peu plus loin dans l’estuaire : thème du requin ? Comment expliquer alors que Williams cesse brusquement son effort et laisse sans support musical un plan très explicite où l’animal laisse voir son aileron s’enfoncer dans l’eau ? De plus, on ne peut manquer d’observer immédiatement avant l’attitude du chef Brody, soutenue, elle, musicalement par le thème : alors que le rythme du motif s’accélère, le personnage se met à courir de plus en plus vite. Le requin n’est pas montré mais la menace est cette fois bien réelle et c’est elle qui fait réagir Brody…
Deux autres scènes enfin font, pour la même raison, intervenir les deux notes caractéristiques, cette fois en filigrane mais de manière toute aussi évocatrice : d’abord lorsque Brody feuillette les pages d’un livre qui lui montre les blessures que les requins sont capables d’infliger ; ensuite au moment de la découverte du bateau de Ben Gardner, alors que Hooper découvre une dent de l’animal. Ce dernier est, signalons-le, totalement absent de l’écran en ces instants et pourtant, chaque fois, le thème fait une discrète apparition, marquant d’une manière similaire le fait que la menace à laquelle sont confrontés les personnages se précise un peu plus à leurs yeux. Dans le premier cas, Brody mesure véritablement le danger que représente les requins mais il ignore toujours à quelle espèce appartient l’individu auquel il doit faire face, c’est pourquoi il semble là aussi difficile de présenter les deux notes comme le leitmotiv de cet individu en particulier.
Dans le second cas, la découverte d’une dent permet cette fois à Hooper d’identifier sans ambiguïté le prédateur : Carcharodon Carcharias, le Grand Blanc… Le danger a enfin un nom, mais il reste néanmoins parmi les plus mal connus. Ces deux scènes s’inscrivent en fait dans une progression dont l’issue est l’exposition complète du thème principal lorsque, du bateau, les personnages comme le spectateur peuvent pour la première fois juger de manière directe de l’individu auquel ils vont devoir faire face et donc de la vraie menace qu’il représente par rapport à ses congénères : « Un requin vous a-t-il déjà fait cela ? », demandera ensuite le chef Brody par deux fois, à Hooper et à Quint qui répondront invariablement « Non », et ce malgré leur propre expérience.
L’introduction de cette thématique musicale au sein de l’image est immédiate. Dès le générique, les deux notes se chargent sans détour d’amener le spectateur à éprouver sa première sensation vis à vis du film et celle-ci ne souffre d’aucune ambiguïté. Fort de ce qu’il a pu éventuellement connaître de l’histoire avant la projection et, en tout cas, de ce qu’évoque clairement l’affiche promotionnelle du film (une gigantesque mâchoire de squale sous une baigneuse et la mention « She was the first » (elle était la première), le spectateur ne doit avoir aucun mal à associer ce thème musical avec ce qu’il représente : le monstre annoncé (un requin donc) qui est surtout une menace, un danger mortel suscitant peur et effroi. En ce sens toutes les scènes d’attaque de la première partie « terrestre » du film ne font que suivre ce schéma musical initial, installant un effet d’habitude chez le spectateur qui s’attend donc à ce que le fameux motif retentisse à chaque attaque attendue du requin. L’épisode du faux aileron, tel qu’il est décrit ci-dessus, ne fait d’ailleurs qu’appuyer ce principe.
La seconde partie en revanche bouleverse radicalement les données : le film vire au huit-clos à bord de l’Orca et, plus important, les trois principaux protagonistes se mettent en chasse de l’animal sur son propre territoire, l’océan. Malgré le fait que deux d’entre eux, chacun à leur manière, peuvent être qualifiés de « professionnels » (Hooper et Quint), on rentre plus que jamais dans le domaine de l’imprévisible et Williams contribue grandement à éveiller ce nouveau sentiment. La première scène d’alarme sur le bateau en est l’avertissement : malgré son expérience, Quint sous-estime l’animal qu’il a au bout de sa ligne et ne parvient pas à le capturer ; Hooper reste lui persuadé jusqu’au bout qu’il ne s’agit pas du requin mais « d’un poisson sportif, une raie ou un marlin ! » Si quelques accords sombres se font entendre au début de cette scène, Williams se garde bien de prendre parti en utilisant les deux notes caractéristiques, si bien que l’on est toujours en droit de se demander qui, de Hooper ou de Quint, a raison.
À ce moment, le spectateur peut encore s’attendre à ce que la musique annonce finalement l’approche du requin : au bout du compte, le compositeur prend bien entendu un malin plaisir à éviter de répondre à cette supposition, contribuant ainsi à sa manière au choc de la première véritable apparition de l’animal. On s’aperçoit alors également que la musique adopte définitivement le point de vue des personnages (tout comme Spielberg, qui ne recourt plus désormais aux vues suggestives sous l’eau). Au début de cette scène clef, le danger s’approche bel et bien mais les trois protagonistes (comme le spectateur) n’en ont pas conscience : Hooper est tranquillement à la barre, Quint bricole ses cordes à piano et Brody maugrée devant la traîne qu’il jette comme appât par-dessus bord. Williams ne lance donc son thème qu’après la brusque apparition du requin, lorsque les personnages peuvent pour la toute première fois jauger véritablement le monstre auquel ils sont confrontés. C’est donc la notion subjective de danger qui là encore mène l’utilisation du thème. Ce dernier prend ainsi part à la longue séquence de poursuite avec l’Orca, où les sentiments de peur (soutenu par le motif) et d’excitation (porté par des élans héroïques) se retrouvent intimement mêlés (et fort bien illustrés à l’écran par les attitudes opposées de Brody et de Hooper).
Williams tire grand avantage à respecter désormais le point de vue des personnages : cela le libère en quelque sorte de l’emprise d’un schéma trop bien établi qui ne lui laisserait que peu de marge de manœuvre pour faire rebondir le rythme de sa partition. Il participe également de ce fait au revirement du statut des personnages (qui, de chasseurs, deviennent proies), entraînant du coup le spectateur. En l’absence d’une quelconque anticipation musicale, ce dernier a été d’un coup catapulté au cœur de l’action ; les deux notes caractéristiques, jusqu’ici bien ancrées dans son esprit, lui ont fait faux bond mais il est tout à fait raisonnable de penser que, par habitude, il cherchera toujours à s’appuyer sur une illustration musicale progressive qui lui dicterait « en douceur » ses émotions. Le compositeur est de fait en position de force et peut à présent manipuler son thème à sa guise, le faisant intervenir aux moments qu’il juge les plus opportuns afin de stimuler l’impression de danger et, éventuellement, de ménager de nouveaux effets de surprise…
Premier exemple, lorsqu’un baril fait brusquement surface à l’arrière du bateau, preuve que le requin n’est pas loin : les trois personnages sont interloqués, le motif retentit donc aussitôt, mettant le spectateur aux aguets, avant de s’éteindre peu à peu, laissant place à des accords sombres de l’orchestre. Si elle reste pesante, la musique semble alors écarter la possibilité d’un danger immédiat, et ce malgré l’avertissement de Quint : « Il doit être sous le bateau ! » On n’y croit pas, et visiblement les personnages non plus, lorsqu’ils se penchent inconsidérément pour attraper la corde du baril… La réapparition brutale du monstre, si près de l’Orca, est à nouveau un choc. Notons que ce principe est, d’une certaine manière, le même que celui qui régit encore de nos jours les partitions du genre horrifique : un premier effet musical (attendu) pour rien suivi peu après d’un deuxième (inattendu) pour mieux surprendre le spectateur.
Deuxième exemple lors d’une attaque nocturne, juste après le récit de Quint et de l’Indianapolis, alors que les trois hommes chantent de bon cœur (« Show Me The Way To Go Home ») : les barils que traîne le requin font surface à nouveau et celui-ci commence à entamer la coque du bateau ; cette fois le thème n’apparaît pas immédiatement et n’intervient finalement que lorsque les personnages cessent de chanter et réalisent qu’ils sont attaqués.
Il semble hasardeux de parler de leitmotives bien définis et identifiables pour chacun des personnages. Pour la plupart d’entre eux, en effet, tout au plus peut-on simplement leur associer quelques éléments musicaux bien particuliers : un court enchaînement éventuellement, une humeur de l’orchestre, guère plus. Dans la première partie du film notamment (laquelle se passe essentiellement à terre), seul le thème lié à la menace du requin se fait clairement entendre et ce, ainsi qu’on l’a vu, dès le générique. Pour le reste, on remarquera l’emploi ponctuel (et non exclusif) de certains instruments à la symbolique évocatrice : la trompette solennelle pour l’autorité de la ville (le maire), le piano intimiste et apaisant pour le plus jeune des fils Brody, et ainsi de suite…
La chose se veut plus fouillée dès qu’on se retrouve en mer. Un nouveau thème se dessine alors véritablement, qui peut lui être facilement attaché au chef Brody. Il apparaît ainsi au moment du départ de l’Orca, alors que le personnage regarde une dernière fois la terre ferme où il vient à peine de quitter sa femme. Il est à ce niveau particulièrement significatif de constater que ce thème est absent du premier acte alors que Brody est depuis le début du film désigné comme le héros de l’histoire : c’est donc son départ en mer qui provoque l’entrée de cette caractérisation musicale, une manière comme une autre de marquer le début de son voyage initiatique.
Par ailleurs, ce thème reste en apparence simple et surtout prend valeur d’incertitude, donnant la sensation de ne pas devoir aboutir. Son emploi ne s’avère par la suite qu’occasionnel mais il se fait notamment remarquer en se mêlant parfois au thème du requin. Williams fixe du coup musicalement la donne dramatique finale : l’affrontement ne pourra s’effectuer qu’entre Brody et le requin. Pourquoi alors encombrer la partition de phrases musicales superflues pour Hooper et Quint puisque tous deux seront absents du dénouement (l’un est écarté, l’autre disparaît) ?
Le compositeur prend en quelque sorte ici à contre-pied le triptyque mis en place par Steven Spielberg sur le bateau en choisissant de ne démarquer distinctement qu’un seul personnage sur les trois, même si, répétons-le, certains détails de la partition (allant parfois jusqu’à une amorce de mélodie) peuvent ponctuellement être associés à Quint ou Hooper (en particulier tout au long des séquences de poursuites avec l’Orca, en complément de l’esprit de compétition qui règne entre les deux hommes). Par ailleurs, le plan constituant le générique final ne s’accompagne que de ce thème musical (à présent posé et abouti), alors qu’il y a bel et bien deux survivants à l’aventure. Mais Brody est assurément le principal protagoniste de l’histoire, celui qui entreprend son voyage initiatique, affronte ses démons et revient grandi, apaisé…
Le cas Quint est cependant plus compliqué qu’il n’y paraît, à croire qu’il fallait bien que ce personnage haut en couleur se distingue d’une manière ou d’une autre. Ainsi, il se voit bel et bien attribuer une particularité musicale récurrente (à laquelle Williams est cependant étranger) sous la forme d’une chansonnette que Spielberg lui fait fredonner à plusieurs reprises pendant le film. De fait celle-ci, intitulée « Farewell Spanish Ladies » (« Au Revoir et Adieu, Jolie Fille Madrilène », dans la version française) pourrait bien fournir à Quint un juste leitmotiv dans la mesure où son emploi, loin d’être anodin, apparaît chaque fois se faire l’écho de l’état d’esprit du personnage : chantonnée tour à tour sur un ton moqueur (au départ de l’Orca, face à Hooper et à son matériel sophistiqué), mélancolique (juste après le récit de l’Indianapolis) ou rageur et plein de rancœur (à la barre, tentant de semer le monstre), avant que Williams lui-même ne lui fasse un joli pied de nez, lui resservant la même mélodie à la flûte, telle un petit rire ironique, lorsqu’il prend finalement conscience de l’état désastreux de son bateau (et de la situation !) et se résout à demander à Hooper ce qu’il peut tenter avec son matériel (qu’il n’avait pourtant pas manqué de traiter avec mépris).
L’étonnant pouvoir de cette partition ne saurait bien sûr se réduire à l’emploi de quelques formes musicales aussi astucieuses que simples. Williams sait pertinemment qu’il lui faut obligatoirement ménager son motif afin que celui-ci conserve intacte sa force évocatrice pendant les deux heures que dure le film. Le problème était en fait le même pour Spielberg qui se devait absolument lui aussi d’entretenir la montée en puissance du drame. Pour cela, il choisit d’aborder certaines séquences sous un angle volontairement léger de manière à désamorcer la tension, minimiser le danger sous-jacent et ne rendre les scènes suivantes que plus intolérables. Tout comme il appuie singulièrement l’impact dramatique des attaques, Williams participe grandement à ces habiles diversions, changeant radicalement le ton de sa partition aussi souvent que le lui permet le réalisateur.
C’est notamment le cas lors de la séquence qui voit l’arrivée des touristes dans la station balnéaire : pendant que Brody et Hooper se démènent tant qu’ils peuvent au téléphone, une foule bigarrée envahit la petite ville, inconsciente du danger qui menace toujours. Spielberg semble alors s’amuser à nous présenter tout un choix de victimes potentielles et Williams y adjoint une petite fugue guillerette pour trompettes, clavecin et orchestre, rendant la scène on ne peut plus humoristique. Le principe est sensiblement le même, plus tard, lorsqu’à la peur de l’affrontement avec le requin se mêle l’excitation de la chasse : le branle-bas de combat s’accompagne d’abord d’un thème volontaire puis la musique se gonfle d’héroïsme et d’insouciance, hommage évident aux films d’aventure maritime des années 40 et 50. Que penser enfin du départ de l’Orca qu’une courte marche à la légèreté quelque peu infantile et ridicule nous présente comme une folle équipée !
L’absence de musique sur certaines séquences va dans le même sens. Spielberg souhaitait en effet limiter les interventions musicales et laisser en certaines occasions l’intégralité de la bande-son aux seuls bruitages (qu’ils soient ou non naturels) : conversations anodines, hurlements d’enfants, sons de cloche, cris d’oiseaux, émissions de radio, etc… L’effet est flagrant lors des deux scènes de plage et l’intérêt multiple. Ce manque permet d’abord de rendre une séquence à suspense plus longue qu’elle ne l’est en réalité : il crée un effet d’attente soutenu, une impatience d’autant plus intenable que Williams et Spielberg ont auparavant (et ce dès l’ouverture du film) fort bien réussi à nous faire admettre que danger et musique sont intimement liés.
D’autre part, ce parti pris est à même de véhiculer un important sentiment de réalisme qui, en des instants particulièrement opportuns, permet non seulement d’accroître l’impact immédiat d’une action mais également de mettre en valeur le retour de la musique dans la suivante. C’est le cas notamment lorsque le requin, accroché aux taquets du bateau, met celui-ci à mal : le bruit assourdissant de l’eau et les hurlements des trois personnages se chargent alors de rappeler sèchement l’urgence de la situation sans qu’une musique ne vienne adoucir cette impression ni même la surcharger inutilement. De même lors de l’épisode du faux aileron : la panique sur la plage n’en devient que plus réaliste et cruelle (enfants renversés, personnes âgées piétinées, pendant que d’autres se délectent du spectacle à la jumelle !). L’exemple le plus saisissant nous vient cependant de l’une des scènes finales qui voit la mort de l’un des trois « chasseurs » : la tragique disparition de Quint ne s’embarrasse ainsi d’aucune autre musique que les cris désespérés de l’infortuné et le vacarme des objets dévalant le pont du bateau.
Il en résulte durant tout le métrage une véritable différenciation entre les espaces sonores (selon qu’ils soient musicaux ou non) ce qui, sans aucun doute, tend à en enrichir les contenus émotionnels. Chaque scène (ou chaque plan d’une même scène) est alors susceptible de se distinguer des autres en fonction de sa propre dynamique sonore et leur alternance au cours du film, parfois assez rapide, contribue à bousculer constamment le spectateur, à mixer ses sensations, parfois de façon contradictoire, entre imaginaire et réalisme.
Ce n’est pas là le seul intérêt. Si cette différenciation sert le film sans détour, elle n’est également pas sans le symboliser d’une certaine manière pour en exprimer l’essence profonde, notamment lors de la séquence générique. Ainsi, l’entrée dans le film s’effectue avant tout par le biais du son : des sonorités aiguës se font en effet entendre dès l’apparition du logo Universal, puis ensuite sur le fond noir où apparaissent les premiers crédits. Ces bruitages, qui peuvent évoquer des émissions sonar ou, pourquoi pas, des chants lointains de mammifères marins, se trouvent brusquement interrompus par la première note du thème musical qui peu à peu envahit la totalité de l’espace sonore en un crescendo soutenu.
En quelques secondes voilà ainsi résumée, à différents niveaux de lecture, la problématique initiale qui engendre le film : l’irruption de l’élément musical dans un milieu sonore, c’est l’étranger dans une communauté où il n’a rien à y faire. Ici, c’est d’abord le requin dans un écosystème sous-marin particulier qui en est normalement dénué mais aussi le chef Brody dans une station balnéaire insulaire alors qu’il a une peur maladive de l’eau ; beaucoup plus loin, parallèle très prisé à l’époque, c’est l’Amérique au Vietnam. Considérant maintenant la nature de l’orchestration, le sous-entendu s’enrichit encore : la mise en valeur des basses, et donc d’une certaine noirceur musicale, paraît facilement provoquer l’idée que le requin représente ce qu’il y a de plus bas, de plus vil dans l’Homme. Et à la partition alors de convier le spectateur à assister à une bataille, un nouvel épisode dans l’éternelle guerre entre le Bien et le Mal.
L’allusion à l’univers hitchcockien paraît enfin inévitable tant elle est devenue monnaie courante pour qui évoque l’aventure Spielberg. On connaît du reste fort bien l’admiration que le réalisateur vouait au maître anglais – ses renvois des plateaux de Torn Curtain (Le Rideau Déchiré) alors qu’il n’avait que 19 ans et surtout de Family Plot (Complot de Famille), quelques mois seulement après l’immense succès de Jaws, sont des anecdotes toujours très appréciées. Quoi d’étonnant alors à voir son film être ici ou là mesuré aux classiques d’Hitchcock, que l’on y décèle que le simple clin d’œil – l’utilisation très remarquée du fameux travelling compensé inventé pour les besoins de Vertigo (Sueurs Froides) – ou qu’on le considère comme une véritable extension de son œuvre en tant que successeur désigné de The Birds (Les Oiseaux).
Du côté musical, c’est vers Psycho (Psychose) que tend la flatterie, légitime à première vue puisque Bernard Herrmann, tout en figurant bel et bien parmi les influences avouées de John Williams (en bonne place aux côtés de Franz Waxman et d’Alfred Newman), a légué ou systématisé un certain nombre de figures musicales dont Jaws (comme bien d’autres partitions d’ailleurs) est lui-même pourvu. Spielberg en personne y est allé de sa petite phrase, décrivant en partie l’effort de son ami comme une rencontre entre le Herrmann de Psycho et le Erich Wolfgang korngold de The Sea Hawk (L’Aigle des Mers). Il n’est par ailleurs guère difficile de faire de quelques coups d’archet bien placés (lorsque Hooper, par exemple, se retrouve nez à nez avec la tête de Ben Gardner) des citations directes toutes trouvées et on ne peut que rapprocher la notoriété des thèmes musicaux, entrés très vite dans l’inconscient de générations de cinéphiles. Pourtant, au-delà du besoin que certains peuvent éprouver à élever un réalisateur et son compositeur au niveau de leurs aînés, il est tout aussi intéressant de constater à quel point les deux partitions fonctionnent de manière totalement distincte vis à vis de l’image.
On pourrait longtemps discourir sur les choix stylistiques des deux compositeurs. On est en effet avec Jaws bien loin de l’orchestre « monochrome » souvent évoquée pour Psycho : la préférence de Williams va au contraire vers une formation orchestrale aux sonorités chatoyantes et au détour de laquelle chaque timbre revêt un rôle bien défini pour trouver sa place au sein du discours musical. On remarquera notamment les effets « aquatiques », l’intervention saisissante du vibraphone lors de la première attaque ou les arpèges descendantes de la harpe après la destruction finale du requin. Mais les trait les plus significatifs concernent sans nul doute les fonctions attribuées aux thèmes eux-mêmes.
De Psycho, l’histoire a notoirement retenu le motif musical lié à la scène de la douche, qui reste quoi qu’on en dise un parfait exemple de synchronisme avec l’action, dans le sens où les glissandos des cordes restent liés de manière évidente aux coups de couteau, et donc à l’acte que constitue le meurtre… Dans Jaws, l’usage du motif attaché au requin tient par contre beaucoup plus de la mise en correspondance, notamment donc avec le danger que représente l’animal : à savoir que même si le requin est absent de l’action, la simple suggestion de ce motif suffit à faire naître le sentiment de sa présence. On ne peut d’ailleurs que constater, ainsi que précédemment, qu’en aucun cas ce thème ne se fait entendre de manière systématique lors de l’acte de mort lui-même, auquel cas il s’agirait de synchronisme. Il y a bien évidemment des exemples de pur synchronisme dans Jaws, y compris avec le fameux motif, en particulier lorsque Hooper (dans sa cage) voit approcher (crescendo) puis disparaître (décrescendo) le requin, mais il serait cependant tout à fait erroné d’affirmer que la partition entière repose sur ce principe…
Dans ce même ordre d’idée, on notera également comment deux cinéastes soulignent de manière tout à fait opposée un point culminant de leur récit en fonction du facteur musique. Ainsi, c’est la musique et les habiles stridences de Bernard Herrmann qui dans Psycho « figent » l’événement (le meurtre) dans l’esprit du spectateur (choix revenant d’ailleurs au compositeur plus qu’à Hitchcock), tandis que Spielberg choisit de faire brutalement disparaître l’un de ses principaux protagonistes (Quint) sans aucune autre musique que les sons et les cris. À sa manière il « fige » lui-aussi son événement, mais cette fois par un silence musical d’autant plus dramatique qu’il se veut réaliste.
Force est de constater que depuis sa première diffusion en 1975, cette partition, tout comme d’ailleurs le film qu’elle illustre, n’a rien perdu de sa superbe. Sans doute nombre de compositeurs rêvent de marquer l’histoire du cinéma de cette manière, en offrant, en plus d’un soutien de haute tenue artistique, un thème musical d’une telle force qu’aujourd’hui encore son pouvoir d’évocation demeure inaltéré.
John Williams, quant à lui, est pour ainsi dire un habitué de ce genre de prouesses, le dernier peut-être de ces trente dernières années, que l’on considère seulement l’étonnante ténacité de quelques unes de ses idées à jamais entrées dans l’inconscient d’un très large public, à l’image du signal extraterrestre de Close Encounters Of The Third Kind (Rencontres du Troisième Type) et des marches héroïques des sagas d’Indiana Jones et de Star Wars.
Aussi, si Jaws est devenu une référence du cinéma horrifique, on ne compte plus les citations à peine voilées, parfois à la limite du plagiat, qu’a suscité le célèbre motif du requin. On n’en retiendra ici que les détournements les plus savoureux, en particulier celui concocté par Elmer Bernstein pour Airplane ! (Y a-t-il un Pilote dans l’Avion ?), sans oublier bien entendu l’autodérision par John Williams et Steven Spielberg eux-mêmes en ouverture de 1941.
Le plus étonnant dans tout cela reste sans doute que deux notes ont suffi, et suffisent encore, à évoquer l’idée d’un requin. Avec le recul, il n’est d’ailleurs pas interdit de penser qu’il y avait certainement là pour le compositeur prétexte à une contribution minimale… Entendons par là que sa partition aurait très bien pu, à peu de choses près, s’en tenir à ces deux notes, à cette idée extraordinaire d’une suggestion par un motif élémentaire unique et obsédant, en en variant que la cadence, l’intensité et le facteur de présence, dans l’esprit de ce que John Carpenter fera quelques années plus tard pour Halloween. Autre fascinante perspective, non ?
Article paru précédemment dans le fanzine Colonne Sonore n°3 (Printemps-Eté 2001) sous le titre « Musica Dentata » et révisé en mars 2008.
Illustrations : © Universal Studios