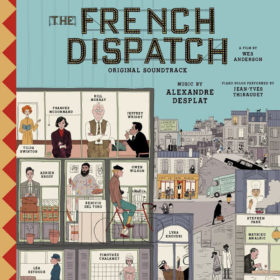En parallèle d’une fructueuse carrière française sous le signe de Jacques Audiard, Florent-Emilio Siri, Philippe de Broca, Daniel Auteuil et Roman Polanski, Alexandre Desplat s’est construit un impressionnant cursus hollywoodien: en l’espace de 10 ans, il a ainsi entre autres fait parler le roi George VI, rajeuni Benjamin Button, enchanté Harry Potter, planté un arbre de vie, décodé Alan Turing et dompté Godzilla ! La liste des réalisateurs ayant fait appel aux nombreuses facettes de son talent est particulièrement remarquable : Stephen Frears, Ang Lee, David Fincher, Tom Hooper, Terrence Malick, George Clooney, Kathryn Bigelow, Ben Affleck, Gareth Edwards… Un parcours d’exception qui a finalement été récompensé en février dernier par une statuette couronnant sa huitième nomination aux Oscars pour The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Une occasion idéale pour UnderScores de rencontrer une nouvelle fois le compositeur, qui nous a chaleureusement reçus dans son studio parisien pour une conversation passionnée sur sa carrière et ses projets.
Qu’est-ce que le fait d’avoir un Oscar a changé ? Recevez-vous davantage de propositions ?
C’est difficile d’en juger… Il me semble que je n’ai pas moins de propositions récemment qu’il y a quelque temps… Et puis j’ai la chance que mon planning soit organisé depuis un moment sur quasiment deux ans, voire plus pour certains projets. On m’avait raconté cette anecdote sur Maurice Jarre, qui n’avait plus de travail après son premier Oscar… Mais il commençait sa carrière américaine avec cet Oscar, avant il n’était personne aux États-Unis… C’était un compositeur français connu peut-être par ceux qui connaissaient notre cinéma, mais c’est ce film avec Lean qui l’a propulsé sur le devant de la scène, et derrière il a attendu qu’on lui propose des films. La différence, c’est que j’ai construit pendant dix ans une carrière américaine, et donc j’ai des metteurs en scène et des producteurs qui me rappellent parce qu’ils me connaissent déjà. Il y a donc un flot de films qui me sont proposés, et je touche du bois pour que ça continue. Par conséquent, l’Oscar n’a, de ce point de vue, pas changé grand chose. Cela dit, il y a un effet Oscar, qui ne me met pas très à l’aise parfois, dans la mesure où je suis quelqu’un de l’ombre : j’aime être chez moi, enfermé dans ma grotte à travailler, et je ne me montre pas beaucoup. Je sors très peu, mais comme il y a eu pas mal d’articles et de photos, on me reconnait parfois et il arrive qu’on me parle dans les boutiques, très gentiment d’ailleurs. L’autre effet Oscar, c’est d’avoir des amis qui n’étaient pas des amis avant. Si vous avez besoin d’amis, c’est formidable (rires).
C’est la première fois qu’on parle autant dans la presse de l’Oscar de la musique. Pourquoi ?
En premier lieu, il me semble que la musique de film devient aujourd’hui un vrai pôle d’attraction, pas seulement pour le grand public mais aussi pour les compositeurs. Donc cela explique peut-être une certaine effervescence autour du sujet. Et puis cette année, j’étais le seul français à être nominé.
Considérez vous encore être avant tout un compositeur français, malgré cette carrière américaine ?
Oui, évidemment. Et je le prouve chaque année en composant pour des films européens et français. C’est ce qui a été difficile pendant dix ans, de faire ce grand écart en permanence. Je n’ai pas voulu partir et oublier mon passé de compositeur français. C’est grâce au cinéma français que je me suis construit et que j’ai trouvé mon style, que j’ai évolué et appris mon métier. Car c’est aussi un métier, différent de celui de compositeur de musiques de concert. Donc je suis archi français. D’ailleurs la musique que j’écris, même si elle a été nourrie de compositeurs américains, ou italiens, est influencée de manière très forte par les compositeurs français, en tout cas en ce qui concerne l’écriture de l’orchestre.
Il y a de grosses différences techniques et budgétaires entre la France et les Etats Unis…
Oui, bien sûr, c’est très différent et ce serait frustrant si je n’avais connu que le cinéma américain. Mais comme j’ai connu les courts métrages français sans un centime, sans vidéo puisque cela n’existait pas, juste avec un chronomètre et quelques musiciens. Voire pas de musiciens et je jouais tout, ou Solré, ma violoniste fétiche, jouait les parties de violons en overdub… J’ai connu toute la pyramide, du plus bas au plus haut… Alors évidemment, si on me demande d’écrire un score très compliqué, très détaillé, avec beaucoup de musique et avec un orchestre énorme, cela devient compliqué parce que pour le faire bien, il faut du temps. J’ai appris, grâce à mon parcours français, à écrire et à enregistrer très vite, pour ne pas perdre de temps en studio et pouvoir enregistrer un nombre de minutes assez important. Encore aujourd’hui, aux États-Unis ou en Angleterre, quand j’enregistre, je vais très vite : pour Godzilla, je crois qu’on a réussi à économiser trois ou quatre séances, peut-être même plus, avec un orchestre de cent musiciens. Mais c’est important de pouvoir s’adapter. Aux États-Unis, je peux faire des trucs énormes, mais de toute façon le cinéma français ne propose pas de films énormes. Il ne réclame pas cette amplitude… Le Godzilla français, c’est quoi ? Il n’y en pas pas, voilà. Donc ça n’aurait pas de sens de faire ça. Mais il faut comprendre que le budget alloué à la musique de film aux États-Unis représente, je crois, entre 1 et 2% du budget total d’un film. En France, ce sera 0,1 ou 0,2%, c’est tout. C’est pour ça que dès que j’en ai l’occasion, je rappelle que les droits d’auteurs sont la clé de la survie des compositeurs. Parce que lorsqu’on est jeune compositeur, les budgets étant ce qu’ils sont en France, si on n’a pas de droits d’auteurs qui rentrent régulièrement, c’est impossible de survivre. Je n’aurais pas survécu sans mes droits d’auteurs quand j’étais jeune compositeur.
On peut donc s’attendre à de nouvelles collaborations avec Florent-Emilio Siri, par exemple ?
Jusqu’à maintenant, les metteurs en scène qui m’ont demandé de faire leur deuxième film m’ont toujours rappelé pour le troisième, le quatrième… Donc bien sûr, j’espère retravailler avec Florent, et Jérôme Salle, Gilles Bourdos, ou Jacques Audiard bien sûr. Même si le prochain film de ce dernier, Deephan, est une parenthèse dans notre collaboration car il s’agit de musique électro. Sans compter, j’espère, d’autres rencontres à venir. Il y en a peu pour l’instant, mais ce n’est pas forcément à cause des metteurs en scène, c’est parfois la faute de mon planning, d’autant qu’on m’appelle souvent beaucoup trop tard. Beaucoup de personnes pensent que je vis à Los Angeles, alors que je vis et travaille à Paris. Même s’il m’arrive d’aller travailler à Londres ou L.A., pour écrire ou enregistrer. Mais je vis à Paris, je n’ai jamais quitté cette ville.
Peut-être aussi que certains n’osent pas vous appeler, étant donné votre stature désormais ?
Qui est énorme, oui ! (rires). C’est possible, mais c’est bête : si le projet est beau, ça m’intéresse.
Comment faites-vous pour maintenir un tel rythme de travail sur autant de films chaque année ?
Je ne fais que ça. Je n’ai pas de vie à part écrire de la musique de film. Depuis deux ou trois ans, j’essaie d’écrire d’autres choses à côté mais… C’est ce que j’ai toujours voulu faire, écrire de la musique de film, depuis que j’ai choisi de ne plus être flûtiste. Ça me hantait depuis trop longtemps, le cinéma me poursuivait depuis trop longtemps, donc je suis parti à la poursuite du cinéma. Ma carrière française a fleuri lentement, très lentement, et j’ai appris à progresser lentement. Quand je suis arrivé à Hollywood, j’avais 44 ans. Il était donc temps de se mettre au travail, encore plus qu’avant. Mais j’ai toujours travaillé beaucoup, ce que savent ceux qui me connaissent depuis mon premier long métrage. Mes enfants se sont toujours plaint : je n’avais pas de weekend, j’apparaissais au mieux une semaine pour les vacances, parfois je repartais au bout de trois jours. C’est un choix que j’ai fait : j’ai choisi la musique et le cinéma. C’est une vraie discipline, je vis comme un samouraï : je sors très peu, je fais du sport, et voilà. J’ai des horaires un peu dingues : très tôt le matin et très tard le soir, je dors cinq ou six heures par nuit.
Vous arrivez pourtant à trouver du temps pour des projets personnels comme le Traffic Quintet ?
Oui, ce sont les seuls projets que je m’accorde, depuis une dizaine d’années maintenant, et qui m’ont beaucoup appris, grâce à Solré, que j’évoquais tout à l’heure, et que j’ai rencontré lors de mon premier long métrage en 86. Et qui est présente sur tous mes scores, sauf épisode américain ou anglais. Elle m’a ouvert à une nouvelle sensibilité dans l’écriture des cordes, que je n’avais pas avant. L’écriture, mais aussi l’interprétation. Dans mes musiques, les violons vibrent peu, je cherche des sonorités transparentes. On ne joue pas des cordes comme au 19ème, avec beaucoup de vibrato. C’est quelque chose de très important et qui je pense me différencie beaucoup. Cela donne à ma musique un style, et au-delà de la composition, c’est aussi dû à l’interprétation. Sans Solré, je ne serais sans doute pas là aujourd’hui, et c’est la raison pour laquelle je lui dédie cet Oscar.
Craignez-vous, si vous faites une pause, que tout s’arrête et qu’on ne vienne plus vous chercher ?
C’est ce qui se passerait, je pense. Le cinéma c’est un flot, une cascade qui ne s’interrompt pas. Et il y a toujours une petite barque qui a envie d’aller sur la cascade, et qui avance… Alors c’est dangereux, on peut se faire éjecter, se retourner, et on n’a plus le droit de remonter jusqu’en haut. C’est une cascade difficile à prendre. Je fais une parenthèse : j’ai entendu depuis quelques années beaucoup de commentaires un petit peu naïfs sur le fait que, si Alexandre Desplat a réussi à Hollywood, c’est que finalement, ça doit être fastoche. Donc on va y aller aussi, on va appeler un agent et faire carrière à Hollywood. Mais non, ce n’est pas facile. Il faut comprendre que dans la cascade, des bons compositeurs il y en a beaucoup, des excellents il y en a moins mais quand même quelques-uns. Donc si j’arrête d’écrire demain pour le cinéma, quelqu’un me remplacera, c’est évident. Est-ce qu’on aura envie de refaire appel à moi ? Je ne sais pas… L’avantage de ce rythme que j’ai et que j’aime (je crois que je serais malheureux si je ne composais pas), c’est que chaque film étant différent, puisque je fais en sorte de choisir des films qui sont différents, cela me permet de chercher d’autres choses musicalement. Donc j’espère que je me renouvelle, même si je suis sûr qu’il y a souvent des réminiscences des scores précédents, c’est normal. Mais il y a un vrai désir de ma part d’aller chercher des choses nouvelles, et de m’améliorer. Mais oui, je redouterais de m’arrêter, bien sûr.
Quelque soit le projet, on a le sentiment que vous privilégiez les réalisateurs dotés d’une vision…
Oui, bien sûr. Il me semble que c’est dû au fait que j’aime le cinéma, et que je suis sensible à la mise en scène et au point de vue, sans lequel il n’y a pas de film intéressant selon moi. Il arrive que des metteurs en scène réussissent un film, et seulement un film. Et les suivants ne fonctionnent pas. Si j’ai la chance d’être sur ce premier film, je suis content. Et c’est une chance quand on travaille pour des gens comme Polanski, Jacques Audiard ou encore Gareth Edwards. Je n’aurais par exemple jamais accepté Godzilla si je n’avais pas vu son premier film (Monsters, NDLR), que je trouve absolument dingue et fantastique, que ce soit du point de vue de la mise en scène ou de la narration. Cela constitue un aspect déterminant dans mon choix pour Godzilla, qui sinon ne m’aurait pas intéressé plus que ça… Ce qui m’intéressait, c’était d’écrire cette musique pour ce metteur en scène. Je pense que c’est un grand réalisateur, il a vraiment un talent. Et je pense que le prochain film qu’on fera ensemble sera fantastique. Mais c’est la même chose avec Stephen Gaghan pour Syriana, même s’il n’a pas fait de film depuis, ou Jonathan Glazer, ou Tom Hooper. David Fincher, n’en parlons pas, ou encore Kathryn Bigelow… Ce sont des metteurs en scène qui sont des auteurs, même s’ils n’écrivent pas leurs scénarios. Peu importe : Stephen Frears n’écrit jamais son scénario, mais tous ses films se ressemblent, que ce soit dans les sujets ou la mise en scène. Il y a toujours un fond social, toujours un esprit très anglais, très décalé, et un humour pince sans rire… C’est donc le plus important pour moi dans la réussite d’un film, c’est la clé. Cela ne veut pas dire que tous les films seront bons : s’il y avait une recette, il n’y aurait que des chefs-d’œuvre. Ni que toutes mes musiques seront bonnes, c’est pareil, il n’y a pas de recette. Mais au moins je sais que même si le film n’est pas un chef-d’œuvre, il y aura un point de vue. Par ailleurs, il y a aussi un phénomène lié à la confiance qui s’établit entre moi et le metteur en scène. Mais même si cette confiance existe, il y a toujours ce moment de la découverte de la musique, où l’on se retrouve de nouveau, lui comme moi, en danger. Alors mieux on se connait, plus on mesure ce danger, et même si j’adore les précipices, ça reste des moments délicats.
Vous faites souvent preuve de fidélité avec les réalisateurs avec lesquels vous travaillez…
Oui, mais cela me parait nécessaire : on a une espèce d’aventure pendant quelques semaines ensemble, et si cela se passe bien, qu’on aime cet échange, il y a un lien amical et professionnel qui se tisse, et qu’on a envie de développer.
Votre musique se distingue souvent par son élégance. D’où vous vient cette voix si particulière ?
Je pense que ça vient des racines de mon éducation musicale. Si je peux citer des musiciens qui m’ont touché, et qui me touchent encore : Ravel, Debussy, Messiaen, Bill Evans, Chostakovitch, Miles Davis, Nino Rota, John Williams… Si on prend tous ces noms, et qu’on les met sur une table, on va voir que tout cela est relié, vraiment. Raffinement orchestral, raffinement harmonique, force mélodique, ouverture d’esprit, ouverture aux autres cultures… Même Messiaen, qui n’aimait pas le jazz ou la variété française (et à l’époque, on avait Brel !), tous ces musiciens ont en commun l’Histoire de la musique dite classique, et l’Histoire de la musique du monde. Donc c’est peut être pour cela. Et j’ai cité ces compositeurs, mais j’aurais pu en citer d’autres, que j’aime beaucoup aussi et qui m’ont aussi influencé, mais je pense qu’avec ceux-là, on comprend à peu près les tenants et les aboutissants de ce qui a construit mon style.
Est-ce que ce style a été difficile à imposer à Hollywood ?
Je pense que j’ai eu la chance d’arriver sur cette plate-forme hollywoodienne avec Girl With The Pearl Earring (La Jeune Fille à la Perle), qui est un film très délicat, et qui autorisait une musique délicate, raffinée, subtile, sensible. Donc on m’a repéré pour ça. Je pense que si j’avais essayé d’imiter le panel hollywoodien, on ne m’aurait pas remarqué. J’aurai juste été un compositeur de plus, avec le même son que les autres. Donc le fait d’arriver avec une autre couleur m’a permis de me différencier. Après, tout le travail a été d’éviter de refaire la même chose. Et comme les compositeurs que j’admire, comme Williams ou Goldsmith, ou encore Alex North, que j’aime beaucoup, ou Elmer Bernstein, tous pouvaient écrire pour le jazz comme pour l’orchestre symphonique complet. Et j’ai voulu très vite aller chercher aussi cette reconnaissance-là, et me mettre en danger, car je ne savais pas, à ce moment-là, écrire d’énormes musiques symphoniques. Donc j’ai tenté de ne surtout pas être dans une niche. Il fallait que je m’échappe et que je prouve que j’étais capable de faire des choses plus importantes, avec des formations plus grandes, des choses plus épiques. Et ce fut le cas pour The Painted Weil (Le Voile des Illusions). Ou plus d’humour pour The Queen… Humour mais pas comédie. Je n’écris pratiquement pas de musique pour des comédies, ni des films d’action pure. Godzilla est un film de monstre, mais pas un film d’action. Ce n’est pas la même chose. Parce que cela ne correspondrait pas à ce que je sais faire. Je pourrais certainement le faire, mais je ne pense pas que j’y prendrais du plaisir. Et donc le metteur en scène non plus. Je peux m’amuser à faire un morceau d’action, mais il faut que ce soit dans un cadre plus global, pour que cela reste rigolo.
Justement, qu’est-ce qui vous fait accepter Godzilla, qui le différencie d’autres films du genre ?
C’est la conjonction de trois éléments : un grand studio, un metteur en scène très talentueux, et un sujet iconique, un morceau de l’Histoire du cinéma. Si un de ces éléments avait manqué, je n’aurais sans doute pas fait le film. Il faut un univers. Pour Harry Potter, la seule chose qui a fait que j’ai longuement hésité avant d’accepter le projet, c’était l’idée que John Williams était toujours là. Et je ne savais pas si je serais capable de reprendre la baguette magique. Mais cela s’est bien passé, et cela m’a fait beaucoup progresser. J’ai beaucoup appris en faisant ces deux films.
Y a-t-il une étape dans votre travail que vous appréciez particulièrement ?
Il y en a plusieurs. Le premier moment important, c’est quand je découvre le sujet pour lequel on m’a contacté, et que ce sujet est nouveau pour moi. Cela peut être n’importe quel sujet que je n’ai pas encore abordé, ou un livre que je n’ai pas lu. Cela peut être un metteur en scène qui m’appelle, et qui pour moi est un événement : je me souviens par exemple du texto qui suivait le premier appel de Terrence Malick, ou le premier coup de fil de Roman Polanski. Ou Stephen Frears, je me souviendrai toujours de son premier appel alors que j’étais à Delphes en Grèce. Il m’a appelé pour The Queen, et il fallait écrire la musique très vite. Le deuxième moment préféré, c’est quand je commence à trouver l’âme du film, ce qui est horriblement difficile, et qui me paraît toujours une torture. Le troisième moment, c’est quand je dirige l’orchestre pour la première fois. La première séance d’enregistrement, c’est fantastique. Et puis après : rien ! Après, c’est horrible… C’est pour cela qu’il faut que je passe vite à autre chose parce que je n’ai plus aucune sensation. Quand je réécoute, je trouve tout horrible. Je vais voir les films lors de la première, quand il y en a une et que je peux y aller, et puis c’est tout. Cela fait partie du passé, tout comme les CDs, qui sont rangés dans des tiroirs et que je n’écoute plus jamais. Alors parfois je suis obligé d’écouter quand je fais un arrangement ou une transcription pour une suite d’orchestre que je vais diriger ensuite en concert, mais c’est arrivé rarement. J’ai fait très peu de concerts jusqu’à maintenant. Donc dans ce cas, je suis obligé de m’y remettre, mais sinon c’est vraiment derrière moi.
Comment travaillez-vous avec les musiques temporaires ?
J’ai appris à le gérer de manière différente. J’avais su qu’Elmer Bernstein demandait toujours de voir les films sans musique, ce que j’essaie de faire aujourd’hui. Je vois donc d’abord le film sans musique temporaire, après je suis d’accord pour l’entendre. Mais le minimum d’éthique en tant que compositeur, c’est de ne pas copier la musique temporaire mais de faire autre chose. Et si le metteur en scène ou le producteur insiste, de dire : si cette musique vous plaît vraiment beaucoup, achetez-la. Quand j’ai travaillé sur The King’s Speech (Le Discours d’un Roi), Beethoven était déjà placé. Les producteurs m’ont demandé de composer quelque chose comme ça. Là, on est au-delà de la musique temporaire, c’est quand même Beethoven ! Cependant, elle ne devait pas rester. Je devais composer autre chose, mais j’ai refusé. Telle que la musique était utilisée, je n’aurais pas fait mieux. Alors certes, la septième est un chef-d’œuvre… Mais dans d’autres cas, le problème des musiques temporaires, c’est qu’elles ont un son, un rythme, un flot, quelque chose qui font leur originalité. Comment peut-on remplacer cela ? Ce n’est pas possible. Et souvent, les musiques temporaires ne marchent pas pour moi, elles ne fonctionnent pas. Ce n’est pas le bon rythme ou la bonne tessiture, pas la bonne orchestration… Il faut trouver autre chose. A moi de les convaincre de faire ça. Je ne suis pas sûr cependant que tout le monde le fasse… J’entends souvent des musiques qui ressemblent à d’autres, parfois même des musiques à moi d’ailleurs. Cette année j’en ai entendu un peu trop à mon goût. C’est un peu agaçant quand même. Mais c’est assez nouveau concernant mes musiques. Autant je crois que je peux l’accepter d’un gamin de vingt ans qui fait un court métrage, et qui s’amuse à faire un plagiat de Williams par exemple, c’est presque mignon, c’est touchant. Mais quand le compositeur commence à avoir un nom et plus de quarante ans… Je trouve ça un petit peu moyen. Copier les collègues, je ne trouve pas ça terrible.
Vous est-il arrivé de renoncer à un projet à cause d’une différence de vision avec la production ?
Oui, mais tout dépend des personnes qui font partie du projet, et de l’avancée de celui-ci. S’il s’agit d’un studio ou d’un réalisateur avec lequel j’ai une relation privilégiée, que vais-je faire ? Je ne vais pas claquer la porte. Et cela dépend du moment également, des moyens qui ont déjà été mis en œuvre… Je ne suis qu’un élément d’une production, pas un Dieu. Je suis juste le compositeur. Je dois juste trouver ma place. Si je ne la trouve pas très tôt, je peux partir, mais quand le manège à commencé à tourner, c’est difficile.
John Williams est pour vous une influence majeure parmi les compositeurs de musique de film ?
Oui. Depuis toujours. Majeure et décisive dans mon choix de devenir compositeur de musique de film. La manière dont il a digéré toute l’Histoire de la musique, particulièrement celle du XXème siècle. De Prokofiev à Stravinski, de Debussy à Ravel, il connaît et a digéré toute cette musique et quand on écoute du Williams, on sait que c’est lui, mais on sent la présence de cet héritage derrière. Et par dessus tout ça, il y a le jazz, et le jazz moderne. C’est donc le plus grand musicien de musique de film vivant. Point.
Vous parliez tout à l’heure de Jerry Goldsmith : vous êtes l’un un des rares à le citer fréquemment…
Il s’agit d’une influence à deux vitesses : il y a d’abord eu le score de Chinatown, le premier sur lequel j’ai été attentif à son art. Mais j’étais jeune, je n’avais pas encore vu La Planète des Singes. J’ai vu Chinatown au moment de sa sortie et c’est seulement après que je me suis mis à l’écouter. Là encore, c’était quelqu’un qui pouvait écrire du jazz comme de l’orchestre symphonique, de la musique de western, n’importe quel style. Une force mélodique incroyable, une puissance orchestrale fascinante, une ouverture dans la composition (ultra contemporaine dans La Planète des Singes, ou influencée par le jazz dans Chinatown), une force rythmique unique aussi, qui ressemble à peu d’autres compositeurs. C’est donc quelqu’un qui est venu graduellement faire partie de mon univers. Et Chinatown est une pierre très importante pour trois raisons : d’une part pour la qualité de la mélodie, l’orchestration fantastique et l’utilisation de la musique dans le film, évidemment pour Roman Polanski, et puis enfin pour la vitesse d’exécution, puisqu’on sait qu’il a dû écrire cette musique en un temps absolument dingue vu que Roman avait rejeté la partition précédente. C’est quelque chose qui reste en tête, et on se dit que peut-être un jour on se retrouvera dans cette situation de devoir écrire très vite. Alors j’ai appris, et l’expérience aidant, je suis capable aujourd’hui d’écrire, si ce n’est très vite, en tout cas vite. Pour certains projets, je vais vite, pour d’autres je suis très lent… Enfin je me trouve très lent, je trouve que ça ne va pas assez vite en tout cas. Donc voilà pour Goldsmith. Mais il n’est pas dans le pôle de départ que j’évoquais tout à l’heure, puisqu’il est venu après.
Quels sont vos projets à venir en 2015 ?
J’ai terminé hier le sequencing du CD de Everything Will Be Fine, le film de Wenders. Voilà un autre exemple de belle rencontre : il est fantastique, adorable, intelligent… J’ai adoré travailler avec lui. Musicalement, c’était très simple : l’axiome de départ étant un orchestre à cordes avec peut-être un instrument en plus de temps en temps. Ça a failli être une flûte et puis c’est finalement un piano. Mais il y en a très peu. Ce sont surtout des cordes. Il y avait un accord de la production avec la Suède, et nous sommes allés enregistrer avec un excellent orchestre, celui de Göteborg, et c’était génial. J’étais très content de travailler là-bas. Ils n’enregistrent jamais de musique de film, mais c’est vraiment un très bel orchestre. En plus je suis revenu là-bas, en quelque sorte, à mes premières amours : pas de clic track, diriger sans casque, c’était vraiment intéressant. Cela n’arrive plus jamais, ni à Hollywood, ni ici. C’est tellement plus simple avec le clic, cela va tellement plus vite. C’était donc intéressant, mais c’était possible parce qu’à l’image, ce n’est pas un film qui réclame des points de synchro super précis, même si j’ai tenté de garder le tempo des maquettes. C’était important d’essayer autre chose, c’était le moment pour moi de me mettre dans une position plus difficile, moins routinière, de me mettre un peu plus en danger. Et avant cela, il y a eu deux autres enregistrements : le film de Derek Cianfrance (The Light Between Oceans, NDLR), que j’ai enregistré le lendemain de mon retour des Oscars. Et juste après il y a eu le film de Matteo Garrone (The Tale Of Tales, NDLR), à Rome. En fait, j’ai fait trois films depuis les Oscars. Et Suffragette (de Sarah Gavron, NDLR), c’est fait aussi, c’était juste après Unbroken. Là je vais commencer le film de Robert Guédiguian (Une Histoire de Fou, NDLR) en France. Et puis il y aura le prochain Tom Hooper (The Danish Girl, NDLR), dans peu de temps.
Vous allez suivre une nouvelle fois les pas de John Williams avec Star Wars: Rogue One…
Ce n’était pas du tout programmé, mais il se trouve que Gareth Edwards a été appelé pour réaliser ce film, et qu’il a aimé notre collaboration. Dans ce cas, il n’y a pas à hésiter, donc j’y vais. Je ne sais pas encore de quelle manière je vais l’aborder, c’est dans un an… Mais j’en saurai plus dans quelques jours lorsque je vais aller voir Gareth. C’est un sacré challenge en tout cas, et par rapport à Williams, je suis toujours impressionné, mais j’ai plus de force aujourd’hui. La Force est avec moi…
Entretien réalisé le 17 avril 2015 par Olivier Desbrosses & Stéphanie Personne
Transcription : Stéphanie Personne
Illustrations : © Oscars.com / ScoringSessions.com
Remerciements à Eleni Mitsiaki, Xavier Forcioli & Alexandre Desplat pour sa gentillesse et sa disponibilité