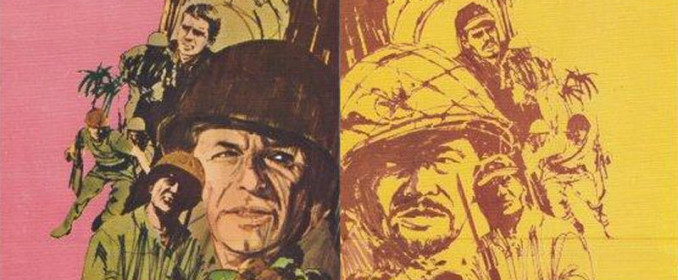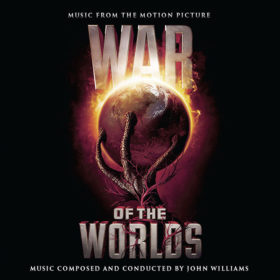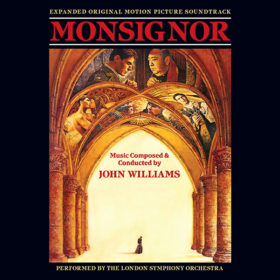JOHN WILLIAMS IN VIENNA (2020)
JOHN WILLIAMS IN VIENNA (2020)
Compositeur : John Williams
Durée : 74:34 | 13 pistes (CD) | 128:30 | 20 pistes (Blu-Ray)
Éditeur : Deutsche Grammophon
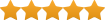
« Je voudrais un concert filmé de John Williams ! » a bien souvent écrit votre naïf serviteur dans ses lettres au père Noël, la main tremblante d’un fol espoir arrimée à un bic asséché. Las, si le compositeur ferait bonne figure en manteau rouge à capeline, l’attente fut longue sans que l’on sache bien pourquoi. La musique de film n’est certes pas la plus répandue dans les salles de concerts, et les captations d’autant plus rares, mais Williams a tout d’une exception : héros musical de franchises à forte valeur ajoutée, apprécié (voire adulé) par nombre d’adeptes de musiques populaires comme de celles dites classiques (Schindler’s List est entré au répertoire violonistique), armé d’une réputation légendaire et d’un carnet d’adresses stratosphérique. Plus encore, il est un chef d’orchestre régulier depuis le big bang Star Wars. Parallèlement à la parution d’œuvres de concert, son succès à la tête du Boston Pops Orchestra quatorze saisons durant (1980-1993) a donné lieu à de nombreux albums chez Phillips puis Sony, ainsi qu’à des retransmissions télévisées.
Pourtant, malgré une carrière accompagnant les vagues successives des VHS, Laserdiscs, DVD et dérivés, rien ou presque montrant Williams sur l’estrade n’a été rendu disponible en vidéo. Comme souvent, Internet sauve la mise à travers des témoignages parfois crapoteux mais néanmoins indispensables. Alors quoi ? Williams se moquerait-il de son legs vidéo comme de son premier bémol ? Il semble bien que oui, si on le compare à un Ennio Morricone qui prit soin sur le tard d’accumuler un nombre appréciable de captations, aux programmes comparables qui plus est. Faut-il y voir une soif (justifiée) d’éternité d’un côté, et une modestie (mal placée) de l’autre ? Ou peut-être un désintérêt quelque peu ironique de John Williams pour les supports visuels, quand sa musique brille par ailleurs dans les esprits cinéphiles ? Quoi qu’il en soit, être finalement adoubé sous la bannière jaune de la Deutsche Grammophon, surtout face à l’Orchestre Philharmonique de Vienne, est un symbole fort : le Wiener Philharmoniker est une institution, et la DG, fondée en 1898 par l’inventeur du gramophone Émile Berliner, demeure une référence malgré son rattachement au groupe Universal.
Depuis des années, le label élargit son public à travers des publications cross-over, visant à intégrer des artistes et répertoires extérieurs au périmètre habituel des rayons de musique classique (citons Sting, Max Richter ou Jóhann Jóhannsson). Les portes du château n’en sont pas pour autant grandes ouvertes, et il se pourrait qu’au moins deux entremetteurs, artistes influents du label, aient favorisé la naissance de ce bébé miracle. Le chef Gustavo Dudamel, grand supporter, a pu mettre l’eau à la bouche du compositeur en faisant filmer sa John Williams Celebration de 2014, tout en l’invitant à y diriger la Marche Impériale. Il entretient par ailleurs des liens avec l’orchestre viennois, et a dirigé leur concert du nouvel an 2017. Autre fan, la violoniste Anne-Sophie Mutter fut révélée par rien moins qu’Herbert Von Karajan, alors dieu vivant de la DG. Présentée à John Williams par le biais d’André Previn, récipiendaire en 2019 d’une flopée d’arrangements pour violon et orchestre (l’album Across The Stars), son rôle a dû être majeur auprès du label si on considère le soin porté à cet événement improbable : la rencontre d’un compositeur et chef typiquement américain ne voyageant plus en Europe depuis des années, multi-oscarisé, nourri au jazz et aux fanfares militaires comme au classique, et de LA formation symphonique viennoise, ancrée dans la tradition depuis sa création en 1842. Car ne l’oublions pas, un concert au programme plus habituel avait été initialement prévu en 2018, annulé par Williams pour raisons de santé. Anne-Sophie Mutter n’en faisait pas partie (à moins d’une apparition surprise), et j’ignore si cette version du concert aurait eu l’honneur d’une édition vidéo, mais on peut imaginer, pour le label, le supplément d’intérêt apporté par la violoniste allemande.
Quoi qu’il en soit, le triple résultat est là, issu des représentations des 18 et 19 janvier 2020 : une double édition CD/Blu-Ray, un CD simple ainsi qu’un double LP. Pour marquer ce couronnement, DG plaque d’or fin sa célèbre étiquette, en surplomb d’une photo au classicisme calculé, positionnant d’emblée Williams parmi les grands. Un coup d’œil suffit pour songer « grand répertoire », au contraire de « musique de film », et l’intérieur est à l’avenant. Précisons tout de suite qu’il faut acquérir la version Blu-Ray, car si la beauté musicale se contente d’un CD, ce dernier est allégé de sept morceaux déjà gravés avec Mutter (et un autre orchestre) sur leur album commun, ce qui dénature ce programme. Et surtout, il ne reflète pas l’essence de cette rencontre du nouveau monde et de la vieille Europe, à savoir l’émotion. Celle d’un orchestre heureux d’interpréter une musique qui désormais appartient à tous, celle de cet homme de quatre-vingts huit ans presque étonné d’être là, dans cette salle éblouissante, sur une estrade où brillèrent Gustav Mahler, le premier violon Willi Boskovsky au nouvel an, Karajan, Bernstein et tant d’autres. Voir le compositeur des Indiana Jones lever sa baguette au Musikverein génère d’emblée un sentiment de joie – c’est Noël, je l’ai déjà dit –, un parfum d’achèvement qui fait se rappeler l’époque où la découverte du double LP de Star Wars trouvait un écho dans celle d’une symphonie de Dvorak, ou d’une Shéhérazade.
Tout au long de ce royal programme, Williams se montre concentré, tendu lorsque l’orchestre faillit en de rares occasions, pressant ici le pas, donnant ensuite de la largeur, rectifiant d’une grimace un pianissimo trop sonore. Mais en dépit du stress inhérent à toute représentation, à chaque instant on le devine goûter le son du Wiener Philharmoniker, ses cordes veloutées, une cohérence travaillée depuis presque deux siècles par la technique et l’apport d’instruments appartenant à l’orchestre, transmis au fil des générations (certains sont d’ailleurs de conception spécifiquement viennoise : hautbois, clarinettes, cors ou trompettes). Durant l’entretien filmé qui complète le concert, Williams confie son appréhension initiale de confronter un ensemble aussi traditionnel à l’idiome particulier de la musique de film, avec ses ruptures de style et l’expressivité jugée parfois excessive – vulgaire, pour certains – du son hollywoodien. En d’autres termes, on aurait pu craindre que les viennois fassent pâtisserie, mais il n’en est rien.
Tout d’abord, le son de l’âge d’or d’Hollywood est largement la création de compositeurs d’origine européenne, dont le très viennois Erich Wolfgang Korngold. Ensuite, à côté des valses straussiennes, de Beethoven ou de l’autre Wolfgang, Vienne c’est aussi la fameuse « seconde école », celle de Schönberg, Berg et Webern. Pour très américaine et tonale qu’elle puisse être, la musique de Williams puise aussi là, en plus des classiques russes, français, anglais ou italiens. Une part de son succès réside dans cette synthèse de styles, qui va si nécessaire jusqu’au pastiche avoué ; il se confie d’ailleurs volontiers sur l’étourdissement créé par sa découverte de Vienne, la puissance de son histoire. Enfin, si les membres du Wiener Philharmoniker ne briguent pas la polyvalence du London Symphony Orchestra ou des brigades d’angelenos caméléons qui hantent les grands studios, ils ont dès l’origine pris soin de ne pas s’enfermer, par exemple en n’engageant pas de chef permanent. Dont acte, ce qui ne les empêche pas de sonner d’une manière un peu différente. Même comparées aux performances bostoniennes de Williams – également le fruit d’un ensemble canonique capté dans une salle de concert –, leur chant révèle leur identité : très homogène, contrasté sans s’époumoner, plus attentif aux nuances, détails et poli sonore qu’à la pyrotechnie, quitte à détendre le tempo pour mieux écouter. Il persiste quelque chose de chic, une force tranquille, un zeste de distance dans leur manière d’aborder ces musiques, sans snobisme ou intellectualisme car le respect de l’œuvre et la beauté restent les vertus premières. Faut-il applaudir ou regretter cette (re)tenue ? Ni l’un ni l’autre. Aucune interprétation ne devrait se vouloir définitive, mais plutôt creuser une voie personnelle. En cela, en dépit d’approximations ponctuelles inévitables pour un orchestre découvrant ces partitions durant des répétitions limitées, la réussite des viennois est presque totale.
Ce retour aux sources européennes étant noté, le programme établi par John Williams se révèle instructif. La contribution d’Anne-Sophie Mutter n’a d’ailleurs fait que l’accentuer. Adieu les marches olympiques trop yankee (le concert de 2018 prévoyait l’Olympic Fanfare And Theme), en sourdine les cowboys et fanfares militaires. Place à la sophistication dionysiaque des arrangements pour violon, qui nous éloignent du cinéma pour valoriser l’archet tranchant de leur interprète. Des pièces groupées en deux parties, superbes et parfaitement défendues, parmi lesquelles les échevelés Tintin et Donnybrook Fair, des Hedwig’s Theme et Devil’s Dance proprement diaboliques, ou une gracieuse Sabrina dont les subtils pas de danse font pétiller quelques yeux. Place aussi aux bipolaires Close Encounters Of The Third Kind (où la mélodie répond à l’atonalité), aux panoramas bucoliques du très beau Dartmoor, 1912 (à savourer, les échanges de regards du chef et du flûtiste solo, visiblement ému), au nostalgique Marion’s Theme, à l’enchantement moelleux et aux fanfares coruscantes de Hook et Jurassic Park, deux pièces particulièrement maîtrisées ici.
Voyez aussi les extraits de Star Wars : outre le thème principal (où quelques pupitres excités en perdent la mesure, c’est le maillon faible du concert), l’orchestre nous sert un chaleureux Luke And Leia (curieusement écourté) ainsi que The Rebellion Is Reborn, une pièce proche des premières symphonies de Sibelius, mais écarte des possibles et plus punchy Here They Come! ou The Asteroid Field. Heureusement, The Imperial March est bien de la fête, dans une lecture majeure équilibrant poids d’ensemble et sveltesse de trait d’une manière typique, seulement voilà : il s’agit d’un ultime rappel initialement absent du programme, réclamé par les cuivres avides de jouer les méchants. On peut alors imaginer – simple supposition ! – un compositeur si désireux de respecter ses hôtes qu’il hésite à inclure ce titre inévitable, une marche impériale maléfique qui, dans ce palais affichant la richesse d’un empire défunt, pourrait sonner comme un pied de nez. Vader a finalement épousé Sissi, par l’entremise d’un orchestre gourmand. Tant mieux pour nous, continuons !
Vous attendiez le requin de Jaws ? Vous aurez le plus classe Out To Sea & The Shark Cage Fugue, lu ici de manière trop précautionneuse mais concentrée, ou la qualité des musiciens palie sensiblement le manque de pratique de ce morceau ardu ; l’ivresse de la mer s’y fait peu sentir, mais l’ironie gaillarde de la ritournelle est bien là, le plaisir aussi. Il faut aussi noter que Williams l’a dirigé au même tempo avec le Boston Pops, il doit donc s’agir d’un choix artistique avant tout. Adventures On Earth est une plus belle réussite, et le chef Williams n’y est pas pour rien, soignant la tension d’une de ses créations les plus opératiques (hélas en version abrégée), relançant ou élargissant le rythme d’une baguette ferme. Significative également, en rappel cette fois, une lecture de la Raiders’s March aux langueurs contestables en tant que thème d’aventure, mais résonnant comme une marche cérémonielle en accord avec le lieu : le point d’orgue du couronnement, accentué par la présence de Mutter en konzertmeisterin occasionnelle. Une manière finalement émouvante d’interpréter cette marche qui n’est pas inhabituelle chez Williams, et se perçoit différemment dans une salle (il suffit de voir les réactions du public). Témoins de son plaisir à la faire sonner en ce lieu historique comme un vieil archéologue raconterait ses exploits, on s’attendrait presque à le voir demander au public de battre le rythme – c’est après tout la tradition avec la Radetzky-Marsch, en clôture des concerts du nouvel an.
En définitive, c’est un heureux voyage que propose ce concert. Williams rayonne, Mutter fait feu de tout bois, le plaisir des musiciens est palpable. À l’écoute du long entretien entre la violoniste et le compositeur, on se prend à regretter qu’aucun documentaire n’ait été filmé sur cette aventure viennoise, mais c’est de peu d’importance. L’essentiel est préservé dans un Blu-Ray à l’image et au son impeccables, à la dynamique raisonnablement maîtrisée, bien que d’une pièce à l’autre on ait parfois envie de monter ou baisser un peu le son (avis basé sur la piste HD-Master 2.0, évitez la piste Dolby Atmos dont les volumes m’ont parus très écrasés). Les heureux connaisseurs de Williams présents à Vienne ces jours-là revisiteront leurs souvenirs sous un autre angle ; quant aux pauvres hères dans mon genre, ils caresseront ce précieux pour l’éternité, en se consolant à la vision du témoignage qu’il représente. À ceux qui voudraient prolonger en images ce moment de partage avec l’orchestre viennois, je ne saurais trop leur conseiller les deux premières symphonies de Sibelius par Bernstein, à la transe quasi-mahlérienne, et le concert du nouvel an 1989 par Carlos Kleiber, vif, aux tensions rythmiques millimétrées, loin de la guimauve que ces danses peuvent évoquer. Williams, lui, s’est – et nous a – offert un merveilleux cadeau pour ses quatre-vingt-huit ans. Espérons que d’autres suivront, et qu’un jour des archives s’ouvrirons pour retracer enfin, en images, ce pan important de sa carrière.
Photographies : © Olivier Desbrosses