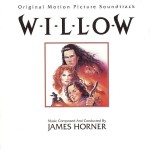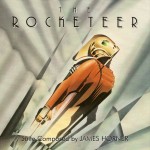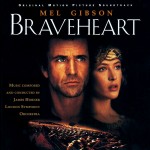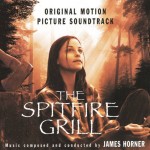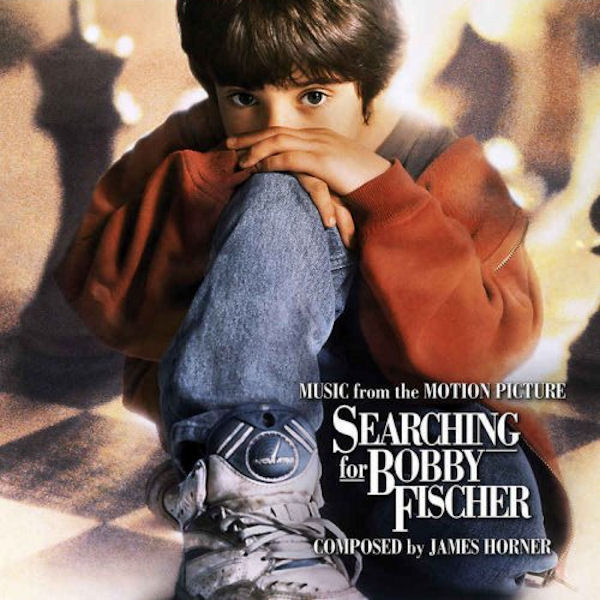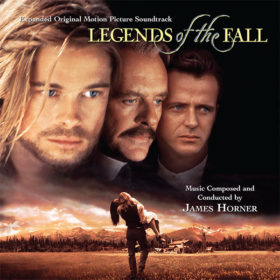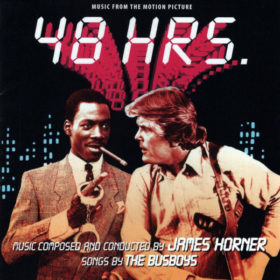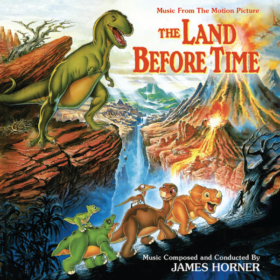Vous l’attendiez sans aucun doute de pied ferme : après la première partie de notre hommage consacré au regretté James Horner, voici que deux autres illustres membres de notre rédaction ont pris la plume pour vous faire partager leur propre vision des musiques du compositeur californien, tandis qu’un troisième a délaissé l’encre pour la Moviola avec un montage vidéo de ses partitions favorites.
O.D.
BENJAMIN JOSSE | Rédacteur pour UnderScores depuis 2010
Certes, en guise d’hommage, il fallait se satisfaire de vulgaires post-scriptum où l’on voyait Céline Dion glapir le refrain de My Heart Will Go On. Mais que les éminemment respectables chaînes du Service Public, et même le colosse TF1, se soient donné la peine de relayer l’information démontre que le prestige de James Horner s’étendait bien au-delà des limites exigües du petit monde de la musique de film. Encore que c’est auprès des amateurs, bien évidemment, que la disparition tragique d’un de leurs héros a soulevé le plus vif désarroi. Partout sur la Toile, les témoignages endeuillés ont afflué, pleurant la virtuosité technique et la sensibilité à fleur de peau d’un artiste à l’origine d’innombrables émois mélomanes. L’Espagne, authentique Eldorado pour les béophiles en quête de concerts spécialisés, est déjà sur le pied de guerre afin d’honorer très bientôt la mémoire du grand homme. Les rééditions frappées à son nom devraient, à n’en pas douter, se révéler pléthoriques au cours des prochains mois. Et le ciné-concert Titanic au Palais des Congrès de Paris, que le hasard funèbre avait rendu concomitant à sa mort, lui fut bien entendu dédié.
A bien y réfléchir, toutefois, quelle place occupait Horner sur le nouvel échiquier hollywoodien ? Et quel héritage laisse-t-il aux compositeurs contemporains, si prompts, pour nombre d’entre eux, à lui tirer une dernière fois leur chapeau ? La sincérité de Michael Giacchino, parmi les premiers à être montés au créneau, n’est pas à remettre en cause, lui qui s’escrime vaille que vaille à maintenir en vie d’antédiluviennes traditions symphoniques (ses Star Trek, pour ne citer que ceux-là, gardent dans le rétroviseur les opus mouvementés de Jerry Goldsmith comme le beau doublé d’Horner). Mais les exceptionnels privilèges du nostalgique Giacchino ne font que mettre en relief un paysage moderne gangrené par le sound design et un assourdissant martèlement de décibels. Un monde façonné depuis le début des années 90 par Hans Zimmer et ses légions de séides, et dans lequel feu James était autant à sa place qu’un gentleman tiré à quatre épingles au milieu de blousons noirs vociférants. A cet égard, la surprise avait été grande de le voir s’atteler à The Amazing Spider-Man, tant le jeunisme convoité d’ostensible façon par les producteurs semblait en porte-à-faux avec le classicisme très « vieille école » de son écriture. A l’arrivée, le résultat franchement boiteux n’a pas convaincu grand-monde, et surtout pas les pontes de cet inutile reboot, qui ont congédié Horner quand fut mise en chantier l’inévitable séquelle pour lui préférer Zimmer en personne.
Mais Horner, selon toute vraisemblance, s’en contrefoutait. Jadis maître du box office et des blockbusters estivaux, aux côtés notamment d’Alan Silvestri, il avait atteint grâce au triomphe planétaire de Titanic le summum ultra-médiatisé de sa carrière. Composé peu après, le sublime et caracolant The Mask Of Zorro augurait pour le fraichement couronné « king of the world » un futur radieux, fertile en projets de catégorie A qui lui auraient permis de bousculer l’empire Media Ventures (aujourd’hui Remote Control). Du moins le pensait-on. Car Horner, qui semblait ne plus couver des mêmes regards avides qu’autrefois les hautes sphères de la hiérarchie hollywoodienne, a peu à peu pris ses distances avec elles. Il y est parfois revenu, à l’occasion des fresques panthéistes de Jean-Jacques Annaud, ou encore et surtout du gigantesque Avatar, garant d’une entrée directe par la grande porte. Mais il était moins là question d’un désir subit de gloriole et de carriérisme que de la fidélité témoignée à de vieux compagnons de pellicule, sous l’égide desquels il donna jadis le meilleur de lui-même.
Dès lors à l’abri des despotiques desiderata des gros bonnets, Horner avait toute latitude pour s’adonner à son péché (pas toujours très) mignon : l’inlassable récupération de ses figures de style favorites, de ses motifs mélodiques familiers (à force de pugnacité, le bougre était presque parvenu à faire oublier que le mythique Thème de la Mort, devenu une sorte de running gag dans sa filmographie, emprunte en réalité à la Symphonie n°1 de Rachmaninov) et de ses instruments de prédilection, dont il passa l’essentiel des années 2000 à refaçonner les formes et les timbres, à la manière d’un joaillier polissant ses beaux cailloux encore et encore… au risque de leur ôter tout éclat. Avant même d’avoir atteint cinquante ans, le compositeur se trouvait quasi muséifié. Un privilège redoutable qu’on réserve généralement aux grands Maîtres, ce qui n’était sans doute pas pour déplaire à un Horner ayant rêvé dans ses jeunes années de conquérir la scène classique, mais qui a pour effet malheureux d’expurger une œuvre tout entière de sa vitalité. L’homme vient de brutalement périr, victime d’un terrible accident d’avion, mais sa musique avait pris depuis belle lurette l’apparence d’un poussiéreux vestige du passé, dont la planète cinéma ne se préoccupait plus guère malgré une admiration épisodiquement proclamée. D’aucuns ont fait part de leur sentiment qu’en même temps que James Horner, c’était une ère majeure de la musique pour l’écran qui s’éteignait. Ils ne s’étaient simplement pas rendu compte que l’Histoire, cette coupeuse de tête souvent impitoyable, n’avait pas attendu ce funeste 22 juin 2015 pour faire résonner le clap de fin.
D’ordinaire, le petit escadron de scores musclés dont 48 Hrs. et Commando sont les figures de proue n’est guère en odeur de sainteté auprès des fans d’Horner, qui considèrent ce déballage de synthés, de horions cuivrés et de free jazz comme, au mieux, un plaisir coupable. Une fois n’est pas coutume, cette parenthèse assez brève dans la carrière du compositeur n’appartient pourtant qu’à lui. Et Gorky Park est sans doute le meilleur avatar de cette veine délicieusement bâtarde.
Un jeune premier falot, des monstres blindés de prothèses caoutchouteuses et des rais de pistolasers multicolores : sur les écrans, Krull n’a jamais vraiment été à la hauteur de l’ambitieux mariage qu’il entendait célébrer entre fantasy «conanesque» et science-fiction «starwarsienne.» Mais Horner, galvanisé par l’une de ses toutes premières collaborations avec le LSO, veille au grain. Et dans un déferlement de sublimes chevauchées, il unifie les deux mondes sous la bannière du swashbuckler.
 STAR TREK III: SEARCH FOR SPOCK (À LA RECHERCHE DE SPOCK) (1984)
STAR TREK III: SEARCH FOR SPOCK (À LA RECHERCHE DE SPOCK) (1984)
Horner et les suites de ses propres scores, ça n’a jamais été une débauche d’inventivité… Du moins, cette sentence plutôt revêche est-elle l’œuvre de pas mal de ses fans. Tant pis pour ces rabat-joie ! Ils se privent de la rugosité tribale de Star Trek III, laquelle, non contente de tenir la dragée haute au très populaire The Wrath Of Khan, donne un avant-goût assez exact des charges féroces du futur Final Frontier de Jerry Goldsmith.
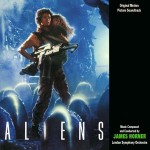 ALIENS (ALIENS, LE RETOUR) (1986)
ALIENS (ALIENS, LE RETOUR) (1986)
Ce n’est pas un secret, Iron Jim a chahuté plus que de raison la musique d’Horner, n’en donnant à entendre à l’écran que des tronçons suturés à la diable. Feu James ne méritait pas traitement si cavalier, lui qui enchaîne les uppercuts phénoménaux avec autant de frénésie que les Marines de l’espace n’en mettent à brûler d’innombrables cartouches. Rarement Prokofiev et Penderecki auront pu s’enorgueillir d’un hommage aussi convulsif que celui-là.
Sous sa casquette de producteur, l’oncle George voit « petit » et donne une fois encore libre cours à l’étrange passion qui l’habitait durant les années 80 pour les êtres de proportions lilliputiennes. Dieu soit loué, James Horner, lui, voit grand, et pas qu’un peu. Tout en même temps âpre et féérique, ténébreux (le fameux Thème de la Mort trompète jusqu’à plus soif) et gorgé d’héroïsme, Willow est une invitation à l’aventure qui résonne tel un glaive majestueusement tiré du fourreau.
Par intermittence, le film retrouve le feeling nostalgique du comic book pour les années 30 et 40, avec leurs pin-up à se damner et leurs rocambolesques serials. C’eût été du pain béni pour le Horner des eighties. Mais celui de la décennie suivante préfère, déjà, faire œuvre de classicisme. N’empêche qu’il s’y emploie avec une renversante maîtrise, accumulant violons romanesques et morceaux de bravoure aériens sans faillir un seul instant.
Une œuvre clef. D’abord pour ce qu’elle est, un ruissellement de romantisme bouleversant qui s’attache à prouver que non, l’épopée barbare de Mel Gibson n’est pas qu’un grossier étal de viande rouge. Ensuite pour ce qu’elle représente, une étape charnière dans le parcours d’Horner qui, tout juste un an après les flamboiements de Legends Of The Fall, posait les derniers jalons de sa nouvelle carrière, et d’une maturité glorieuse.
Avec un titre pareil, on pouvait s’attendre à tomber sur une suite de Commando où Schwarzy aurait grossi son arsenal d’un énorme lance-flamme. Il suffit de prêter l’oreille à ce solo de flûte cristallin, délicatement couplé à des cordes languides, pour réaliser que le Horner qui se tient aux commandes n’est autre que celui des mélos barbouillés de chantilly. Mais si le sentimentalisme règne ici en maître, il est dosé avec un art souverain et un irréprochable sens de l’équilibre.
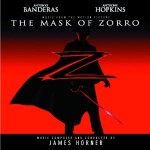 THE MASK OF ZORRO (LE MASQUE DE ZORRO) (1998)
THE MASK OF ZORRO (LE MASQUE DE ZORRO) (1998)
Si l’aventure avait un nom… ce pourrait fort être Zorro. Non pas celui qu’interprète Antonio Banderas tant bien que mal, loin du charisme bondissant des Douglas Fairbanks et Tyrone Power, mais le fougueux hidalgo dont les envolées hispanico-symphoniques d’Horner nimbent la silhouette des ultimes feux du couchant. Derrière ce thème éclatant pétri d’une noblesse secrète, s’étale l’immense horizon d’où tant d’inoubliables héros de l’enfance ont jailli.
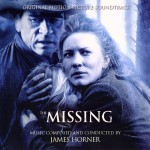 THE MISSING (LES DISPARUES) (2003)
THE MISSING (LES DISPARUES) (2003)
C’est peu dire que le Horner post-Titanic, bégayant, recyclant et s’auto-citant à tire-larigot, n’a jamais fait l’unanimité. Avec ses Peaux-Rouges belliqueux dont la moindre apparition est soulignée par les plaintes spectrales du shakuhachi, véritable fétiche dans l’instrumentarium usuel du compositeur, The Missing baguenaude lui aussi en territoire connu. Mais ô ! surprise, il frémit de la première à la dernière note d’une passion que nul pilotage automatique n’aurait pu engendrer.
SÉBASTIEN FAELENS | Rédacteur pour UnderScores depuis 2009
C’est entre autre par les œuvres de James Horner que j’ai découvert la musique de film au milieu des années 90. A cette époque, il avait déjà quinze ans d’une carrière bien remplie, marquée par un don certain pour le symphonisme, un sens de l’imaginaire sans complexe et une fougue inspirée et peu commune au cinéma. Les différentes facettes de sa jeunesse se sont exprimées dans des genres divers avec une prédilection pour le fantastique et la science-fiction, injectant un sang neuf revigorant : il recherchait en même temps qu’il adaptait son propre langage, sans jamais trahir des supports filmiques parfois difficiles à apprivoiser. Il a imposé cette vigueur chez Roger Corman (les impétueux Humanoids From The Deep et Battle Beyond The Stars) puis dans le sauvage Wolfen, a offert un véritable feu d’artifice musical aux Star Trek II et III puis a foncé tête baissée avec le thème chevaleresque d’un Krull mirobolant.
Entre l’expérience avant-gardiste hallucinante de Brainstorm et la violence latente et prégnante d’Aliens, le mysticisme délétère du Nom de la Rose marqua durablement les esprits. Maître savant du grand spectacle dans Willow, il s’envole ensuite avec le grandiose Rocketeer et confronte amour et cruauté dans le bouleversant Braveheart… Bien d’autres partitions marquantes ont suivi, mais durant cette période, Horner s’est montré l’un des plus productifs et les plus inventifs des compositeurs pour l’image. Très tôt et pendant longtemps, il a incarné à la fois la nouveauté et l’expérience. C’était un explorateur.
OLIVIER GALLIANO | Rédacteur pour UnderScores depuis 2011