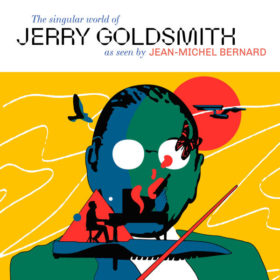EXTREME PREJUDICE (1987)
EXTREME PREJUDICE (1987)
EXTREME PREJUDICE
Compositeur : Jerry Goldsmith
Durée : 116:24 | 32 pistes
Éditeur : Intrada
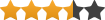
Combien d’épigones de Sam Peckinpah aux quatre coins du monde ? Ils champignonnèrent littéralement, grouillant et centuplant dans l’onde de choc nommée The Wild Bunch (La Horde Sauvage), le film qui, mieux qu’aucun autre, bouleversa la représentation graphique de la violence. Chang Cheh, l’ogre de Hong Kong, et son fils spirituel John Woo demeurent sans nul doute ses plus illustres héritiers, marqués dans leur chair par tant de nihilisme sur pellicule. Derrière eux se détachent quelques (pas si) petits maîtres chevronnés, à commencer par Enzo G. Castellari, robuste homme d’action des heures populaires de Cinecittà, parfois même réalisateur inspiré, et celui qui nous intéresse à présent, Walter Hill. Rétrospectivement, ce fut en succombant corps et âme à la fascination qu’exercèrent toujours sur lui les ralentis écarlates de Bloody Sam que Hill, grand talent du cinéma américain à ses débuts, amorça son fatidique déclin. Bien qu’il ne fasse pas partie de ses ratés cuisants, loin s’en faut, Extreme Prejudice ressemble au point de non-retour, la bascule fatale où la rigueur formelle et la sécheresse de la narration cèdent à une surenchère criarde un terrain qu’elles n’occuperont dorénavant plus. On peut d’ailleurs douter que Ry Cooder, si d’autres engagements ne l’avaient contraint à décliner l’offre de son vieux comparse de cinéma, eût été en mesure d’en retranscrire la brutalité cardinale.
Pour Jerry Goldsmith, appelé à la rescousse, ce type de challenge n’était bien sûr aucunement une gageure. En vérité, il déploya tant d’énergie à la tâche, embrasant les premières sessions d’enregistrement avec les presque dix minutes de The Plan, où synthés patibulaires et puissant crescendo symphonique s’étreignent de toute leur vigueur, que Walter Hill dut très tôt y mettre un bémol. Lui voulait une écriture moins chargée, un dépouillement dédaigneux des fioritures — une constante chez le cinéaste, dont la sensibilité a toujours fait fi de l’orchestre tout-puissant. En professionnel que n’obnubilait pas son ego, le compositeur obtempéra. Il en résulta une partition rocailleuse, qui charrie dans son lit vineux des fragments d’images au pouvoir d’évocation irrésistible : un infect tord-boyaux trônant sur une table tatouée d’innombrables culs de bouteille, la sueur souillant des chemises d’homme de sombres auréoles, l’éclair d’un œil torve sous le large bord d’un chapeau, un pouce calleux allant et venant, caresse presque sensuelle, contre la culasse d’un fusil… C’est un néo-western dans toute sa splendeur moite qui envoie dinguer ses vieux éperons, un concentré de virilité où la caricature règne en harpie. Le recours abondant à l’électronique, sœur quasi-jumelle des rudes frottements de silex qui deux ans auparavant écorchaient Rambo: First Blood Part II (Rambo 2 : la Mission), assoit son implacable justesse dès le préambule du film. Les cartes d’identité militaires s’égrènent, avec elles les faciès peu avenants de leurs porteurs, supposément morts, et la musique lève d’emblée le voile sur les mauvais coups qu’un tel conglomérat de barbouzes doit ourdir.
Inutile, donc, d’espérer mettre la main sur quelques artefacts rescapés des années 60, ce noble écrin abritant les plus beaux westerns de Goldsmith. À l’époque déjà, les cowboys avaient abandonné moult de leurs vertus derrière eux ; leurs successeurs pas commodes ont par-dessus le marché une gueule de bois terrible, et mieux vaut s’abstenir de les échauffer en picotant la musique des trop spectaculaires reliefs de Rio Conchos et Hour Of The Gun (Sept Secondes en Enfer). Un peu d’une nostalgie vague pour le vieil Ouest, quand des bolides constellés de mouches mortes n’avaient pas encore mis les chevaux au rebut, se profile tout de même en catimini, par le truchement de couleurs mexicaines traînantes et délavées au possible, mais toujours renflées de cette mélancolie qui ne manque jamais d’évoquer un bivouac sous les étoiles. Vaine réminiscence ! Les sales trognes fondant la totalité du casting d’Extreme Prejudice se fichent de ces sensibleries, quoique leurs centres d’intérêt soient restés peu ou prou identiques à ceux de leurs devanciers : régler d’anciens comptes et piller des banques. Voilà où ils excellent. Voilà, aussi, où Jerry Goldsmith n’avait pas son pareil, dans ces foudroiements de tension, dans l’essor vertigineux de l’adrénaline. Non pas qu’il ait gratifié Hill d’une manière de magnum opus ! Ses triturations synthétiques ont été plus inventives sous d’autres cieux, et leur fusion avec l’orchestre, plus artistement opérée. Mais c’est précisément ce côté mal dégrossi, cette physionomie épaisse et rembrunie en permanence, qui font l’impact formidable d’une œuvre résolue à ne pas y aller par quatre chemins. Le plaisir brut procuré aux oreilles friandes de charivari se révèle, à l’arrivée, égal au préjudice porté aux mâles raboteux qui (sur)peuplent le film : carrément extrême.