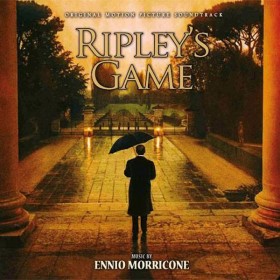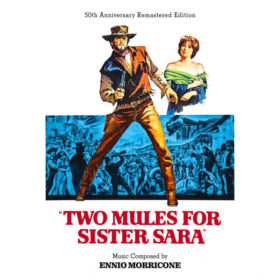UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA (1968)
UN TRANQUILLO POSTO DI CAMPAGNA (1968)
UN COIN TRANQUILLE À LA CAMPAGNE
Compositeur : Ennio Morricone
Durée : 64:57 | 14 pistes
Éditeur : Saimel Records
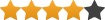
A chacun ses raisons, bonnes ou un peu moins bonnes, de débourser le prix d’un ticket de cinéma ou d’une édition vidéo. Les numéros de série, lorsqu’ils ponctuent un titre à succès, ont l’aura conviviale et rassurante des endroits branchés où la foule aime à s’agglutiner ; même s’il a vécu, le star system conserve des résidus de l’influence qui aimantait les spectateurs autour d’un visage adulé et remplissant presque toute l’affiche ; l’adaptation d’un roman largement plébiscité ou d’une bande dessinée populaire a d’emblée l’assurance d’attiser partout la curiosité ; ou encore, d’une façon déjà plus marginale, un nom peu ou prou perdu au générique, qu’il soit chef-opérateur, costumier ou maître-chorégraphe, peut avoir sur un cinéphile calé l’irrésistible pouvoir d’un phéromone. Et c’est ainsi que les amateurs de musique de film, ces freaks inquiétants qu’on ne désigne que d’un index tremblant, sont capables de se laisser tenter rien que par la présence au casting de leur compositeur fétiche — soit pour découvrir in situ une partition jamais parue, soit pour faire l’expérience via l’image d’une composition dont l’écoute isolée les aurait précédemment enthousiasmés… ou désarçonnés.
Votre honorable serviteur confesse ressortir à ce dernier cas de figure. Longtemps, il s’était demandé quel truc frappadingue avait pu enfanter Elio Petri, pour qu’un Morricone déchaîné obtînt si complètement carte blanche. Logé à l’occasion de ses films précédents à plus conventionnelle enseigne musicale (même si l’on ne peut en aucune manière prétendre que Piero Piccioni ou Luis Bacalov lui ait fait l’aumône d’un travail de vendu), le cinéaste venait de trouver alors en la personne du regretté Maestro un alter ego à la hauteur du dédain dont il cariait les formules toutes faites. Cette première fois, féconde en grincements stridents, coïncide d’ailleurs avec une autre : Morricone ne se contenta pas d’appeler en renfort les fidèles parmi les fidèles, Bruno Nicolai à la baguette et Edda Dell’Orso, au filet de voix plus spectral que jamais — non. Tout à sa joie d’avoir obtenu les pleins pouvoirs, il fit fructifier l’aubaine en ouvrant les portes du cinéma au Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, un cénacle formé de quelques-uns de ses amis musiciens et de lui-même. Leurs armes ? Un panachage d’instruments disparates, dont ils tiraient de si insolites onomatopées que l’on titube à la lisière du vandalisme. Leur credo ? Nihilisme, jusqu’au-boutisme et déconstruction méthodique d’un son « traditionnel » affligé, à leur goût, d’un embonpoint bourgeois. Oreilles délicates, prenez garde à vous !
Celles d’Elio Petri n’ayant jamais été du genre à s’épouvanter de la moindre note biscornue, Morricone put tout tenter à la tête de sa joyeuse bande. L’auteur traumatisé de ces lignes se ratatine encore d’effroi au souvenir de sa découverte de la chose, fruit d’un hasard aventureux, comme souvent avec le souk ahurissant et bariolé qu’est la musique de film italienne, et des rudes contrastes promis par la pochette peinte de l’album, où s’entrechoquent un titre qui fleure bon les gambades champêtres et le regard bleu turquoise d’un Franco Nero armé et visiblement dangereux. Quelle expérience ce fut ! Quelle chute vertigineuse dans l’œil du cyclone ! Tant et si bien que des années s’écoulèrent avant que ce rejet violent, presque cutané du radicalisme morriconien ne finît par se muer en une vraie curiosité à l’égard du creuset, forcément bosselé, qui lui avait donné forme.
Evidemment, l’objet n’est pas banal, en dépit d’un sujet somme toute classique qui s’articule autour d’une antédiluvienne demeure grevée de manifestations ectoplasmiques. A l’heure où le crépuscule tombait sur les swinging sixties, le fantastique gothique, qui agonisait en silence dans les cryptes à l’abandon de Cinecittà, n’avait pas droit de cité face à la caméra convulsive du futur réalisateur d’Indagine su un Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto (Enquête sur un Citoyen Au-Dessus de Tout Soupçon). Les gémissements pareils à une haleine de givre que pousse la grandissime Edda n’eussent malgré tout pas déparé une de ces ghost stories surannées, d’autant moins qu’ils ne s’élèvent que pour rendre palpable la présence de la gourgandine prénommée Wanda. Son parfum capiteux, même plus de vingt ans après sa mort tragique, continue d’enivrer les mâles qui jouirent naguère de ses faveurs, et jusqu’à ce peintre dévoré par un terrible mal-être qui croyait reprendre pied en fuyant le chaos urbain. L’une des scènes liminaires le voit errer en voiture dans le dédale de Milan, peuplé d’hallucinations, rayé de la voix tapageuse du Gruppo qui s’épanche en sifflements bonhommes et ritournelles espiègles. La gratte caricaturale du banjo, en pleine rivalité goguenarde avec une clarinette, ajoute à l’ironie, laquelle se fait quasiment sarcasme à mesure que les coins de rue et les carrefours bondés assaillent Franco Nero de mirages grotesques.
Voilà donc à quoi ressemble la séquence qui encouragea Morricone à braconner si loin des sentiers fréquentés à l’unanimité ! Les impromptus rois dont était friand son petit collectif ne font ici l’impasse sur aucun zigzag, travestissant la réalité sous des loups moqueurs et des colifichets qu’eût approuvés Lewis Carroll. L’écrivain est d’ailleurs cité sans trop d’ambages lors d’une séance de peinture à trois où des arbres sont barbouillés de rouge. Curieux moment, hélas dépourvu de musique. Il y a de quoi se demander à quelle sauce le Maestro aurait mangé ces précurseurs du land art… Mais voyons un peu plus loin, pour s’en faire un brouillon d’idée, l’inventivité grinçante qu’il met à illustrer les éclats de brutalité. L’instant charnière où le héros tourneboulé succombe à ses fantasmes mortifères accouche, sous l’égide du Gruppo, d’un vrai morceau de bravoure — mais pas exactement celui auquel les vieux réflexes mélomanes auraient pu nous préparer. Pas trace de soubresauts discordants qui touchent au point de rupture, aucun suspense abrasif, même pas un violon pleureur ! Rien que la régurgitation pêle-mêle d’une contrebasse rauque, d’une trompette rougeaude, d’un piano bastringue et, protubérance majeure de ce tohu-bohu, d’une flûte titubant à l’instar d’un ivrogne.
Dans ce sidérant capharnaüm, bon courage à qui essaierait de relever la plus chétive marque de compassion envers Vanessa Redgrave, sur la tête de qui les coups de pelle tombent en une giboulée meurtrière. Abstenons-nous pour autant d’en tirer des conclusions à la berlue : Morricone, disposant de par sa position privilégiée d’un temps d’avance sur le spectateur, n’ignorait pas à ce moment que les pulsions homicides de Nero n’avaient en fait jamais franchi les limites brûlantes de son esprit. D’où la propension canaille à se gausser de l’illusoire spectacle de la violence, comme s’il ne s’agissait tout bien pesé que d’un numéro de cirque où les tartes à la crème fusent. On pourrait prêter également à cette délirante embardée musicale, ainsi qu’à l’autre suscitée, une valeur cathartique rendue obligée par le ton fondamentalement rébarbatif qu’a imprimé le compositeur à Un Tranquillo Posto di Campagna. Quand elle ne répond pas du tac au tac à l’exubérance soixante-huitarde de la mise en scène de Petri, la musique s’assèche radicalement, prend une tournure chambriste avec ces cordes qui se perdent en pizzicati inquiétants, et bascule même dans une (quatrième) dimension bruitiste où l’imagination est sollicitée en abondance.
Ne seraient-ce pas là les raclements d’une porte coincée dans un chambranle trop étroit ? Et ici, ces sons rêches, ne dirait-on pas ceux d’une tête de clou lentement arrachée à une plinthe ? Telles étaient les questions interloquées et suintantes d’angoisse, noble lecteur, que votre amphitryon se posait jadis, privé de l’hypothétique secours des images et groggy face à tant d’iconoclasme toutes voiles dehors. Pourtant, le plan de bataille de Morricone coulait de source : le film ne présentant rien d’autre que le paysage mental béant d’ornières d’un fou, la musique se devait d’en suivre tous les reliefs biscornus sans en omettre aucun. Loin des facilités aux accoudoirs moelleux et des mélodies splendides dans lesquelles tient tout entière la réputation du Maestro défunt… Non, décidément, cet Ennio-là, fantasque comme rarement, n’est pas du genre à se laisser amadouer avec le sourire. Parviendrez-vous à entrer dans ses bonnes grâces ?