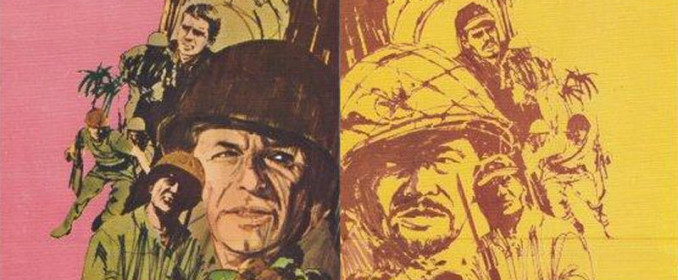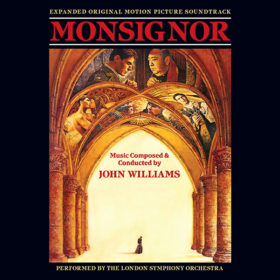STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK (1980)
STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK (1980)
L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Compositeur : John Williams
Durée : 44:55 | 13 pistes
Éditeur : Chalfond Records / Varèse Sarabande
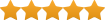
Flashback. Le 21 mai 1980, The Empire Strikes Back, la suite la plus attendue de tous les temps d’un des films les plus célèbres de tous les temps, illumine en exclusivité les écrans choisis d’une galaxie pas si lointaine : l’Amérique. Depuis cinq jours, mélomanes williamsophiles et alliés des rebelles se repaissent d’un double LP de sa bande originale éditée par le label RSO, ceci bien que son créateur, le producteur Robert Stigwood, se soit plaint auprès de George Lucas « qu’à part un morceau, toute la musique était déjà dans le vieux Star Wars. » Négociation de jawa ou cas de surdité flagrant ? Toujours est-il que les européens font les frais de sa frilosité. Pour toute pitance, RSO gratifie les pauvres hères de la bordure galactique d’un banal album simple, acte d’un marchand de disco manquant de foi dans la Force, que va heureusement surligner un phénomène inverse. Car de même qu’il y a un autre Skywalker, il existe un autre The Empire Strikes Back. Un redux enregistré à peine vingt jours avant la sortie du film, puis mixé, gravé, distribué au plus vite sur disque vinyle et cassette audio pour sortir en synchro avec lui. Presque simultanément, donc, à l’album officiel.
On peut s’en étonner : aujourd’hui, quel label achetant les droits du score d’un blockbuster accepterait une telle concurrence ? À cette époque, la cession de licences pour des versions « cover » de musique populaire reste un procédé fréquent pour générer du cash facile, mais il ne s’agit pas ici d’un dérivé disco, ni du énième avatar d’une œuvre multi-enregistrée. Le LP Chalfont Records SDG 313, produit par George Korngold (fils d’Erich Wolfgang), dirigé par Charles Gerhardt (fondateur avec Sidney Sax du National Symphony Orchestra), est un disque pour une large part comparable au RSO ; bien plus court que la version double LP, certes, mais à l’illustration excitante créée par William Stout, et enregistré en numérique « soundstream » (alors le top de la modernité), la spécialité de ce label audiophile associé à Varèse Sarabande. Bref, un concurrent aux arguments solides. Au final, difficile d’évaluer dans quelle mesure ces deux sorties ont pu se gêner l’une l’autre, ou au contraire doper les ventes, le RSO ayant connu le succès et le Chalfont n’ayant pas vraiment bénéficié de la même exposition. On peut surtout penser qu’elles se sont complétées, selon le leitmotiv de Charles Gerhardt visant à considérer ces musiques précisément comme des classiques, méritant des interprétations multiples. Concomitance des sorties mise à part, cet Episode V « bis » n’était d’ailleurs pas une première, puisque le chef d’orchestre a déjà (comme Zubin Mehta et d’autres) réenregistré pour RCA un Star Wars doublé de Close Encounters Of The Third Kind (Rencontres du Troisième Type), et récidivera pour Return Of The Jedi (Le Retour du Jedi). Juste retour des choses pour celui qui, à travers sa collection des Classic Film Scores dans les années 70, a ressuscité la musique postromantique de l’Age d’Or d’Hollywood – laquelle est la base des Star Wars. Dont acte.
The Empire Strikes Back version Chalfont (repris en CD en 1992 par leurs associés Varèse Sarabande) se veut donc une proposition parallèle, le geste d’un chef d’orchestre missionnaire conçu pour séduire l’audiophile et l’amateur de musique classique autant que le jeune fan du film cherchant à raviver le souvenir du pas des AT-AT sur son électrophone, à une époque où l’édition vidéo ne le permet pas encore. Une version encodée DBX est d’ailleurs produite pour les technophiles esthètes de l’époque. Forts de leur expérience (ils ont enregistré Kings Row de Korngold avec le même label en 1979), Gerhardt et son associé placent plusieurs cartes Jedi dans leur jeu. Outre les arguments déjà cités, des introductions signées Ray Bradbury et surtout John Williams en personne apportent de la crédibilité et un vernis « officiel » au disque. Le feuillet intérieur inclut aussi un texte du musicologue et orchestrateur Christopher Palmer qui, plutôt que de promouvoir le film, dresse un portrait du compositeur et contextualise sa musique, à la manière d’un disque classique. Enfin et surtout, selon la méthode habituelle de Charles Gerhardt, un travail de restructuration (l’ordre du film n’est pas respecté), de coupes et de menus arrangements est effectué (par Palmer ?), en puisant dans la « suite symphonique » publiée par Williams comme dans sa partition de base. Ce procédé qui a participé au succès des Classic Film Scores est critiquable si on est puriste, mais assumé et à la base de plusieurs grands moments du disque.
Nous sommes le 2 mai 1980, au Walthamstow Town Hall, à l’Est de Londres. Brian Culverhouse capte le National Philharmonic Orchestra avec dynamique et clarté, assortis d’une sensation d’espace notable dès les premières mesures. Dans l’optique de personnaliser sa version comme il le ferait d’une œuvre du répertoire, Gerhardt choisi son camp : parmi les influences de Williams, il délaisse la rondeur elgarienne pour mettre les russes en avant, Chostakovitch en particulier, en cultivant les angles, l’agressivité, la verdeur narquoise des cuivres. Préférant l’impact au beau son, il plonge l’auditeur dans une situation de concert avec son lot d’imperfections, compensées par un élan et une tension palpables. Le chef maintient son orchestre sous la pression d’une battue ductile, dramatisant, élargissant ou resserrant le tempo, poussant trombones et trompettes « en feu » à quelques approximations. À de rares moments, la matière musicale devient même brouillonne (certaines mesures de The Battle In The Snow par exemple). Mais la sensation d’urgence et ces cuivres parfois rauques, mal élevés, décapants voire dérapant à force « d’y aller », font aussi la force de cet album. Plus dommageable, l’équilibre instrumental n’est pas idéal sur tous les morceaux. Par rapport à la B.O., certains pupitres peuvent souffrir d’un manque de présence, on aurait aimé ici ou là une meilleure balance – sans doute le fait du temps de travail réduit, et peut-être aussi un manque de référence interprétative vu la date d’enregistrement. Mais on ne peut pas tout avoir. Tel quel, l’orchestre délivre une lecture serrée, différente de l’original, et qui quarante ans plus tard reste plus captivante que bien des réenregistrements cherchant équilibre et fidélité au risque de se montrer quelque peu policés, dont ceux issus de la baguette du compositeur.
Premières notes, premier miracle. La fanfare de la 20th Century Fox (merci à Alfred Newman, et à Gerhardt de l’avoir incluse) déclenche la guerre : les percussions résonnent du fond de la salle, on se cale dans son fauteuil, l’empire peut maintenant contre-attaquer. Nous sommes déjà captifs. Après un Main Title aux trompettes saillantes (le ton est donné) enchaîné à The Imperial Probe, Luke’s First Crash nous jette dans l’action avec conviction malgré une coupe un peu brutale dans la partition. La fin en particulier est exceptionnelle : Gerhardt y accentue la référence à Korngold en démultipliant la péroraison des trompettes, puis expose le thème de Vader avec un effet de menace, de cruauté dans le chuintement des cuivres, supérieurs à l’extrait original. Suivent une version précieuse car inédite ailleurs d’Han Solo And The Princess, incorporant en son centre le thème de Leia, puis un jeu sur The Asteroid Field (version de concert) qui accentue magistralement le contraste entre les deux expositions du motif central : accent (soutenu par les cymbales) porté sur l’attaque du thème dans la première exposition, puis décalé sur la seconde note dans la seconde partie de sa reprise. Frémissement pileux garanti.
Passons sur la pause inspirée qu’est The Training Of A Jedi Knight, première exposition du thème de Yoda (associé à celui de la Force), pour réattaquer avec The Battle In The Snow. Quelques mesures semblent hésitantes ou incomplètes, certains détails de l’orchestration foisonnante qui traduisent la mécanique des walkers se trouvent couverts, empêchant d’oublier la version originale, mais même ici le défi est relevé : dès la machine lancée, on est capté par l’énergie émise, l’effet de panique créé a du sens, et l’arrangement des dernières mesures fait mouche. Déboule alors l’inévitable Imperial March. Oui, mais avec un bonus tellement malin qu’il aurait à mon avis justifié son intégration dans la version concert de Williams : l’intro nous place sous le joug en martelant des mesures du Carbon Freeze original, exposant d’emblée la stature puissante du thème, auquel répond – après le rictus pincé d’une trompette – une marche véloce soutenue par des cuivres sardoniques, quasi ricanants dans la dernière partie, que Chostakovitch aurait appréciée. Pas au goût de tous, mais pertinent. L’angoissant The Magic Tree (virage mystico-psychanalytique aux modulations de synthé un peu anachroniques) s’achève sur une dissonance interrogative en lieu et place du thème victorieux de Vader, ce qu’on peut regretter, mais permet un enchaînement doux avec le toujours noble Yoda’s Theme, fidèlement restitué, qui vient y répondre en nous rassurant.
Cette pause réflexive conduit à The Rebels Escape Again et sa fin spectaculaire (présence marquée du tam-tam), et enfin, association particulièrement dynamique, aux deux morceaux conclusifs. Lando’s Palace / The Duel, après une tension bien menée (l’accélération subtile des dernières mesures), voit Gerhardt « ouvrir » le dernier accord pour enchaîner – après un bref silence – sur le Finale (en fait les End Titles). Et quel point d’orgue ! Ce qu’on entend est le fruit d’un chef d’orchestre habité, qui a visiblement soigné ce moment, au point d’éclipser la version de John Williams lui-même ; une réussite d’autant plus appréciable qu’il s’agit du seul réenregistrement connu à ce jour. L’expressivité obtenue par le rubato et la maîtrise des accents impressionne. L’attaque (commune à tous les Star Wars) est donnée sur un rythme rapide qui déteint sur la joyeuse reprise du Yoda’s Theme, lequel se trouble, pour vite se dissoudre dans l’irruption inexorable d’une marche impériale frappée comme rarement, cinglante, sans espoir, qui soudain – par quel miracle ? – baisse le ton et cède l’espace à quelques mesures de transition ; Han And Leia dansent puis, embrasés par un crescendo appuyé, se consument à l’instar de Roméo et Juliette ; l’orchestre alors se distend d’émotion pour mieux se libérer (déclinaison de The Throne Room, fanfare rebelle), Gerhardt élargit encore le geste pour égrener les fameuses mesures dissimulant le thème de Vader, suspend tout – une fraction de seconde, mais on voudrait qu’elle se prolonge, car on sait la conclusion imminente – et enfin, après une ultime scansion des timbales, fait monter le clash final des tréfonds de la terre. Là, c’est nous qui levons les bras… pour applaudir !
En conclusion, il suffit de citer John Williams : « Quand j’ai entendu un pressage test, j’étais ravi. Un grand orchestre, le son opulent et le phrasé dramatique de Gerhardt se combinent pour s’ajouter à une liste croissante de grands enregistrements de musique de film. » On peut ajouter à ce constat l’évidence d’une rencontre, celle des deux artistes responsables (l’un sur les platines, l’autre sur les écrans) de la résurgence, dans les années 70, d’un symphonisme cinématographique qui fait encore aujourd’hui des émules.