 LE CINÉMA DE CLAUDE SAUTET (2002)
LE CINÉMA DE CLAUDE SAUTET (2002)
Compositeur : Philippe Sarde
Durée : 77:33 | 27 pistes
Éditeur : Universal Music France – Écoutez le Cinéma !
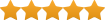
Mais qu’est-ce que ça pouvait cloper, à l’époque ! A revoir aujourd’hui les films de Claude Sautet, il est assez amusant, et très révélateur en même temps de l’évolution tendancieuse des mœurs, que ce ballet sans fin de cigarettes consumées, véritable cauchemar pour les ligues de vertu, soit l’une des choses qui frappent d’emblée. On succomberait même de bonne grâce à la tentation d’en faire une composante à part entière du style du cinéaste, où s’entrelacent avec un bonheur jamais retrouvé depuis de subtiles et chaleureuses études de caractère, des visages récurrents (ah ! Romy, ah ! Montand, ah ! Piccoli) qui, l’air de rien, aimantent passionnément la caméra et des conversations animées dans le bistrot du coin. Ceci dit, il ne se trouve plus beaucoup d’exégètes scrupuleux pour faire remarquer que Sautet, avant de devenir l’un des chantres de l’auteurisme français, avait tâté des flingues et des archétypes de la série noire via ses activités de scénariste (le script de Borsalino est en partie son œuvre) et ses premières et sporadiques tentatives de mise en scène. Pour les historiens du cinéma et les biographies officielles, sa vraie naissance a eu lieu en 1970 avec Les Choses de la Vie. Aux yeux du petit monde de la musique de film, l’événement compte double, car ce baptême coïncide très exactement avec celui de Philippe Sarde, l’enfant terrible de la production hexagonale, qui étrennait là ses talents pléthoriques et virtuoses.
Quel formidable coup d’essai a été pour lui Les Choses de la Vie ! Vrai ou faux, on se plait à imaginer le compositeur subjugué par la très belle scène d’ouverture, qui montre littéralement à rebours le destin brutal vers lequel se précipite Michel Piccoli (et qui, au passage, devrait faire avaler sa chique à Paul Anderson, persuadé qu’il est de s’être hissé à la pointe de l’avant-gardisme avec le hideux incipit de Resident Evil: Retribution). Cette inéluctabilité poignante, non contente d’enfiévrer le piano se déversant du merveilleux Générique, va peu à peu gagner le film tout entier et souligner de traits d’autant plus ostensibles ses ruptures de ton soudaines. La Rochelle, abîmé dans de mélancoliques tréfonds, donne admirablement corps à cette dualité interne, les doux solos de trompette d’un bonheur ordinaire et baigné de soleil se voyant parasités tout à coup par une poignée de notes funestes qui représentent autant de foudroyants inserts où Piccoli, piégé dans sa voiture, exécute une affreuse danse de mort. Au cœur de ces eaux troublées, Sarde évolue avec autant d’aisance qu’un vétéran rompu à toutes les lois de la dramaturgie. Au risque de suivre de hâtifs raccourcis, disons-le tout net : il y a en lui un peu de Michel Magne, dont l’allégeance aux maîtres (Auric, Van Parys et tant d’autres) n’a jamais pu domestiquer d’impérieux désirs de subversion, et aussi un peu de François de Roubaix, le bricoleur autodidacte qui voyait en chaque nouveau film un terrain vierge n’attendant que d’être fertilisé par ses inventions barrées. Réticent comme eux à établir des hiérarchies par trop étanches entre l’onctueuse mélodie fignolée avec amour et la musique savante que zèbrent d’inquiétantes zones d’ombre, Sarde n’aura de cesse, tout au long d’une carrière protéiforme, de poursuivre l’une et l’autre de ses assiduités.
Si l’on ne devait citer qu’une figure de style parmi celles, multiples, ayant subi les derniers outrages entres les mains rustres des compositeurs actuels, l’ostinato viendrait spontanément à l’esprit. Sarde en a fait le point névralgique des deux œuvres suivantes pour son pygmalion, avec des fortunes pour le moins diverses. Max et les Ferrailleurs, qui soumet aux teintes plombées du film noir une petite formation incluant trompette, batterie ou encore xylophone, séduit au premier abord. A l’aube d’une nouvelle carrière qui le sacrerait patient chirurgien des fêlures de l’âme, Sautet n’avait pas encore biffé d’une rayure définitive son ancienne spécialisation, et la musique n’est pas pour rien dans la robustesse du pont que le cinéaste a jeté entre ces genres a priori ennemis. Moins heureuse, toutefois, est l’usage d’une ligne synthétique endiablée dans César et Rosalie, autre affaire de contrastes tranchés. Romy Schneider, promenant avec elle un immuable sourire de Madone et un thème empli de douceur, plonge dans tous ses états le compulsif Yves Montand, dont l’humeur régulièrement orageuse, symbolisée par le son (daté depuis lors) du moog, éclate ça et là en d’incoercibles caprices (prétexte idéal à de virulents passages atonaux, dont la présente anthologie ne donne hélas que fort peu à entendre). Certes, en prenant la température d’un caractère trop prompt à s’embraser, l’ostinato qui parcourt César et Rosalie en filigrane a l’incontestable mérite de la cohérence. Mais l’expérience musicale ne restera pas, elle, comme un joyau nimbé de mille feux dans la discographie de Philippe Sarde. Il était prophétisé que ce dernier, en dépit de ses élans de touche-à-tout génial, ne réussirait jamais vraiment à dompter les particularismes de l’électronique (écouter les affèteries synthétiques d’Eve Of Destruction et périr !). Et ce n’est pas du déroutant glop-glop de Quelques Jours avec Moi, écrit bien des années plus tard, que viendra la rédemption.
Mais ne brûlons point hâtivement les étapes. Nous sommes encore en 1974, en plein dans la décennie la plus féconde qu’ait traversée Sautet, et son compositeur d’élection vient de lui offrir le superbe thème de Vincent, François, Paul et les Autres. Un film choral, comme le suggère de très prosaïque manière son titre, où les errements existentiels d’une bande de vieux copains s’emploient sournoisement à saper leur amitié. Très honnête, comme à l’accoutumée, envers ses personnages, le réalisateur n’oublie pas qu’une même pièce peut présenter deux faces en tous points opposées. Les subtiles inflexions du Générique ne disent pas autre chose, passant de l’allégresse d’un bandonéon chargé d’éclats de rire, d’accolades fraternelles et de sourires complices, aux tourments secrets que dévoilent subrepticement les cordes. Ce qui s’ensuit relève sans conteste de cette deuxième veine. Que ce soit dans les tons graves de Convalescence ou dans le trot remuant d’un Course à l’Argent bientôt hors d’haleine, l’accordéon est petit à petit dépouillé de ses atours joyeux. Une amertume palpitante s’esquisse, la même qui, à bien des égards, donnera le la deux ans après au saxophone hypnotique de Mado, partition rêche et lancinante conçue pour un film aux (trop ?) nombreuses ramifications. Claude Sautet y convoquait pour la dernière fois les silhouettes menaçantes et les périlleuses malversations dont il faisait grande consommation à ses débuts, et Sarde, peut-être conscient de se trouver face à une sorte de chant du cygne, imprégna chaque note couchée sur le papier à musique d’un tenace goût de cendre.
Plus généralement, le compositeur s’épanchait alors, sous l’égide de Sautet, dans un courant sombrement introspectif auquel seul le très enjoué Garçon ! finirait par mettre un terme. Les marivaudages amoureux lourds de conséquences d’Une Histoire Simple, le visage fermé du Mauvais Fils Patrick Dewaere en quête d’une douloureuse rédemption, autant de motifs et d’images gris anthracite auxquels Sarde va donner la réplique avec toute l’humilité requise, ici le dépouillement d’une écriture chambriste, là un magnifique solo de trompette à la voix grave. Quoi de plus naturel que nos deux compères, après s’être si longtemps immergés dans de pesantes atmosphères, aient éprouvé le besoin réciproque d’ouvrir une parenthèse récréative ? Elle est symbolisée ici par le sourire malicieux d’Yves Montand, vêtu de l’uniforme immaculé de ces garçons de café qui ont empli de leur présence discrète tous les films de Claude Sautet. L’hymne qu’a inventé pour eux Philippe Sarde est une petite merveille de fantaisie, dont le ton très coloré et le tempo presque martial, figurant avec humour un bataillon de serveurs marchant au pas de l’oie, chassent sur les mêmes terres que le jubilatoire thème du Grand Restaurant de Jean Marion.
Pour ses détracteurs, insensibles à sa formidable justesse de ton, Sautet était la caricature terminale de l’auteur, un type si accaparé par son propre nombrilisme qu’il ne se rendait pas compte, à rabâcher film après film les mêmes historiettes, que les spectateurs étaient saisis de catalepsie dans les salles. Voir invectivé de la sorte un réalisateur avec qui il entretenait une relation fusionnelle devait faire bouillir le caractériel Sarde. Et peut-être même ces objurgations critiques l’ont-elles incité à redoubler d’efforts pour rabaisser quelques caquets : ainsi, après l’euphorie symphonique de Garçon !, place au minimalisme électronique de Quelques Jours avec Moi. Le geste est plein de panache, à défaut de faire oublier le peu d’atomes crochus entre le compositeur et les sons synthétiques qu’il manipule tant bien que mal, comme on le ferait d’une patate brûlante. Un je-ne-sais-quoi d’intrigant émane toutefois de ce petit bricolage, qui, précisément parce qu’on ne sait trop quoi en penser, s’accorde étrangement à la brebis galeuse interprétée par l’impassible faciès de Daniel Auteuil. Les instruments acoustiques, nullement délaissés du reste, ornementent le synclavier avec une indéniable élégance, quand ils ne font pas directement écho à son tracé rectiligne, en particulier sous l’impulsion des bois. C’est peu, à l’évidence, pour qu’on puisse désigner un acmé dans les hauts faits d’armes du tandem Sautet/Sarde, mais c’est déjà assez pour qu’on y réfléchisse à deux fois avant de le pourfendre sans états d’âme.
Puis vinrent les années 90, ultime palier de l’œuvre et de l’existence de Sautet, avec leur cortège de bouleversements que Sarde, bien qu’à mots couverts, a toujours paru déplorer. Film « de la maturité », comme il est d’usage de qualifier le travail d’un artiste ayant tourné le dos à la fougue de la jeunesse pour s’ouvrir à toutes les formes de l’austérité, Un Coeur en Hiver pourra déconcerter le fan de la première heure, qui ne succombera à son pouvoir émotionnel qu’après avoir écaillé le glacis faussement terne le protégeant. Difficile de juger si Sarde a su faire abstraction des a priori négatifs qui le taraudaient, ses propos mi-figue mi-raisin n’aidant pas, encore moins sa mise à l’index au profit d’un panel d’extraits du répertoire classique (les sonates et trio de Ravel). Depuis plusieurs années, Sautet lui disait caresser l’éventualité de cet académisme musical. Le compositeur se serait-il calé sur les mêmes pointillés si son cicérone lui avait offert de concevoir une partition inédite ? Nelly et Monsieur Arnaud est, à sa façon, le score le plus à même d’y répondre. A l’instar du Sautet nouveau, constamment sobre, les yeux rivés avec obstination sur l’essentiel, Sarde n’hésite pas à assécher son écriture (qu’il semble loin, le laboratoire en perpétuelle ébullition d’où sont issus Mado et Max et les Ferrailleurs), incluant au premier rang de ces purges stylistiques le pupitre des cuivres qu’il réduit à quelques apparitions éclairs. Qu’on ne se méprenne pas : le résultat n’a rien de lymphatique, charmant et envoûtant tout au contraire par son rythme enlevé et par la richesse de ses nombreuses strates, lesquelles s’emboîtent pour délicatement donner vie à de romantiques soupirs, puis se désolidarisent sans effort apparent, puis se rejoignent encore, au gré des desiderata de leur architecte.
Elégante et embuée d’émotion, la musique de Nelly et Monsieur Arnaud aurait pu être le prélude à un partenariat transfiguré, où les opus à venir auraient épousé les contours d’un cinéma désormais assagi, moins foisonnant en apparence, mais toujours scintillant d’humanité. La mort approchant à grands pas, conjuguée à des calendriers de tournage qui s’étaient radicalement espacés depuis Garçon !, en ont décidé autrement. Dans la toute dernière interview accordée de son vivant, jamais conduite à son bout et présentée par Stéphane Lerouge en conclusion de cette anthologie, Claude Sautet parlait pourtant avec l’accorte jovialité de celui qui n’attendait que l’instant propice pour dégainer de ses tiroirs deux ou trois scénarios cousus main. Sa voix grevée de saccades n’avait évidemment rien de semblable avec celle, envoûtante, de Romy Schneider, que ce disque fait surgir elle aussi de l’au-delà grâce à la poignante Lettre de Rosalie murmurée dans César et Rosalie, ou à La Chanson d’Hélène que l’actrice et Michel Piccoli entonnent doucement dans Les Choses de la Vie. Mais c’est un inestimable plaisir que de l’entendre évoquer son compositeur fétiche et ami, et ces années de labeur opiniâtre où tous deux se sont ingéniés à chercher le meilleur « climat », selon l’expression qui revenait continuellement dans la bouche de Sautet. Un climat, une atmosphère, un timbre spécifique, dont le bon génie Philippe Sarde, porté par des capacités d’invention se jouant de tous les garde-fous, n’avait pas son pareil pour en élaborer les formes.























