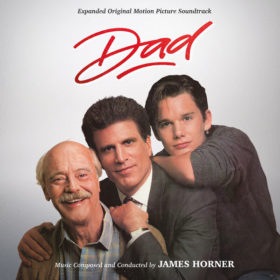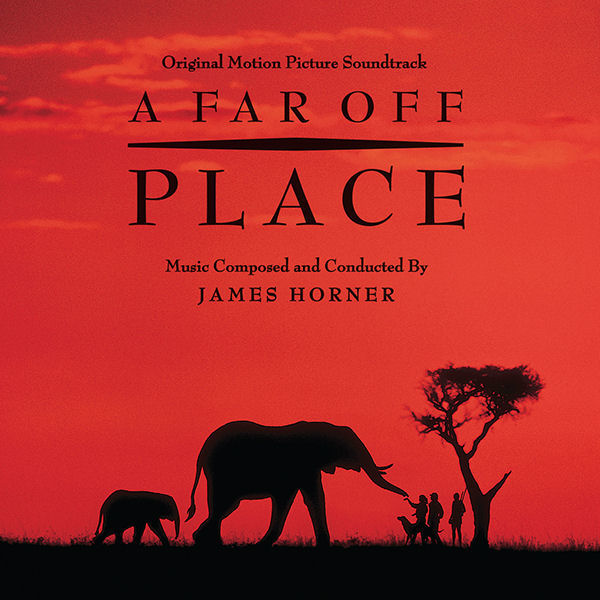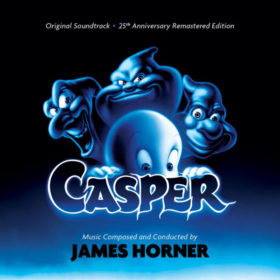ALIENS (1986)
ALIENS (1986)
Réalisateur : James Cameron
Compositeur : James Horner
Séquence décryptée : Ripley’s Rescue (1:16:20 – 1:19:55)
Éditeur : Varèse Sarabande
« Cette fois, c’est la guerre ». Sans doute plus un cri du cœur qu’un slogan mûrement posé, lorsque le service publicitaire de la Fox valide l’affiche d’Aliens de James Cameron. Si elle annonce bien le climat belliciste par lequel celui-ci entend prolonger le cauchemar d’outre-espace tourné par Ridley Scott sept ans plus tôt, l’accroche résume aussi parfaitement l’ambiance créative instaurée par le canadien sur son plateau anglais. Loin d’avoir tiré toutes ses cartouches lorsque vient le moment d’entamer une post-production réduite à moins de quatre semaines, Cameron et sa productrice ont encore quelques marrons à distribuer, et James Horner, embarqué comme rameur dans la galère d’Iron Jim, mettra dix bonnes années à en guérir les ecchymoses.
Cameron, au moment de se choisir un compositeur, n’a pas oublié celui qu’il a croisé dans les bureaux de Roger Corman. Horner, pas encore un des princes du blockbuster, mais bien décidé à le devenir, et mouillant le maillot pour accoucher d’un Battle Beyond The Stars que le film de Jimmy Murakami ne méritait pas, mais qui lui sera fort rentable puisqu’il viendra s’y servir toutes la décennie suivante. En particulier à l’occasion d’un space opera, Star Trek II: The Wrath Of Khan, qu’il reprend des mains de Jerry Goldsmith,. Son contexte spatial et l’ambiance guerrière suffisent sans doute à conforter les producteurs d’Aliens qu’il est l’homme de la situation.
Lui aussi en est d’ailleurs convaincu. Persuadé d’avoir un délai confortable de six semaines pour composer la musique du montage définitif qu’il vient découvrir à Londres, Horner se retrouve face à un film dont le tournage n’est pas terminé, et au montage évoluant sans cesse. Telle une perverse Pénélope, Cameron défait la nuit ce qu’il a fait la veille, détricotant par la même le délicat travail d’orchestration et d’ajustement qu’Horner désespère de pouvoir mener à terme. Ironie du sort pour un film reposant sur la prise en main d’une escouade de soldats par une civile seule capable de les sauver, dans la réalité, c’est Gale Ann Hurd qui est chargée d’achever Horner en lui lançant, en mots à peine plus choisis, que si lui n’est pas à la hauteur, elle s’en trouvera un qui le sera.
Est-ce ce climat de guerre ouverte qui pousse le compositeur dans ses derniers retranchements, et ne lui laisse d’autre choix que de dégraisser jusqu’à l’os ses compositions, avec une rage qui confine parfois presque à l’autodestruction ? C’est là toute la beauté d’Aliens. Horner a fait mieux dans Brainstorm ou ses deux Star Trek, mais Cameron, avec son chic pour brouiller la frontière de l’art et de la vie, ou plutôt son inconscience à risquer l’une pour transcender l’autre, a mis le musicien dans la situation des personnages. Sorti de sa zone de confort, réduit à se cramponner aux quelques idées musicales qu’il repêche dans l’urgence dans son propre travail ou celui d’autres, le compositeur n’a plus qu’à cravacher tout son orchestre avec la rage et la fureur de celui qui est forcé à le faire sans en avoir envie. Seulement soucieux d’apporter le meilleur au film, Horner demande un délai, qui lui sera évidemment refusé. Cameron n’a qu’une chose à lui répondre : plus vite. Le cinéaste ira jusqu’au bout, impitoyablement, de la relation qu’il force avec Horner en faisant de son score sa chose. Il y taille, il l’éparpille, rafistole ensemble des débris épars, allant même jusqu’à le remplacer par endroits par la musique de Goldsmith pour le film précédent.
Et pourtant, lorsque la menace que Ripley redoute et contre laquelle elle nous met en garde depuis le début éclate enfin et s’incarne dans ces silhouettes noires comme l’enfer sortant des murs pour engloutir les soldats impuissants, la musique d’Horner s’exprime avec une urgence parfaite, parce qu’elle est vécue dans le studio d’enregistrement vétuste où le compositeur se débat avec les délais et les ingénieurs dépassés pour illustrer la lutte de Ripley arrachant les commandes d’un tank qu’elle ne sait pas conduire des mains d’un commandant incompétent. Là, le compositeur s’en remet à ses outils les plus rudimentaires pour traduire l’angoisse et l’urgence : des cordes et des cuivres en boucles, qui escaladent et dégringolent les octaves, des tambours de charge militaire alignés en rythmique rectiligne, et des coups comme frappés sur des enclumes, semblant ponctuer l’action en direct, affolés par le mur de cuivres sonnant en vain l’alerte. A l’heure où Hollywood, via Platoon ou Casualties Of War, est prêt à faire résonner requiems et adagios sur les images de la guerre du Vietnam, Cameron, lui, en est toujours à faire remonter la plus viscérale des paniques, celle ressentie face à un ennemi auquel on sait ne pouvoir survivre.
C’est peut-être cette brutalité univoque et cette domination sans échappatoire qui mettra Horner mal à l’aise si durablement. Aliens ferme la page de la première partie de sa carrière, dans le sang et les larmes. Ensuite, il s’abandonnera à un lyrisme de plus en plus élégiaque, à une écriture symphonique chantournée, presque toujours maniériste même lorsqu’il doit retrouver des accents belliqueux, ceux par exemple, qui infusent les images de Mel Gibson. Et surtout, il ne travaillera plus qu’aux conditions qui seront les siennes, sur des projets choisis. Comme autant de feux purgateurs, les embrasements noirs d’Aliens ont permis à James Horner de se trouver. C’est aussi à la rescousse du compositeur qu’aura volé Ripley. L’enfer… et retour.