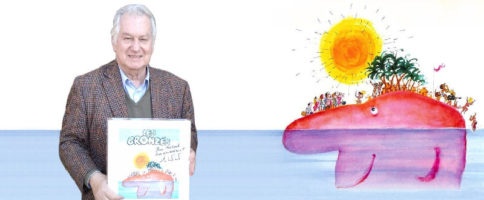LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE (1972)
Réalisateur : Yves Robert
Compositeur : Vladimir Cosma
Séquence décryptée : Babouchka (0:20:42 – 0:23:35)
Éditeur : Larghetto Music
C’est l’histoire d’un mec… ou plutôt de deux, ayant ceci de commun que des gens bien mal informés s’obstinent à les prendre pour ce qu’ils ne sont surtout pas. Le premier, François Perrin, un grand blond aux chaussures mystérieusement dépareillées, violoniste de son état et du genre à toujours vagabonder dans la lune, se trouve un beau jour épié dans ses moindres faits et gestes par les services secrets français, convaincus, allez savoir pourquoi, d’avoir affaire à un redoutable espion. L’autre, Vladimir Cosma, pour qui la musique représente également un apostolat et un gagne-pain, est un compositeur de cinéma dont on minore depuis une éternité la fantastique habileté. Sous la coupe de quelque insidieux réflexe pavlovien, public et intelligentsia critique résument ses talents sans pareil de mélodiste à des rubans gras tirés sur simple demande d’une machine à faire de la variétoche, claquemurent ses appétits artistiques dans le seul enclave de la comédie et semblent prendre un malin plaisir à confondre l’homme avec les titres variablement populaires qui émaillent sa filmographie. Le roi du gag ? C’est tout Vladimir Cosma ! La chèvre ? Il doit quand même l’être un peu, pour avoir accepté tant de pantalonnades… Le sous-doué en vacances ? Pardi, voilà le résumé parfait d’une carrière passée à trousser à la va-vite des mélodies point trop difficiles à siffloter.
L’adversité est farouche, on le voit. Mais là où le compositeur n’a jamais dû affronter, avec plus ou moins de philosophie, que des sentences à l’emporte-pièce, le Grand Blond, lui, ignore qu’il a maille à partir avec d’inquiétants hommes de l’ombre, qui investissent son appartement pour le passer au peigne fin. Tout à leur professionnalisme, mettant scrupuleusement une poupée gigogne à nu ou gardant sous scellés des échantillons de pâte dentifrice, ils n’appréhendent pas une seconde le ridicule d’aussi pointilleuses investigations. L’occasion rêvée de se payer leur fiole pour un Cosma qui, on ne va pas se leurrer, a parfois eu la main outrageusement lourde en matière de guignolades sonores. C’était compter sans l’œil bienveillant mais sévère d’Yves Robert, l’ami si cher, le réalisateur populaire grâce auquel Cosma fit au cinéma ses premières armes. Abonné lui aussi à la comédie, Yves Robert n’eut de cesse de prouver qu’un film prétendument léger n’a pas vocation irréfragable à être traité par-dessus la jambe. De ses compagnons de route, il n’attendait pas autre chose que cette badine exigence, ce fignolage couvert de tous les colifichets d’une trompeuse indolence, que le compositeur, puisant à satiété dans son sac à malices, s’évertua à élever à la hauteur des Beaux-Arts.
Vous pouvez oublier les pouêt-pouêts en cascade, éventuellement capables de dessiner un sourire facile ou deux. La surprenante flûte de pan, héroïne soliste du célébrissime Sirba, qui dissolvait d’entrée de jeu toute parenté même ébauchée entre le Grand Blond et James Bond, revient mettre son ironique grain de sel. Quidam on ne peut plus candide ou barbouzes incollables sur leur métier, tout le monde est logé à la même enseigne. Dans les escarmouches pourtant mortelles qui opposeront quelques bobines plus loin les agents de factions rivales, la musique trouvera toujours motif à rire sans arrière-pensée sarcastique, braconnant sur des terres « morriconiennes » pour mieux faire résonner la drôle de sottise de ces duels à la sauce spaghetti. En ce sens, notre fameuse scène, sise dans un chez-soi banal mais examiné à la loupe, ressemble à un tour de chauffe où le pince-sans-rire Cosma instaure un rythme soigneusement étudié, qui exsude patience et minutie. Quelque chose est là, dissimulé au fond d’une armoire, caché entre les plis d’une chemise repassée, ou glissé sous d’anodins dessous de plat, qui révélera au grand jour le double-jeu mené par le Grand Blond. Et les impassibles espions ont la ferme résolution de le découvrir.
Yves Robert, l’irréductible ! Dans le tourbillon de la comédie française déso(pi)lante, né des volcaniques pitreries des Francis Blanche, Michel Serrault et autres Darry Cowl au cours des années 60, puis perpétué par de consternants porte-drapeaux (Patrick Topaloff, les Charlots), il fut l’un des rares en croire envers et contre tout au verbe sculpté et à la geste chorégraphique. Pierre Richard, dont l’amour immodéré à l’endroit d’un burlesque désuet ne trouvait alors plus que le génial Pierre Etaix pour dernier écho, était à sa manière un anachronisme ambulant. Ces deux-là, réunis pour le meilleur, enflammèrent comme une chandelle romaine l’imagination de Cosma. La flûte au bec, presque austère dans la frugalité de son instrumentarium, le compositeur n’est pas pour rien dans l’ineffable pragmatisme duquel Le Grand Blond avec une Chaussure Noire, loufoque pourtant d’un bout à l’autre, ne se sépare jamais. Donnez à ce type un meublé seventies, une bande de limiers propres sur eux qui l’auscultent jusqu’à l’absurde, et il vous invente en fredonnant un monde décalé où le non-sens prodigue, l’air de rien, courbettes et salutations aimables.