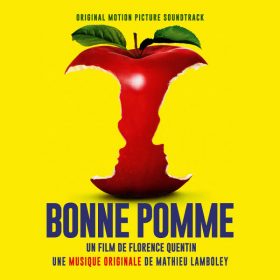Quel est ton premier souvenir musical ?
C’est mon père. Il jouait, il joue toujours d’ailleurs, de la guitare jazz. J’ai le souvenir, à Perpignan notamment, où j’ai vécu quand j’étais petit, de petits concerts de jazz qu’il faisait. Il m’emmenait sur les terrasses de cafés, sous les platanes, et j’entendais de la bossa nova, tous les standards de jazz, joués par lui et ses amis. Ça, c’est mon tout premier souvenir de musique. Après, évidemment, ça a été mes premiers cours de piano avec Yves Henry, au Conservatoire du 13ème. J’avais sept ou huit ans. Je me rappelle notamment de ma toute première méthode. Il fallait commencer par jouer des notes, do, ré, mi, fa, sol, et ensuite de différentes façons. Je trouvais ça assez amusant et ça a été très vite un plaisir pour moi, de m’amuser avec le piano.
Ce n’était pas un choix pour toi ?
Pas particulièrement au tout début. Je faisais du judo, de la musique… C’est vrai que mon père étant musicien, on m’a inscrit au Conservatoire sans que j’aie une envie particulière de faire de la musique, mais c’est venu assez vite. C’est devenu une pratique que j’ai adorée, notamment le piano. Je l’ai pris un peu comme un jeu.
Quand as-tu su que tu allais en faire un métier ?
Assez tard. Mon parcours au Conservatoire se passait très bien. J’ai fait le cursus classique, dans le sens où j’ai commencé par les Conservatoires d’arrondissement, ensuite j’ai été au CNR (Conservatoire National de Région, appelé aujourd’hui Conservatoire à Rayonnement Régional, NDLR). Vers l’âge de quinze ou seize ans, je m’amusais à écrire quelques petites pièces, comme ça, pour rire. J’ai notamment le souvenir d’une partition où j’avais écrit « grande fugue » alors que ce n’était pas du tout une fugue ! C’était juste des accords qui s’enchaînaient (rires). Bref, Yves Henry, mon excellent professeur de piano à l’époque, qui est aujourd’hui professeur d’écriture au Conservatoire de Paris, a dit à mon père que ce serait bien que je prenne des cours d’écriture. C’est lui qui a commencé, après mes cours de piano, à me familiariser avec l’harmonie classique. Ensuite, j’ai pris des cours avec Christian Bellegarde, un professeur d’écriture exceptionnel. C’est à peu près à ce moment-là que je me suis dit : « Tiens, c’est vrai que c’est quelque chose qui m’amuse, que j’adore, de composer, écrire et jouer de la musique. » J’étais au lycée traditionnel, je n’avais pas d’horaires aménagés, et je suis allé jusqu’à mon bac. J’adorais les maths et la physique et j’hésitais vraiment : « Est-ce que tu veux faire une prépa ou de la musique ? » En fait, c’est à l’âge de dix-sept ans, j’étais au lycée, on avait cours de maths et je m’ennuyais un peu. On était tous derrière les tables et je me suis dit : « Est-ce que tu te revois l’année prochaine, être encore pendant deux ans derrière une table à faire des exos de math ? Non, non ! Je préfère être derrière ma table mais à écrire des notes de musique, et derrière mon piano. » Ça a été un peu un déclencheur. J’ai donc dit à mes parents que, voilà, l’année prochaine, je ferai de la musique. Étant très ouverts, ils m’ont dit : « OK, très bien. Passe le Conservatoire, si tu l’as, c’est très bien. Sinon, on verra après. »
Y a-t-il une œuvre musicale qui a changé ta vie à ce moment-là, qui confirmé ton choix ?
Oui, plusieurs, j’ai envie de dire. J’avais vraiment des affinités avec le répertoire de la musique française. Mon professeur me donnait évidemment beaucoup de musique romantique classique, mais c’est vrai que les Children’s Corner ou les Arabesques de Debussy, ou la musique de Ravel un peu plus tard, sont des œuvres dont j’étais vraiment fan. Il y avait aussi les concertos de Prokofiev. Je passais mes nuits à relire les partitions, bien qu’à l’époque je n’avais pas le niveau pour jouer des concertos, c’est venu plus tard. J’étais vraiment fan de tout le répertoire classique, c’est essentiellement cette musique-là qui m’a donné envie d’écrire.
Te souviens-tu de ta première composition ?
Mise à part la « grande fugue » dont je parlais tout à l’heure… Les toutes premières compositions, je devais avoir quatorze ou quinze ans, c’est mon père d’ailleurs qui m’avait dit : « Ça serait bien que tu fasses un album de piano » et je trouvais l’idée super. J’avais donc enregistré du Satie et des œuvres qui étaient dans une esthétique très musique française. J’avais appelé ces pièces des « songes », il y en avait une douzaine. Par la suite, j’ai écrit pour des amis du Conservatoire, un quatuor à cordes, une sonate de violon-piano… C’est cette sonate-là d’ailleurs qui m’a permis de rentrer à la Sacem parce qu’à l’époque, il fallait attester d’une œuvre qui avait été jouée. Voilà, ce sont là les premières compositions. Ensuite, il y a eu le théâtre musical, les musiques de film. Les premières étaient plus des musiques de concert.
Ton instrument a toujours été le piano ?
Ça l’a toujours été, effectivement. J’ai commencé par le piano, je poursuis avec le piano. J’ai essayé de jouer un peu de guitare, je sais faire quelques accords mais bon, pour bien jouer d’un instrument il faut y passer du temps. Je préfère passer du temps à me perfectionner au piano plutôt que de travailler un autre instrument.
Avant que tu ne t’orientes vers la musique de film, y en a-t-il une qui t’as marqué ?
C’est très banal de dire ça, les musiques de Star Wars, cette époque-là, toutes les musiques de Williams pour les films de Spielberg… C’est tout un répertoire que j’adore, pas une œuvre en particulier. Au cinéma, dès qu’il y avait une musique symphonique, ça faisait écho en moi puisque c’était très proche de la musique classique.
Ta décision d’aller vers la musique de film s’est faite comment ?
C’est vraiment un hasard. J’écrivais des pièces de théâtre musical et des chansons pendant mes études au conservatoire et j’ai vu une petite annonce à la cafétéria du CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, NDLR) d’un étudiant en Arts Déco qui cherchait un compositeur pour son film, et je me suis dit : « Tiens, pourquoi pas ? C’est quelque chose qui a l’air sympathique » et le film avait l’air bien. J’ai rencontré le réalisateur, Étienne Chaillou, et ça été tout de suite une source d’inspiration pour moi. Quand j’écrivais des musiques de théâtre, j’avais un support qui était le texte ou des paroles pour des chansons, quand j’écrivais des pièces de concert j’avais toujours une source d’inspiration qui pouvait être des poèmes ou une histoire. Ici en l’occurrence, c’était un film d’animation donc l’image est venue après, mais tout l’univers du réalisateur m’a inspiré. Je n’y avais pas vraiment particulièrement pensé et ça s’est enchaîné après. J’ai fait la musique de son premier court, on a eu des prix, notamment à Aubagne. Ensuite, j’ai fait pas mal de musiques de documentaires, rencontré d’autres personnes et puis voilà, j’ai un peu atterri, entre guillemets, par hasard là-dedans, mais je n’étais pas particulièrement prédestiné à écrire de la musique pour le cinéma. J’aurais pu continuer à écrire de la musique de concert ou autre… Pour moi, de toute façon, à partir du moment où l’on compose de la musique, je pense qu’on peut le faire un peu dans tous les domaines.
Tu n’écris plus de musique de concert ?
En ce moment, avec tous les projets de films qu’on me propose, j’ai du mal à trouver du temps, mais dès que j’ai quelques semaines de libre, je me remets à composer « librement ». Là, par exemple, j’ai un projet de pièce de piano seul. C’est aussi intéressant ne pas avoir de contraintes car dans ce cas-là, on explore d’autres choses. C’est quelque chose que j’ai envie de garder, mais pour ça, il faut du temps.
Quand tu travailles sur un film, y a-t-il une étape du processus que tu aimes particulièrement ?
Pour moi, toutes les étapes sont passionnantes, à différents niveaux. La première étape, quand on a la chance d’être très en amont sur un projet, quand on connaît le réalisateur et qu’il nous en fait part même sans scénario, c’est déjà inspirant puisqu’il va nous raconter une histoire et il y a tout de suite un imaginaire musical qui vient. C’est une étape très créative. Ensuite, avec le scénario, on compose sans contrainte de temps et de forme, par rapport à l’image. L’étape de travail à l’image est également passionnante puisqu’on va beaucoup plus dans le détail, on cisèle vraiment la forme, et l’image nous amène aussi à faire des ajustements par rapport à nos premières idées. L’étape suivante, c’est-à-dire affiner son orchestration, est aussi passionnante parce qu’on est dans quelque chose de beaucoup plus technique, un peu comme un cuisinier qui va s’amuser à rajouter des épices. L’enregistrement est passionnant également. C’est autre chose, il y a une relation humaine qui s’installe avec les musiciens, avec les ingénieurs du son. On commence à concrétiser ce qu’on avait dans la tête. L’étape de montage est aussi passionnante, même si un peu fastidieuse, c’est un peu comme de la construction, on choisit telle prise parce qu’elle est excellente… Ensuite, le mixage, c’est pareil… Il n’y a pas une seule étape que j’ai envie de mettre de côté. Peut-être celle du montage parce qu’on y passe du temps, et encore. Chaque étape est intéressante.
Comment analyserais-tu le fonctionnement de ton inspiration ?
Je dirais que pour moi, c’est une histoire de choix. Quand on doit écrire quelque chose, il y a plein d’idées qui viennent dans la tête, et l’inspiration c’est des choix qu’on doit faire à chaque seconde. Il y a quelque chose qui vient, en référence à notre vécu, à ce qu’on a entendu, à notre sensibilité, et ensuite il y a le choix de se dire : « Attends, est-ce que ça, c’est bien ? » C’est sans arrêt faire le choix de renoncer à certaines choses : « Non, ce n’est pas si bien que ça », hop, il y a une autre idée qui vient. Ensuite, on se dit : « Ah, tiens, cette idée. Non, pas celle-là. » On avance comme ça. Ce sont des choix permanents, et ce qui est dur, c’est de refuser certaines choses. Parfois, on est dans le doute, on se questionne soi-même : « Est-ce que tu es vraiment sûr que là, c’est la bonne forme, la bonne harmonie ? » C’est sans arrêt des questions comme ça. Après, il y a aussi une phase où on peut improviser librement et laisser la musique couler et ça marche très bien aussi, mais je trouve que c’est aussi intéressant de se remettre en question, et de travailler dans ce sens-là. C’est un ajustement entre l’inspiration et la réflexion, disons, du bon choix musical qui correspond à ce qu’on veut… Je le traduis comme ça.
Cela t’arrive de travailler très en amont, à partir du script ou même du pitch ?
Oui, de plus en plus d’ailleurs. C’est un plaisir car on a vraiment le temps de mûrir le style musical, les thèmes… Généralement, c’est ce qui se passe : on rencontre un réalisateur, il nous parle de son film, soit il évoque le pitch, soit il donne le scénario, auquel cas on le lit et on discute avec lui, on lui propose des choses. Là, j’ai un réalisateur dont je vais peut-être faire le prochain film, et il m’a envoyé un poème. Je lui ai demandé le scénario et il m’a répondu : « Non, non, je ne te donne pas le scénario. Je t’envoie un poème et on voit ce que ça donne. » Je trouve ça génial. C’est vraiment la base de l’art, voir ce que ce poème va évoquer pour moi et comment je vais le transcrire en musique sans lire le scénario.
Quelle est pour toi l’émotion la plus difficile à transcrire musicalement ?
Ah ! Oh, là, là… Eh bien, j’ai envie de dire, la non-émotion ! Parce que la musique provoque, procure des sensations. D’ailleurs, l’émotion ne se traduit pas exactement de la même façon chez untel ou untel. Un sentiment amoureux pour nous va peut-être évoquer plutôt quelque chose de paisible chez quelqu’un d’autre. C’est donc compliqué de cibler exactement l’émotion qu’on veut traduire mais, pour moi, être neutre, c’est dur.
L’orchestre, c’est important pour toi ?
C’est important dans la mesure où c’est mon héritage culturel et de formation. La formation symphonique est exceptionnelle puisqu’elle permet d’explorer plein de choses, dans les couleurs… Si l’orchestre existe encore aujourd’hui c’est qu’on a trouvé là le bon compromis de couleurs et d’équilibre dans tous les instruments acoustiques « classiques ». Après, je pense qu’il ne faut pas réduire l’écriture de la musique à une écriture symphonique, surtout de nos jours. Il faut réussir à intégrer des sonorités actuelles, parce que la musique est le reflet de notre temps. Une musique purement symphonique peut être très innovante, mais disons qu’au cinéma c’est tout de même plus compliqué d’aller rechercher des choses, notamment dans la recherche très contemporaine, qu’elle soit tonale ou atonale, car la musique ne fonctionne pas forcément tout le temps avec ces images. On a tout de même un cadre stylistique qui est donné par le réalisateur, et aussi par les références que les gens ont par rapport à la musique. Je pense donc que l’innovation se fait aussi dans la couleur, dans la recherche de timbres, qu’ils soient acoustiques ou électroniques.
Tu as travaillé comme orchestrateur pendant un temps. C’était avant d’avoir ton premier film ?
C’était un peu en parallèle. Pendant que je commençais à faire mes premières armes sur des courts métrages et des films documentaires, je travaillais notamment avec Grégoire Hetzel, avec qui j’ai beaucoup appris. J’ai notamment appris à ne pas dormir de nombreuses nuits d’affilée avant l’enregistrement ! (rires) C’était très intéressant, mais je ne voulais pas continuer longtemps comme orchestrateur. J’aspirais à autre chose, à écrire ma propre musique, mais ça a été une collaboration très enrichissante.
Le meilleur souvenir de ton début de carrière au cinéma ?
Il y en a plein. Souvent, ce sont des moments de vie, des moments d’enregistrement avec des orchestres. J’ai le souvenir de l’enregistrement d’une chanson pour Toute Première Fois où l’on enregistrait la nuit aux Studio La Frette, il y avait une atmosphère… Ce sont aussi des moments de création, on est dans le studio, on se prend la tête sur un accord… Les moments agréables arrivent souvent pendant les enregistrements parce qu’on concrétise tout ce à quoi on a réfléchi tout seul durant des mois. La création peut se faire parfois dans la douleur… En fait, j’ai souvent une phase au début, quelques jours où je me prends la tête littéralement (rires), j’ai la tête entre les mains et j’angoisse en me disant : « Non mais, attends, ça, ce n’est pas bien ! » Après il y a un déclic et ça devient très fluide, c’est un moment très agréable. Ça file, on est dans un état d’euphorie, dans la création.
Et le pire souvenir ?
Ha ! Le pire souvenir… Non, il n’y a pas eu de projet compliqué, mais souvent c’est quand on sort d’une session d’enregistrement et qu’on se rend compte qu’il va falloir passer beaucoup de temps à faire du montage pour donner au film, au producteur et au réalisateur, un résultat qui soit à la hauteur des espérances. Là, on passe beaucoup de nuits en studio pour monter parfois à la note près et ça, c’est un peu fastidieux. Parce l’orchestre, parce qu’on est exigeant avec soi-même et qu’on fait en sorte d’arriver à un bon résultat. Ce ne sont pas vraiment des pires souvenirs mais ce sont des souvenirs fatigants. Je ne suis pas le seul d’ailleurs, avec mon équipe, mon monteur musique Clément Cornuau, on passe parfois beaucoup de temps à rattraper des choses qu’on a laissé passer.
As-tu une méthode de travail particulière avec les réalisateurs ?
Pour moi il n’y a pas de méthode puisque chaque personne est différente. Le métier de compositeur de musique de film, c’est aussi un métier de traducteur. Il faut savoir comprendre le langage du réalisateur. S’il nous dit qu’il veut que ce soit « plus bleu » ou « plus rouge », qu’est-ce qu’il entend par là ? Le comprendre, c’est passer du temps à écouter des choses avec lui. Il y a des réalisateurs qui sont très intellectuels, il va donc falloir utiliser un langage qui soit le leur, adopter un point de vue plus conceptuel par rapport à la musique. D’autres sont plus portés sur l’affect et le sensoriel et avec lesquels il va simplement falloir se mettre au piano et leur jouer des choses, et ils vont me dire : « Ah oui, c’est ça. » Tout dépend du réalisateur et du film, il n’y a pas de règle. C’est ça qui est intéressant, d’ailleurs. À chaque fois, avec de nouveaux réalisateurs, on découvre de nouvelles façons de travailler, de nouvelles personnes, des affinités différentes… C’est enrichissant.
Est-ce qu’il y a un genre dans lequel tu voudrais t’essayer ?
C’est vrai que j’ai commencé avec les musiques de comédie. Là, je travaille un peu plus sur des films qui ont du sens, des films d’auteur, des films sociaux ou même des films romantiques. Un style que je n’ai pas trop exploré c’est le thriller ou des films un peu plus sombres et là, musicalement, il y a plein de choses à faire. Si on me le propose, j’accepterai avec plaisir. Même des grands films romantiques, avec des thèmes à n’en plus finir, c’est pareil, ça me plairait beaucoup.
Toute Première Fois, c’était ton premier long ?
Non, c’est Libre et assoupi (en 2014, NDLR). Je me suis retrouvé à travailler avec Benjamin Guedj car il y avait eu un appel d’offre que Gaumont organisait, une sorte de petit concours sur des scènes. On était sept ou huit compositeurs, je crois. Chacun avait un pseudonyme, moi, j’étais Batman. J’en rigole maintenant, je mets des photos déguisé en Batman ! (rires) Blague à part, c’était à l’aveugle et Benjamin a accroché sur le thème que j’ai composé et ça a commencé comme ça. Toute Première Fois, c’était la même chose, un concours en aveugle. Là, il y avait moins de plages orchestrales, le film se voulait un peu plus pop dans son esthétique. Les réalisateurs, Noémie Saglio et Maxime Govare, m’ont demandé d’écrire des chansons, c’est quelque chose que je fais aussi par ailleurs, sur des textes de Lise Meyer, la chanteuse du film, qui chante très bien et qui écrit de très beaux textes. Voilà pour mes deux premiers films, d’autres ont suivi, beaucoup de comédies.
Tu n’as pas eu peur d’être catalogué comme compositeur de comédies ?
Quand tu commences à faire une comédie et qu’on aime bien ce que tu fais, on te propose un autre projet, c’est une comédie, et tu acceptes évidemment. Et puis, la plupart du temps, ce sont quand même de grosses productions donc on ne va pas refuser. J’ai l’impression que c’est un peu comme pour les acteurs, on peut facilement nous mettre vite dans des cases. À partir du moment où j’ai fait cinq ou six comédies, eh bien, Mathieu, c’est un compositeur de comédies. Or, à la base, j’écris de la musique de concert, je n’écris pas que des musiques de comédies ! (rire) Là, depuis un an, je fais un peu le choix de privilégier certains projets. Ça ne veut pas dire que je mets de côté la comédie, au contraire, j’adore écrire pour ça, mais disons que j’ai envie de me diversifier, montrer que je peux faire d’autres choses. Avec Minuscule 2, Sœurs d’Armes ou L’Autre Continent ou récemment le film d’Emmanuel Carrère (Le Quai de Ouistreham), je diversifie au maximum pour montrer les différentes facettes de mon écriture.
La comédie, on peut l’aborder au premier degré, ou en contrepoint, à fond dans le drame…
Complètement. Quand on fait une musique de comédie, il ne faut pas forcément faire du mickey mousing et mettre en avant toutes les blagues qui se font, il faut essayer d’avoir une écriture plus intelligente que ça. Mais d’une certaine façon, sur les films que j’ai fait, c’était compliqué de mettre une musique de thriller ou d’action. Il y a quand même un cadre stylistique, des choses qui fonctionnent pour la comédie. C’est pour ça que changer d’esthétique, de style de films, permet de varier les styles dans la musique.
Dans Un Petit Boulot, il y a un côté un peu thriller…
Effectivement, il y a un côté pop un peu dark, mais là, le film appelait à ça, cette histoire décalée de ce soi-disant tueur à gages. On avait cette petite couleur-là qui était géniale à composer.
Pour Boule et Bill 2, on est très au premier degré, c’est presque un score de cartoon…
Pour le coup, premier degré à fond ! C’est d’ailleurs Boule et Bill 2 qui m’a permis de faire Minuscule 2. Thomas Szabo avait entendu parler de moi, il a écouté la musique de Boule et Bill 2 et il s’est dit qu’il y avait un côté cartoon, film d’animation, et c’est ce qui l’a séduit et m’a permis de faire le film avec lui.
Pour ces suites, as-tu été amené à tenir compte des scores précédents ?
Non, pas particulièrement. Sur Boule et Bill 2, pas du tout. Sur Minuscule 2, Thomas, au premier rendez-vous, voulait qu’il y ait les mêmes thèmes. La musique du premier Minuscule (par Hervé Lavandier, NDLR) est très belle, mais je n’avais pas forcément envie de reprendre des thèmes, faire des arrangements. J’ai commencé à lui expliquer que c’était intéressant de retrouver l’univers, disons, mais pas les thèmes. J’avais envie de donner ma propre patte. Au fur et à mesure, je lui ai proposé des thèmes et il a tout de suite accroché. Mais dans l’esthétique, on est assez similaires, avec Hervé. Une musique orchestrale très imagée. Je pense qu’on retrouve ça dans Minuscule 2.
L’écriture thématique, c’est important pour toi ? C’est un élément indispensable ?
Oui, j’adore écrire des mélodies. Après, je ne fais pas que ça non plus. Dans le cas des films qu’on cite, c’est vrai que les réalisateurs adorent la mélodie. Notamment Minuscule 2, qui est une sorte de poème symphonique, avec différents thèmes et styles musicaux pour chaque insecte. Il fallait forcément qu’on puisse mettre en musique chaque personnage et cela se fait au travers de lignes mélodiques et de styles musicaux. Je trouve ça assez évident, mais bon… Moi, j’aime bien qu’il y ait des thèmes sur les films. Ça caractérise quand même assez fortement un film. Quand on sort d’un film, qu’on entend le générique et qu’on retient la mélodie, c’est plaisant. Et c’est souvent ce que demandent les réalisateurs, tout du moins ceux avec qui je travaille. On va dans le même sens, c’est pour ça que ça fonctionne avec eux.
Le Retour du Héros est très référentiel, on pense même aux westerns de Morricone…
Morricone, alors ça, évidemment ! Je vais être très humble par rapport à ça, l’idée du western ne vient pas de moi, mais de Laurent Tirard, le réalisateur. Il m’a envoyé le scénario et m’a demandé : « Alors, qu’est-ce que ça t’inspire ? » Honnêtement, je voyais moi évidemment une musique orchestrale, mais lui son envie était qu’il y ait une couleur western, il pensait que ça pouvait être intéressant. Évidemment, on pense à Ennio Morricone. Je lui ai proposé des thèmes, différents, il en a choisi un. Et au bout d’un moment je me suis dit que je n’allais pas faire du Morricone pendant tout le film. Et là, l’idée m’est venue de mélanger ça avec une touche baroque, qui était cohérente d’une certaine façon puisque c’est un film d’époque. Bon, on n’est pas à proprement parler dans la période baroque, mais il s’y trouve des parallèles avec l’harmonie de Morricone avec des accords de trois sons, des enchaînements harmoniques qu’on trouve dans la musique baroque. J’ai pu faire le pont entre ces deux styles, comme des variations dans l’esthétique de Bach mais avec des touches western avec des guitares. Je voulais apporter cette petite touche d’innovation, faire un mélange plutôt que du sous-Morricone. C’est en ça que je me suis amusé. C’était une sorte de cuisine, entre le style Bach et le style Morricone. On a enregistré avec un vrai clavecin. C’était indispensable, le clavecin est présent dans tout le film. Il apporte de la vie, c’était un peu le squelette de la partition.
Dans Minuscule 2, on ressent ton amour pour de grands maîtres comme Ravel. Comment gères-tu ces influences ? Où places-tu ton curseur entre hommage et copie ?
Au début effectivement, il y a une forte inspiration de Daphnis et Chloé. En l’occurrence, Ravel pour moi c’était évident, je voulais commencer ce film comme avec une musique Ravel. Le curseur, il vient avec tes références. Ensuite, tu composes et comme tu connais tes références, tu sais que tu ne dois pas faire la même chose, les mêmes enchaînements harmoniques par exemple. Tu apportes une petite touche de modernité qui te permet de montrer que la musique est de maintenant. En fait, dans la musique de film, c’est compliqué parce qu’on nous en demande, des références. De toute façon, la musique de film fait sans arrêt appel à des références. Pour tous les compositeurs, quand tu écoutes plein de B.O., tu entends tout de suite les références, jusqu’à Williams. Mais on ne s’en cache pas.
Je mets vraiment les compositeurs du répertoire au-dessus, je suis en admiration. Après, on se les approprie à notre manière et on développe notre propre style à travers ça. Le style vient de l’héritage. Quand on écoute les premiers Beethoven on reconnaît Haydn… Tous les compositeurs ont forcément leurs pères qui sont là. Il faut essayer de passer au-delà de ça, ne pas rester dans une esthétique. J’adore Debussy et Ravel, mais il ne faut pas rester dans une musique impressionniste et essayer d’amener sa propre touche là-dedans. Je pense que c’est ça aussi, le chemin de l’évolution et de la maturité. Au début on fait un peu à la manière de, on façonne. Plus son compose, plus on arrive à des enchaînements harmoniques, des accords qu’on aime bien. Là, on développe son propre style. Comme par exemple le mode de Fa chez Williams, on le reconnaît tout de suite, c’est l’empreinte de Williams. Il adore cet enchaînement-là et l’a marqué un temps. Ravel, ça va être plus la modalité, le mode de Ré, des choses comme ça. Au bout d’un moment, notre héritage, on l’intègre et ça va ressortir, parce qu’on aime bien cet enchaînement-là… Moi, ça peut être Fauré, aussi. J’ai beaucoup de références à Fauré, à la musique modale.
Peux-tu nous parler de ton dernier film en date, Sœurs d’Armes ?
C’était une collaboration très enrichissante aussi avec Caroline Fourest. Dans le film, il y a deux thèmes. Il y a beaucoup de musique, à peu près une heure. Tout découle de la chanson finale, qui est le thème principal, je voulais mettre en musique le combat de ces femmes avec leurs voix, au sens propre. C’est la première fois que je fais la musique d’un film de guerre, il y a quelques séquences très action, mais ce n’est pas ce qui caractérise le film. Caroline voulait une musique qui soit au contraire très dans l’émotion.
Le mot qui m’est venu en l’écoutant, c’est élégiaque.
C’est ça. Élégiaque. Très ouvert, très généreux. J’ai adoré composer, il y a des arias avec des chanteuses lyriques, plusieurs morceaux comme ça. Le thème principal, celui de la libération, le thème des femmes. Dans l’architecture du film, il y a cette aria de l’insouciance avec la voix lyrique au début, et cette voix lyrique ne revient qu’à la fin seulement, quand elles sont libérées. Il y a une structure dans la composition qui était très claire pour moi. Tout le reste du film, avec des scènes de violence, d’action, tu as un thème, que j’appelle le thème de Daesh, qui joue sur des chromatismes, des motifs de tension. C’était un peu un mélange de tension, de douleur sous-jacente et aussi cet espoir, d’une certaine façon.
Y a-t-il une partition parmi celles que tu as écrites pour le cinéma dont tu es particulièrement fier ?
Oui, Minuscule 2. J’y ai mis beaucoup d’énergie et je suis allé vraiment dans le détail de l’écriture donc, c’est vrai que je suis assez fier de cette partition. C’est un peu un condensé de tout mon héritage classique, et j’ai aussi cherché à pousser l’écriture dans un style et des harmonies un peu plus riches que sur d’autres films. Ensuite, il y a pas mal de partitions que j’apprécie mais c’est toujours compliqué de s’auto-satisfaire de ce qu’on a. Il y a toujours des petites choses qu’on a envie d’améliorer. Il faut rester exigeant face à soi-même, se dire : « Ça c’était bien, et maintenant qu’est-ce que je peux faire ? » Toujours aller de l’avant.
Entretien réalisé le 11 novembre 2019 à La Baule par Olivier Desbrosses
Transcription : Milio Latimier
Illustrations : © DR
Remerciements à à Sam Bobino et à toute l’équipe du Festival Cinéma et Musique de Film de La Baule.