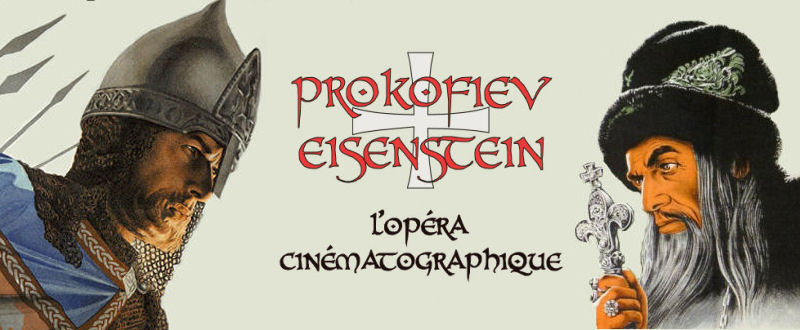ALEXANDRE NEVSKI
La cantate d’Alexandre Nevski (Opus 78), réarrangée en 1938 par Prokofiev, se divise en sept parties. Sa durée d’exécution est d’environ 37 minutes.
01 La Russie sous le Joug Mongol
02 Le Chant sur Alexandre Nevski
03 Les Croisés dans Pskov
04 Aux Armes, Peuple Russe !
05 La Bataille sur la Glace
06 Le Chant de la Mort (Adagio)
07 L’Entrée d’Alexandre Nevski à Pskov
|
Direction : Samuel Samossoud |
Direction : Evgueni Svetlanov |
Il existe une multitude de versions différentes de la cantate. Dans les versions russes, on trouve en premier lieu celle de Samuel Samossoud, exécutée en 1947 avec le chœur et l’Orchestre Symphonique de la Radio d’URSS. Malgré son ancienneté, cet enregistrement possède un charme indéniable qui se rapproche assez de la musique originale entendue dans le film. L’orchestre est rutilant, et la mezzo-soprano Ludmilla Legostayeva délivre une interprétation très émouvante du Chant de la Mort. Le disque vynil édité par Le Chant du Monde reste difficile à trouver, mais il existe néanmoins une version CD éditée par Arlecchino, The Art Of Samuil Samosud : Volume 1, comprenant également la Symphonie n°7 de Prokofiev. A réserver toutefois aux amateurs avertis, vu la qualité monophonique assez médiocre.
Pour une captation sonore de meilleure qualité, on pourra se reporter sur l’enregistrement de 1962 d’Evgueni Svetlanov avec l’Orchestre National d’URSS, qui fait preuve d’une belle vigueur, notamment l’ensemble choral Yourlov très expressif. La cantate culmine magnifiquement avec l’interprétation du Chant de la Mort par la mezzo-soprano Larissa Avdeeva, aux intonations slaves à souhait. En supplément, le CD édité par Le Chant du Monde comprend d’autres pièces de Prokofiev comme Le Chant de Joie et surtout Sept, Ils Sont Sept, musique d’une audace extrême dirigée par le chef Guennadi Rojdestvenski. Comparativement, la version russe de Valeri Gergiev dirigée en 2002 bénéficie d’une prise de son mieux équilibrée et de meilleure qualité, mais elle n’égale pas dans son interprétation cette version de Svetlanov qui dégage davantage de charme et de ferveur. Fortement conseillé !
|
Direction : Karel Ancerl |
Dans les anciennes versions enregistrées à l’étranger, il existe plusieurs disques assez convaincants (mais pas non plus indispensables) comme celui de Thomas Schipers en 1962, avec le New York Philharmonic et le Westminster Choir (CBS) : une version très vivante et énergique mais un peu trop rapide. On trouve aussi une version live enregistrée en 1970 en stéréo par Leopold Stokowski à la tête de l’orchestre du Southwest German Radio Symphony (Music & Arts). Stokowski fut le premier chef à avoir dirigé en 1943 la cantate aux Etats-Unis, mais cette version historique n’a pas été commercialisée. Il existe également une interprétation toute en finesse de 1962 par Karel Ancerl et l’Orchestre Philharmonique de Tchécoslovaquie qui comprend une belle version du Chant de la Mort par la mezzo-soprano Vera Soukoupova. La seule critique que l’on pourrait émettre sur l’enregistrement serait dans la prise de son un peu terne qui restitue assez médiocrement le dynamisme de la musique.
|
Direction : Eugene Ormandy |
Direction : André Prévin |
Dans les enregistrements plus récents qui bénéficient notamment d’une meilleure restitution sonore de l’orchestre, on peut trouver quelques disques de référence. En particulier, la version enregistrée en 1975 par Eugène Ormandy à la tête du Philadelphia Orchestra, qui s’impose clairement comme l’une des plus spectaculaires : interprétation grandiose et virulente avec un rendu sonore très clair des différents pupitres de l’orchestre, réalisé par l’ingénieur Paul Goodman. Sur Le Chant de la Mort, certaines réserves cependant dans l’interprétation de la mezzo-soprano Betty Allen qui a parfois tendance à « meugler » sur les syllabes. On peut y préférer le timbre de voix plus doux d’Anna Reynolds dans la version dirigée par André Prévin en 1972 avec l’Orchestre de Londres. Néanmoins, il s’agit là d’un enregistrement exemplaire, vivement conseillé !
En comparaison, la version d’André Prévin souffre d’une prise de son un peu moins étincelante qui manque de relief. Le timbre des bois et des percussions est par exemple beaucoup moins bien restitué. En 1986, Prévin dirigera une seconde version de meilleure qualité sonore avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles, mais cet enregistrement possède un peu moins d’ampleur, en particulier au niveau du chœur, moins affirmé et bouillonnant que celui du London Symphony.
|
Direction : Riccardo Chailly |
Direction : Claudio Abbado |
Direction : Neeme Järvi |
Pour les amateurs de voix plus graves, on trouve une majestueuse interprétation du Chant de la Mort par la mezzo-soprano Irina Arkhipova dans la version de Riccardo Chailly, enregistrée en 1983. Chailly trouve le tempo juste, ni trop lent ni trop rapide, et délivre avec l’Orchestre de Cleveland une performance de grande envergure. Une autre version également de haut niveau est celle dirigé en 1980 par Claudio Abbado avec l’Orchestre Symphonique de Londres. L’enregistrement bénéficie d’une qualité de son exemplaire qui met particulièrement bien en valeur la puissance expressive du chœur londonien. Sur La Bataille sur la Glace, le tempo musical est par contre assez frénétique et l’ensemble manque un peu de respiration, notamment sur le thème héroïque des cavaliers russes où on a l’impression qu’Abbado est pressé d’en finir ! L’ensemble du morceau fait seulement douze minutes tandis que les versions de Prévin, Järvi et Chailly vont au delà des treize…
Le chef Neeme Jarvï a également enregistré en 1987 une version discographique de très bonne facture qui bénéficie d’une belle direction vocale du chœur de l’Orchestre National d’Ecosse. Pour la curiosité, on trouve aussi une version d’excellente tenue, expressive et dynamique, enregistrée en 1972 par Fritz Reiner, à la tête de l’orchestre de Chicago (RCA). Mais elle est chantée en anglais…
|
Direction : Youri Termikanov |
Direction : Frank Strobel |
D’autres chefs ont exécuté la partition d’origine écrite pour le film, ce qui permet de retrouver certains passages musicaux non inclus dans la cantate, dans une version orchestrale plus dépouillée et transparente proche de l’originale. Enregistrée en 1993, la version russe de Youri Termikanov à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg en donne un très bon aperçu. La prise de son ample met particulièrement bien en valeur la vivacité du chœur. On y entend en particulier la lugubre messe, accompagnée à l’orgue, que les chevaliers teutons viennent servir avant de pénétrer sur la terre russe et quelques courtes séquences extraites de La Bataille sur la Glace, comme la scène de la noyade des soldats allemands dans le lac gelé. Sur ce passage, un crescendo particulièrement efficace d’accord dans les cordes a été ajouté par l’orchestrateur Bill Brown qui s’est permis quelques libertés avec la partition originale. Une version hautement recommandée !
On trouve aussi une version plus récente enregistrée par Frank Strobel en 2003, à la tête du Rundfunk Sinfonieorchester de Berlin. Une édition de bonne facture, dotée d’une clarté de son impeccable mais qui possède un peu plus de raideur et moins d’implication dramatique que la version de Termikanov. Ceci étant dû en partie au fait que Strobel a réduit l’effectif choral et orchestral pour être le plus fidèle possible à la partition de Prokofiev, originellement exécutée par un petit orchestre de studio.
Ivan le Terrible
En 1948, à la mort d’Eisenstein, Prokofiev décide d’arrêter de travailler pour le cinéma. Sa partition d’Ivan le Terrible disparait dans un tiroir, tout comme l’idée qu’il avait développée avec Eisenstein de faire un opéra sur le même sujet. Prokofiev ne pouvait se décider à sauver sa musique en la transformant en cantate, comme il l’avait déjà fait pour Alexandre Nevski. En 1961, neuf ans après sa mort, c’est le chef d’orchestre Abraham Stassevitch (1906-1971), qui avait déjà dirigé l’orchestre sur la bande sonore du film, qui réalise cette adaptation pour le 70e anniversaire de la naissance du compositeur. Ivan le Terrible devient ainsi un oratorio (Opus 116) pour récitant, solistes, chœur et orchestre qui englobe les principales séquences du film. L’œuvre est découpée en vingt séquences principales dont quelques-unes sont divisées en deux parties. La durée d’exécution est d’environ 75 minutes.
| 01 Ouverture 02 Marche du Jeune Ivan 03 La Mer Océane 04 « Je serai Tsar » 05 « Dieu est Grand » 06 « Longue Vie à notre Tsar » 07 La Mer Océane (Reprise) 08 « Longue Vie à notre Tsar » (Reprise) 09 Le Fou de Dieu 10 Le Cygne 11 Hymne (« Sur la Colline se dressent les Chênes ») 12 Le Cygne (Reprise) 13 Sur les Cadavres des Ennemis |
14 Les Tatars 15 Les Canonniers 16 À Kazan 17 Ivan supplie les boyards 18 La Steppe Tatare 19 Euphrosinia et Anastasia 20 Chanson du Castor 21 Ivan devant le Tombeau d’Anastasia 22 Chœur des Opritchniks 23 Serments des Opritchniks 24 Chanson de Fédor Basmanov avec les Opritchniks 25 Danse des Opritchniks 26 Finale |
Stassevitch a également inclus des morceaux qui ne figurent pas dans le film, en particulier Le Serment des Opritchniks et La Mer Océane. Peut-être pour accentuer l’impact dramatique du film, il a volontairement omis la fougueuse Polonaise, qui ne figure pas dans l’oratorio. La séquence paroxystique du meurtre dans la cathédrale est quand à elle raccourcie. En revanche la partie musicale du siège de Kazan est beaucoup plus développée que dans le film, en particulier lors du formidable final de l’attaque, qui fait ressurgir les principaux motifs sous forme de « copiés-collés », un peu à la manière de La Bataille sur la Glace dans la cantate Alexandre Nevski.
|
Direction : Abraham Stassevitch |
Direction : Abraham Stassevitch |
Il existe une version discographique de 1961 éditée par Le Chant du Monde qui permet d’entendre la direction d’Abraham Stassevitch à la tête de l’Orchestre Symphonique d’URSS et des Chœurs de Moscou (chef de choeur, V. Sokolov). Le CD est constitué de larges extraits de la musique du film, sans la voix du narrateur, et malgré l’ancienneté de l’enregistrement, la prise de son retranscrit assez soigneusement le timbre des voix et des instruments, en particulier les cordes, d’une belle couleur vibrante, sur le morceau Ivan supplie les boyards. Vivement conseillé ! Une version de concert avec narrateur (Alexander Estrin), également dirigée par Stassevitch, a été éditée par Melodiya/Angel, mais n’existe seulement qu’en vynil.
|
Direction : Riccardo Muti |
La version de l’oratorio de Stassevitch se retrouve également sur l’enregistrement réalisé en 1978 par Riccardo Muti à la tête du Philharmonia Orchestra. Le chef italien en donne une interprétation solide et énergique, même si le chœur Ambrosian a parfois tendance à être un peu trop virulent et mécanique. Une autre version, plus russe, a été exécutée en 1984 par Alipi Naydenov, qui dirige l’Orchestre Philharmonique de Russie accompagné par le choeur mixte Dounavski Vulni. (Forlane Records). Mais il s’agit là d’une captation de concert et la prise de son est beaucoup plus étouffée. Une nouvelle transposition de l’oratorio, revue par Michael Lankester en 1987, avec une narration en anglais, a été également enregistrée en 1991 par Mstislav Rostropovitch à la tête de l’Orchestre Symphonique de Londres (Sony Classical), mais la version se révèle un peu trop bavarde et l’interprétation moyennement convaincante.
Ce que l’on pourrait sans doute reprocher à la version avec narrateur, c’est qu’elle couvre en partie les séquences musicales. Stassevitch ayant utilisé un grand nombre de petits épisodes musicaux, a eut en effet besoin d’un récitant pour joindre tous les fragments et rendre l’ensemble de la pièce plus fluide. Si en version de concert, la voix du narrateur ajoute à l’œuvre une dimension épique indéniable, l’écoute sur CD peut se révéler un peu plus laborieuse.
|
Direction : Neeme Järvi |
Direction : Valeri Gergiev |
Pour mieux mettre en valeur la composition de Prokofiev, Christopher Palmer a fait un deuxième arrangement de l’œuvre en 1975, supprimant la voix du récitant et réorganisant l’oratorio en treize longs mouvements. Un certain nombre d’épisodes sont replacés dans leur cadre original et Palmer ajoute le morceau de La Polonaise qui n’avait pas été utilisé par Stassevitch. La séquence du meurtre dans la cathédrale est également beaucoup plus développée. En revanche, certaines parties chorales plus liturgiques ont été omises, ainsi que l’étonnante pièce du Serment des Opritchniks, ce qui est fort dommage ! On trouve une interprétation de cette version dans l’enregistrement que Neeme Järvi dirigea en 1991.
L’enregistrement de Valeri Gergiev exécuté en 1996 avec l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam peut se voir comme un assez bon compromis entre la version russe d’origine et celle de Christopher Palmer : Gergiev conserve la forme originale de la version de Stassevitch en gardant les thèmes liturgiques mais supprime la voix du récitant et ajoute le thème de la Polonaise. Le tempo musical est généralement plus lent que sur la version de Neeme Järvi, mais semble mieux adapté au rythme de la musique. L’orchestre et le chœur dégagent une énergie exaltée que restitue bien la prise de son. Vivement recommandé !
|
Direction : Vladimir Fedosseyev |
Direction : Valeri Polyanski |
Comme pour Alexandre Nevski, on trouve également des versions discographiques intégrales qui présentent la musique du film originale en intégrant les chants chorals liturgiques. En 1998, le chef Vladimir Fedosseyev inaugure la première mondiale en dirigeant l’Orchestre Symphonique Tchaïkovski. La reconstitution de la bande-son est effectuée à partir des manuscrits autographes déposés au musée Glinka et aux archives d’Etat, publiés par Sikorski à Hambourg en 1997. L’enregistrement met particulièrement bien en valeur la dynamique des percussions et des voix enregistrées très prés du micro ; on y trouve en particulier une belle interprétation de l’Air des Jouvenceaux par le chœur d’enfant Vesna. Le chœur de la Yurlov Capella est quand à lui, particulièrement éclatant et très expressif. L’orchestre est un peu raide, mais néanmoins très vivace sur les parties rythmiques. Le seul petit défaut de cet enregistrement passionnant est qu’il ne comprend pas de livret et une notice explicative (très intéressante néanmoins) écrite en anglais.
En comparaison, la version enregistrée par Chandos en 2003 par Valeri Polyanski possède un peu moins d’éclat et de virulence, en particulier au niveau du chœur, un peu plus mécanique. Néanmoins, la prise de son restitue clairement les coloris et le timbre des instruments de l’orchestre. Chandos a également eu l’heureuse initiative de publier un livret présentant tous les textes des chansons et traduit en français. L’enregistrement comprend en prime la cantate pour soliste, choeur et orchestre La Ballade du Garçon resté Inconnu, écrite en 1944.