 |
Les compositeurs ont-ils moins de liberté au cinéma qu’à la TV ? C’est que Barr semble confirmer ici, alignant beaucoup plus de lieux communs que dans ses très réussis True Blood et Hemlock Grove. Ici, et malgré quelques bonnes idées trop éparses pour marquer, on doit se contente le plus souvent d’une ambiance assez peu remarquable.
 |
 |
Alors qu’on attend toujours une édition officielle de la partition originale de JNH, cette suite se contente d’une approche clinique qui, malgré des aspects électro qui font parfois mouche (lors des expériences notamment), s’avère d’autant plus tiédasse qu’elle n’est même pas rehaussée par une compensation émotionnelle. Le handicap est grand.
 |
 |
Pour évoquer l’expérience interdite, Barr s’appuie sur une électronique directement influencée par Reznor et Daft Punk, sans jamais se départir complètement de son sens mélodique si séduisant. Un album qui touche au but, et dégage le parfum fort et entêtant qu’on imagine tourner la tête de ceux que la conquête de l’ultime tabou obsèdent.
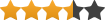 |
 |
Il y a de très jolis passages, donnant une impression de flottement (cordes, voix, harpe), et la tension est réalisée par un mélange de pulsations électroniques (un peu rétro) et de sons acoustiques triturés. Le résultat est efficace et crée une ambiance étrange, mais il manque une mélodie forte pour donner un supplément d’âme.
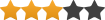 |
 |
Il s’agit du remake du film de 1990. Et là, bien sûr, on est obligé de comparer. Et pour la musique, ça fait très très mal. Passer après la partition de James Newton Howard, c’est dur. Très dur. Barr essaie et s’emploie, se démène même. Mais rien à faire. Encéphalogramme plat.
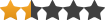 |
 FLATLINERS (2017)
FLATLINERS (2017)
 FLATLINERS (2017)
FLATLINERS (2017)