 LES RIVIÈRES POURPRES 2 : LES ANGES DE L’APOCALYPSE (2004)
LES RIVIÈRES POURPRES 2 : LES ANGES DE L’APOCALYPSE (2004)
Compositeur : Colin Towns
Durée : 72:01 | 19 pistes
Éditeur : Milan Records
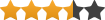
Il y a déjà beau temps que Luc Besson a fini par baisser pavillon, laissant d’aucuns, zélateurs et contempteurs tout ensemble, croupir dans l’expectative — que faire, s’affliger de la déconfiture de sa société, EuropaCorp, dernier bastion français du divertissement à « grand » spectacle, ou sabler au contraire le champagne ? À son apogée, le cinéaste constamment en pré-retraite conduisait ses boys à la baguette, manufacturant quantité de « bessonneries » le plus souvent ineffables, avec un certain penchant pour les numéros de série (Taxi bien sûr, Le Transporteur…). Quoique sans lien initial avec la maison-mère, la franchise des Rivières Pourpres y échoua cependant sous l’impulsion de son producteur Alain Goldman, en panne sèche quant au traitement à réserver à la suite attendue (?) du carton de Mathieu Kassovitz. Fallait-il que l’inspiration stagnât à un point tragiquement bas, pour ainsi abandonner les rênes à Besson ! S’établissant scénariste par-dessus le marché, le fieffé gredin bricola une histoire dépourvue de vertèbre, à l’égal d’un mollusque, vague prétexte à exploiter le filon déjà moribond du millénarisme peu ou prou mystique. Qu’un os aussi maigre ait été jeté en pâture à l’équipe du film explique bien des choses, à commencer par la grenaille de plomb qui pèse invinciblement sur les paupières de Jean Reno et de ses partenaires, ou les guenilles de série Z qui fagotent un budget pourtant assez cossu. Colin Towns, pour sa part, ne s’en formalisa pas, trop heureux sans doute de fausser même brièvement compagnie à la petite lucarne, son terrain de jeu de toujours. En outre, quand un compositeur compte à son palmarès un objet dévoré par l’éléphantiasis comme Rawhead Rex, le voici en théorie prêt à affronter sans blêmir les besognes ingrates que d’aucuns refuseraient avec d’éloquents froncements de nez.
Et dans cette catégorie redoutable entre toutes, Les Rivières Pourpres 2 n’a de leçon à recevoir de personne ! Pour la possession d’un antique artefact dont le film se contrefiche de tirer un substrat quelconque, flics de choc et Yamakasi en robes de bure se castagnent joyeusement, dans les boyaux d’une usine désaffectée, au fin fond de la ligne Maginot livrée aux herbes folles, et jusque sous les yeux ahuris de l’honorable clientèle du supermarché du bas de la rue. À un film qui raconte n’importe quoi n’importe comment, Towns rétorque sur un premier degré emphatique, de bout en bout hanté par la lugubrité. N’ayez pas une pensée pour la liturgie grégorienne qu’il eût été de bon ton d’accorder à de paisibles bénédictins ! Quelques esquilles vocales, timide échantillonnage, surnagent bien en de rares endroits, mais semble-t-il grattées d’une psalmodie infernale, au sein de laquelle les encapuchonnés pleins de ressort puisent un surplus de mystère. Saturé d’épaisses stries par les cordes, comme l’est d’un mortier purpurin une photographie témoignant un empressement coupable à flagorner le titre du film, l’anachronisme (volontaire ou non, jamais nous ne le saurons) des abbayes surgies de brumes moyenâgeuses trouve là un robuste pilier de soutènement. Cependant que l’enquête progresse à coups de deus ex machina providentiels, une monotonie quelque peu plombante finit néanmoins par croître, faute pour le compositeur d’avoir pu sarcler de cette encre noire autre chose que la répétitivité de ses climats. Au moins peut-il se flatter d’une gravité à l’épreuve des pires embûches, incluant l’errance nocturne, sur fond d’ostinato têtu de piano et de froissements électroniques, d’un Christ frauduleux, que des flics, après l’avoir renversé, saluent d’un déso(pi)lant : « Eh, Jésus, faut rester dans les clous ! »
Pour conjurer cette pétrification digne du sépulcre, il existe pourtant un détonateur. Colin Towns le presse vigoureusement dès que les frocards sans visage se jettent en pirouettant aux quatre coins du cadre. Et si, dans les nappes atmosphériques vouées tout entières à une théologie spongieuse, le spectre de l’avant-gardisme du XXème siècle laissait à l’occasion flotter les algues mortes de ses bras, cette fois, il monopolise la scène en un écho strident aux échauffourées voltigeantes. Exit le minimalisme feutré qu’imposa non sans audace Bruno Coulais pour le premier volet, place désormais à des foudres d’artillerie dont l’impact évoque, certes rétrécies aux dimensions d’humbles miniatures, les étouffantes masses agglomérées par Penderecki ou l’onde dévastatrice des Jonchaies de Iannis Xenakis. Circonscrit au seul organigramme du cinéma, un patronage si violemment dissonant fait de Towns l’un des rares héritiers des mémorables Matrix de Don Davis, autour desquels avait flotté, un temps hélas trop court, le parfum du renouveau. Une course-poursuite conçue à la manière d’un gymkhana pédestre vomit tout particulièrement les enfers. Le mystérieux piano précité remet ça en préambule, mais son pouls s’emballe très vite sous l’aiguillon des hordes de cuivres trépignant à sa suite. Même les flûtes, synonyme parfois d’opportunes respirations quand les partitions symphoniques s’en vont en guerre, ne se préoccupent nullement d’amadouer les esprits, jetant à l’inverse dans la cohue leurs sifflements venimeux. Gris et tavelé, assez peu fringant faut-il l’admettre, mais vêtu de sa dignité de toujours, ainsi que du vague embryon d’un motif ténébreux écrit par Colin Towns en quatrième vitesse, Christopher Lee assiste in fine à la débâcle de ses moines fous et de son projet, diabolique à coup sûr, mais pas des plus limpides. À en juger par ses regards vitreux, ce méchant d’opérette pataugeait lui aussi.














