 RAWHEAD REX (1986)
RAWHEAD REX (1986)
RAWHEAD REX, LE MONSTRE DE LA LANDE
Compositeur : Colin Towns
Durée : 56:31 | 15 pistes
Éditeur : Silva Screen Records
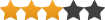
Naguère, en quelque royaume terrible et païen enseveli sous la poussière des siècles, il fut le dieu rouge et l’ogre dévoreur d’enfants dont l’ombre colossale enténèbre les contes de fées. Aujourd’hui, embourbé jusqu’au cou dans la bauge de la série B qui s’avoue Z à mots à peine couverts, il n’est plus qu’un objet de railleries pour les gourmets accoutumés à l’entêtant fumet du cinéma d’horreur au petit pied. Difficile de conserver son flegme, en effet, devant cet ahurissant faciès qu’un abus de latex plisse et gondole, sans même parler de ce strabisme plutôt violent, qui laisse peser de sérieux doutes quant à l’éventuelle intelligence du monstre. La gestuelle de celui-ci, digne d’un catcheur furibard, et son accoutrement, moins pourpre royale que cuir lacéré dont aimaient à se harnacher les marlous des clinquantes eighties, achèvent d’éparpiller sa dignité aux quatre vents. Rawhead Rex, l’infortuné ! Surgi du ventre de la terre, et des pages de Clive Barker par la même occasion, seulement pour grossir l’armée titubante des croque-mitaines obnubilés par leur body count… Mais qui sait ? La musique pourrait réussir à sauver les meubles, songe un instant le béophile plein d’espoir — espoir d’autant plus fort que ladite musique porte la signature de Colin Towns, l’auteur de l’envoûtant Full Circle (Le Cercle Infernal).
A toiser d’un œil goguenard le look inexplicablement punk de la créature, l’on se souvient soudain que Towns, avant de conduire une carrière certes discrète mais pas mal fournie pour les grands et petits écrans, avait tâté du clavier au sein de Gillan, éphémère groupe chapeauté par le plus illustre gourou de Deep Purple. Tout bien considéré, quitte à ce que le film joue si ostensiblement la carte de l’anachronisme vestimentaire, le compositeur aurait peut-être gagné à lui emboîter le pas en ressuscitant loin de toute demi-molle son passé de rocker. Bernique, il préfère se blottir contre le gras d’une épouvante très premier degré, témoin le thème du géant bigleux, moucheté d’un zeste d’avant-gardisme que les pesantes scansions des cuivres réduisent en charpie. A défaut de s’avérer inventive, la méthode garantit au Rex bafoué un peu de l’imposante efficacité qu’une réalisation au trente-sixième dessous s’évertue à lui refuser. Attention malgré tout à ne point se méprendre : ce Rawhead Rex Main Theme aux crocs dénudés n’apparaît pas exactement comme une inviolable note d’intention. Si l’orchestre londonien, réquisitionné pour dresser en l’honneur du titan une haie infernale, dévoile d’emblée un exemplaire tour de biceps, il se fait par la suite beaucoup plus discret. Car les synthés chéris de Towns sont là, qui partout s’immiscent en agitant leurs longues vrilles de glace.
Las ! Ces sons électroniques-ci, au lieu d’invoquer le fantôme de Full Circle où ils adornaient un piano dont Erik Satie lui-même n’eût pas conspué la beauté limpide, se vautrent dans l’ambient anesthésiant des années 80. Confrontée au méli-mélo mythologique d’un script infichu de zigzaguer entre christianisme salvateur, paganisme barbare et idole celte, la musique se borne au strict minimum et soulève un banc de brume suffisamment opaque pour qu’on n’y puisse discerner aucune velléité dramatique. La nouvelle de Barker était une histoire de foi, comme avait cru s’en apercevoir le lecteur entre deux démembrements écarlates, le film ne cherche pas à être autre chose qu’un slasher bêta, sans même le petit supplément d’âme qu’un Colin Towns démissionnaire renonce trop tôt à tenter de lui pourvoir. L’Irlande où se déchaîne Rawhead fait cependant office de lot de consolation, ses appas sereins exaltés par des bois champêtres, sylvestres pourrait-on dire lors de leur essor le plus majestueux, et une harpe vibrante d’émotion. Assurément, l’abrupt contraste qu’enfantent la verte Erin et les carnages imbibés du monstre vedette n’est pas le plus insipide atout d’une partition sans cela passablement palimpseste.
Jusqu’au bout, le marasme de l’horreur caoutchouteuse règne en tyran sur Rawhead Rex. Un cimetière est le décor du combat décisif, noyé sous une cataracte de vortex bleutés qu’une main malhabile a dessinés à même l’écran, et une madone apparue par le miracle naïf d’antédiluviennes transparences expédie l’affreux gargantua six pieds sous terre. Une simple statuette de terre cuite, à l’effigie d’une femme au ventre renflé, devient l’instrument de sa perdition, tandis que Towns adopte pour arme fatale l’ostinato, celui d’une clarinette stressée notamment, ou du piano. Quelques rots de tuba représentent à peu près tout ce qu’un Rawhead pétrifié est encore capable d’opposer comme résistance, avant que, dans une résurgence dernière de son thème trapu, le sol sous ses pieds ne l’engloutisse à nouveau. Pour de bon, cette fois ? Est-il possible d’être aussi candide, cher lecteur ! En guise de point final, le bestiau vénère, qui louche toujours autant, jaillit de son tombeau, de toute évidence disposé comme jamais à répandre mort, destruction et rires gras. Miséricorde divine, cette suite promise resta claquemurée dans les limbes. Aurait-on prié sinon Towns de rempiler ? C’eût été permis d’y voir, suivant l’inclination de chacun, une forme de justice, puisqu’il fut au milieu des cancres ayant sabordé le texte original le seul à mettre un tant soit peu de cœur à l’ouvrage, ou bien un châtiment retors pour s’être ainsi compromis avec la lie des adaptations de pellicule d’un des plus novateurs ayatollahs du fantastique moderne.















