 TEXAS, ADDIO (1966)
TEXAS, ADDIO (1966)
TEXAS ADIOS
Compositeur : Antón García Abril
Durée : 62:01 | 27 pistes
Éditeur : Quartet Records
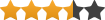
An de grâce 1966 — Cinecittà est au faîte de son rayonnement populaire. Pour à peu près toute l’industrie transalpine, le western était devenu la grande affaire. Sergio Leone et le cigarillo de l’Homme sans Nom étaient évidemment passés par là, brassant les dollars dans leur sillage comme autant de feuilles mortes au vent d’automne. Juste derrière, appâtés par ces merveilleux tourbillons de billets, des masses fourmillantes de clones taiseux et mal rasés jouaient du Colt avec une dextérité des plus variables. Le chef de cette meute dépenaillée fut sans la moindre conteste Django, spectre vengeur tirant dans un Ouest tourbeux le cercueil où dort son instrument de mort fétiche. Sous les bords du chapeau fatigué, étincèlent les yeux bleus du tout jeune Franco Nero, qui, sans le savoir, avait rencontré là le personnage-torpille grâce auquel les vantaux du vedettariat s’ouvriraient pour lui béants. Suivant à la lettre l’adage assertant qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud, la star fraichement consacrée s’en revint derechef au western all’italiana, avec, la même année que Django, deux autres films couronnés à leur tour d’un franc succès. Le bien nommé Tempo di Massacro (Le Temps du Massacre) donnait à Lucio Fulci l’occasion d’exhiber sans fard les penchants sadiques qui sacreraient, une décennie plus loin, sa putride renommée. Et puis il y eut pour compléter ce brelan d’as Texas, Addio.
A l’instar de ses frères de pellicule, ce dernier mise autant sur le noir que sur le rouge, embrassant comme il se doit à bouche que veux-tu les nouveaux mais déjà tout-puissants stéréotypes imposés par Leone, tout en observant à leur égard la réserve prudente de celui qui entend cultiver malgré l’émulation tous azimuts un brin d’originalité. Il en va d’identique façon pour la musique d’Antón García Abril, où répondent à l’appel les instruments charnières de l’Ouest latin (trompette au hiératisme « voyant » et guitare électrique prompte à s’enflammer, en tout premier lieu), mais mouchetés d’une tendresse sous-jacente, qu’on devine rétive à donner libre cours à la violence. Le générique fait montre à ce titre d’une belle éloquence, qui superpose à une fusillade conduite au pas de course une chanson emplie de mélancolie. L’Américain Don Powell, dont le gros de la carrière se fit dans les studios italiens, soupire et murmure en évoquant une enfance brisée, et un homme incapable de dresser quelque distinguo que ce soit entre l’amour et la haine. Les turpitudes œdipiennes du scénario font déjà plus que s’esquisser, même si García Abril préfère cacher encore un peu son jeu. Ainsi, après que le shérif ait rendu la justice sans verser la moindre goutte de sang, la ville lui fait un triomphe avec tout ce qui lui passe entre les mains : cor anglais, flûte, xylophone, clavecin — un instrumentarium touffu, mais qui se refuse à arguer de la joyeuse ribouldingue pour sacrifier la finesse de ses nombreux timbres. Pour un peu, on s’attendrait à voir surgir Walter Brennan ou tout autre second couteau truculent du western hollywoodien.
Evidemment, ce leurre ne dure guère. Le shérif, qui n’est autre que Franco Nero, a d’autres chats à fouetter, en l’occurrence un très ancien compte qu’il est grand temps de solder. Les obstacles sur sa route seront légion, et les cadavres tomberont cette fois en abondance. Rarement pourtant la musique se départira-t-elle d’une singulière douceur, comme si, à contre-courant de l’ire vengeresse, elle espérait apaiser les esprits par sa seule beauté. Aucun haut-le-cœur musical n’accompagne le trajet bringuebalant d’un chariot où s’entassent des malheureuses condamnées à l’esclavage, nulle révolte prêchée tout à coup par l’orchestre ; rien qu’un chœur masculin sobre et triste. Dans l’hacienda du Vil Propriétaire Terrien (incarnation du mal pour des nuées de westerns), il n’y a qu’un solo de guitare perdu dans une languissante rêverie pour témoigner un zeste de compassion aux trois pauvres bougres enchaînés. Un bref instant seulement, lorsque ceux-ci hurlent de douleur sous le fer rouge qui les marque comme du vulgaire bétail, la gratte délicate s’intensifie-t-elle en un paroxysme d’effroi. Peu après, le redoutable tyran, trônant seul devant son orgue, épanche d’insondables états d’âme sur le clavier. Il ne jaillit pourtant pas de la forêt dentelée des tuyaux l’enfer gothique que l’on eût volontiers imaginé, mais un friselis de mélodie, presque éthéré, au creux duquel se nichent à l’évidence des fêlures secrètes.
De quoi instiller l’amorce d’un doute dans le regard minéral de Nero ? Les atermoiements ne sont pas exactement la tasse de thé du vindicatif shérif. Le thème principal, qui est un peu son ombre, aura beau passer par bien des états contrits, depuis un banjo broyant du noir jusqu’au cor anglais élevant sa note plaintive à la mort de son jeune frère, jamais notre héros ne doutera du bien-fondé de sa quête. Cette dernière, comme de juste, va de pair avec le fracas des pétoires et le vacarme des chevauchées ventre à terre, source d’embardées endiablées dont les tambours martiaux, les coups sonores de cymbale et la guitare qui cravache telle une dératée arborent le plus ouvertement le génome « morriconien ». Antón García Abril traite avec aisance ces passages presque obligés, mais ça n’est pas pour leur bénéfice premier que son inspiration s’émeut. L’épicentre de ses ardeurs musicales gravite tout entier auprès de cette silhouette indomptable, obnubilée par la vengeance, qui renoncera à ses idéaux de justice et perdra sa dernière famille pour rompre l’échine de l’homme qu’elle tient responsable de tous ses maux. Pareille approche (mélo)dramatique, presque incongrue au sein d’un genre affamé de baroque et de trognes crasseuses, explique peut-être l’apport étroit de son auteur (à peine une demi-dizaine de partitions) au western all’italiana. Elle ne saurait en revanche justifier l’abîme discographique aux confins duquel errent, odieusement invisibles, les kyrielles de musiques écrites par le regretté compositeur espagnol pour le cinéma. Parce qu’il a été sauvé du gouffre, Texas, Addio, émouvant, ciselé, allergique à l’épate, gagne là une raison supplémentaire pour qu’on l’honore d’une oreille charmée.












