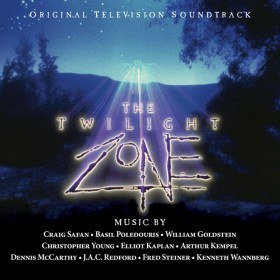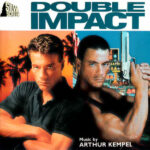 DOUBLE IMPACT (1991)
DOUBLE IMPACT (1991)
DOUBLE IMPACT
Compositeur : Arthur Kempel
Durée : 40:31 | 12 pistes
Éditeur : Silva Screen Records

Pléthoriques furent les inconditionnels du cinéma de Hong Kong, il y a quelque trente ans de cela, à condamner dans leur dépit Jean-Claude Van Damme aux gémonies infernales. Pourquoi diable fallait-il que le gotha de la péninsule enchantée, auquel l’approche à grands pas de la rétrocession donnait d’incoercibles envies de changer d’air, tombât systématiquement entre les griffes du pugiliste d’outre-Quiévrain ? L’ailleurs hollywoodien et ses chimères dorées semblaient au prix de cette forme on ne peut plus retorse de bizutage… Suspecter le Belge sémillant d’instincts calculateurs et cyniques serait faire fausse route. Derrière l’image adipeuse de « the Muscles from Brussels » subsiste toujours une ombre attendrissante, celle d’un gamin pétri d’enthousiasme, qui rêvait d’inscrire un jour son nom au fronton de marbre blanc de la Mecque du cinéma, là où les hommes et les femmes se dépouillent de leur enveloppe mortelle pour vivre à jamais. Mû tout autant par ces nobles espérances que par une admiration sans borne, Van Damme présida donc aux grandes migrations cantonaises en incarnant, en guise de hors-d’œuvre un tantinet frelaté, un ersatz de Chow Yun-Fat affublé d’un étourdissant mulet dans Hard Target (Chasse à l’Homme). Mais, deux ans avant de laisser John Woo s’enliser dans les fondrières de la Louisiane, l’acteur avait d’une certaine façon préparé son public occidental à l’outrance unique au monde du cinéma hongkongais. Tourné pour une large part dans le Port aux parfums, Double Impact ménage entre autres une scène d’infiltration nocturne où le héros, dédoublé et inaugurant le motif typiquement « vandammien » des jumeaux à couteaux tirés, met à sac un atelier de drogue clandestin. Il bondit, effectue pirouettes et galipettes, trouant la peau de ses adversaires avec un flingue dans chaque main, tandis qu’une ligne électronique nécessiteuse, qui s’étiole au contact d’un suspense de quat’sous avant de trépider besogneusement en simulacre d’action, s’ingénie coûte que coûte à donner le change.
Évidemment, tout n’est que duperie et contrefaçon. Il a beau amasser à l’envi les ralentis, le mercenaire de la pellicule Sheldon Lettich claudique à cent lieues de la maestria de Woo ; et la violence, frileuse, trouve son content dans des standards dont les noms petits et grands de l’enclave ont coutume de se fiche comme de colin-tampon. A contrario, les synthés loqueteux témoignent de la même incurie que leurs homologues orientaux, accoutumés à être la cinquième roue du char. Jeff Rona, faisant là une éphémère infidélité au jeune studio Media Ventures, maquignonne sans états d’âme, comme si une prémonition ayant valeur d’or lui intimait de vite remballer ses logiciels pour regagner le bunker depuis lequel Hans Zimmer conquerrait le monde. Du reste, son apport n’est que denrée négligeable — un vulgaire capiton rembourrant, très gauche, l’orchestre volontiers furibond d’Arthur Kempel. Entre productions de quinzième zone et shows cathodiques défilant comme sur un tapis automatisé, le curriculum vitae de ce dernier est à l’opposé de brosser le portrait d’un compositeur vedette que le tout-Hollywood s’arracherait. Ceci étant, on pourrait à maints égards en dire autant de son prédécesseur, John Scott, qui, échoué allez savoir comment au générique de Lionheart (Full Contact), collaboration liminaire entre Lettich et JCVD, gratifia l’anonyme série B d’une ample musique gorgée de noblesse. Et il convient de rendre cette justice à Kempel que lui aussi se garda de prendre le job par-dessus la jambe. À travers des influences revendiquées sans ambages, un autre artiste tout-terrain, pour le coup gravé au pinacle de la légende, fait irrésistiblement surface. Comment ne pas penser à la prodigieuse orgie d’action de Rambo: First Blood Part II (Rambo 2 : la Mission) et Total Recall, lorsque Kempel inonde les mésaventures du gentil Jean-Claude et du Van Damme guère commode de cuivres survitaminés ? Non pas qu’il étrennât ici ses galons d’épigone numéro un de Jerry Goldsmith — il s’en eut fallu de beaucoup ! Mais combien il est doux, parfois, de se remémorer ces heures évanouies où le géant californien, par sa seule aura, exhortait des phalanges entières de ses confrères à régler leurs pas vaille que vaille sur les siens.
Sans doute un thème pivot fait-il défaut à Kempel. L’absence d’un essieu solide, graissé de belliqueuses harmonies et de maints développements embellis d’étincelles, contraint le compositeur à rester sur un peu passionnant quant-à-soi chaque fois que les jumeaux mal assortis se languissent de gueules patibulaires à bosseler. Pour conjurer l’ennui qui couve, les voici s’improvisant Don Juan de basse-cour ; l’occasion d’une agréable coulée de romantisme, semblable à un baume apaisant au milieu des plages de suspense mécaniquement égrenées. Le hautbois et le cor anglais devisent, échangent de séduisantes amabilités, et même, chemin faisant, bifurquent incidemment vers l’apologie émue des liens du sang… jusqu’à ce que les inénarrables mimiques de Bolo Yeung ne nous ramènent manu militari aux affaires sérieuses ! Avec son œil vitreux qui fait d’autant plus fulgurer le valide, le colosse de Hong Kong réduit à lui seul en pièces l’aimable dépaysement qui parfois sourd de la musique, en une réminiscence subsidiaire mais pas à négliger des partitions « asiatiques » de Goldsmith — encore lui. Une fois venu le moment fatidique pour Van Damme et son ennemi herculéen de tomber le tee-shirt, les synthés sans aucun élan, statufiés par les conventions des années 80 qui n’avaient pas dit leur dernier mot, n’essayent pas une seconde d’entretenir l’illusion d’une empoignade entre demi-dieux. Ils s’étaient pourtant montrés plus friands d’imprévu quelques bobines auparavant, lors d’une poursuite menée à toutes jambes où les spasmes électroniques cédaient peu à peu du terrain à des cuivres musclés. Ce crescendo habilement conçu est le clou d’une partition en droit de s’enorgueillir d’en asséner quelques-uns ; assez, à dire vrai, pour s’octroyer un strapontin tout à fait potable dans la discographie 90’s plus riche qu’il n’y paraît du karatéka butor.