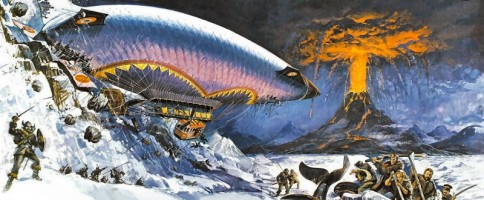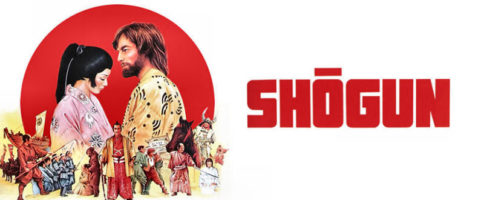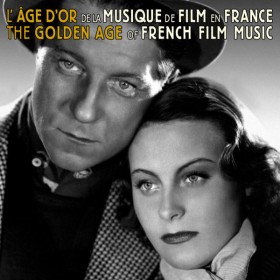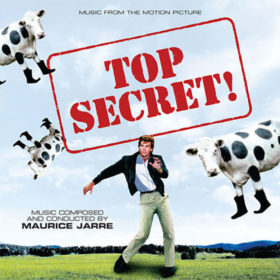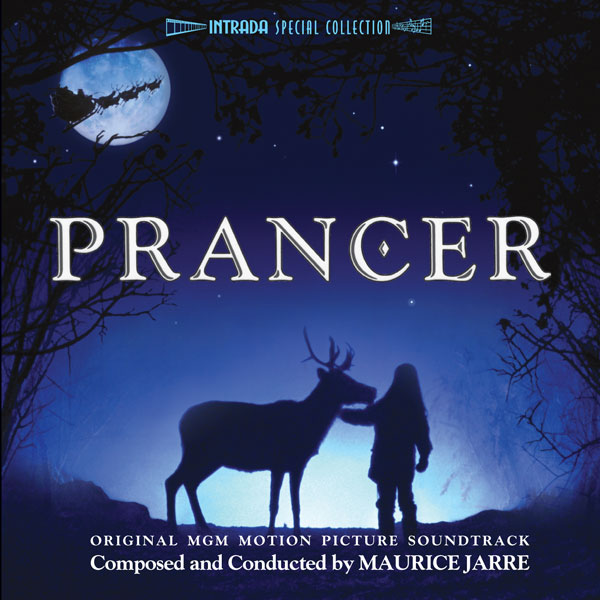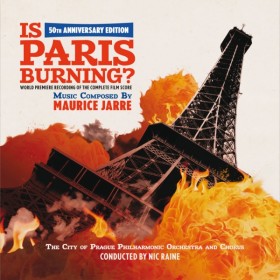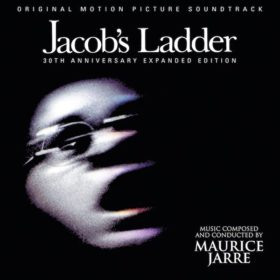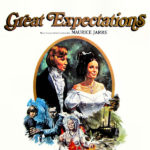 GREAT EXPECTATIONS (1974)
GREAT EXPECTATIONS (1974)
DE GRANDES ESPÉRANCES
Compositeur : Maurice Jarre
Durée : 38:10 | 12 pistes
Éditeur : Pye Records (LP)

Un drame réalisé par Joseph Hardy (adapté d’un musical dont on a supprimé les chansons). Abonné qu’il était aux productions anglaises les plus luxueuses, il était forcément inévitable que Maurice Jarre vienne à travailler sur une adaptation de Dickens et, si ce téléfilm au casting prestigieux (Michael York, Sarah Miles, James Mason, Robert Morley, Margaret Leighton et Anthony Quayle) n’est pas forcément resté dans les mémoires, sa partition mérite d’être redécouverte. Jarre croisait aussi sur ce projet l’ombre de David Lean, ce dernier ayant réalisé une brillante adaptation du roman en 1946 (la musique en avait été composée par Walter Goehr). Le compositeur s’est sans doute trouvé des affinités avec l’auteur d’Oliver Twist, dont le style mêle le goût du romanesque à une mordante ironie. Particulièrement inspiré par ce roman initiatique, à la fois fable morale et satire sociale, il livre une partition qui ignore les conventions poussiéreuses de ce genre d’adaptations de grands classiques et opte pour une approche résolument personnelle par laquelle il explore et exploite le large éventail émotionnel du récit qu’il transforme en un étonnant voyage musical.
Sa musique fonctionne à différents niveaux de lecture : classiquement, d’une part, il associe des leitmotivs à la galerie de personnages dickensiens. Mais à cette variété thématique s’ajoute une approche instrumentale qui oppose des timbres et des sonorités contrastés associés aux différentes strates sociales dans lesquelles évolue le héros, Pip, qui sont aussi autant de compartiments (dont certains refoulés) de sa conscience. L’aspect le plus lumineux et le plus léger caractérise les thèmes qui lui sont associés tour à tour dans l’innocence de l’enfance (On The Way To Satis House, à l’écriture rythmique complexe et joueuse) et dans l’insouciant élan de la jeunesse (Pip Esquire). Ces pistes, dans lesquelles les instruments à vent entonnent des mélodies rapides d’une évanescente légèreté, connaissent cependant leur envers dans cet univers musical de l’ombre et des fantômes qui hantent une inquiétante demeure délabrée, ou les contrées brumeuses où se joue aussi son histoire. Les mélodies de boîte à musique qui retentissent dans le manoir de Miss Havisham sont des valses sentimentales à la beauté flétrie interprétées sur des pianos désaccordés, ou encore par les gémissements d’outre-tombe des ondes Martenot. Le clavecin qui les accompagne est loin des menuets enjoués du dehors, associés à la superficielle vie en société (Dance Card).
Dans les pistes les plus sombres, le compositeur se livre à des expériences acoustiques qui font se croiser des fragments thématiques fantomatiques dans les brumes d’une dissonante réverbération. Mais c’est dans les passages associés à la figure inquiétante et mystérieuse de Magwitch, que la musique devient la plus sinistre : ce thème est une variation sur le Dies Irae et, dans ces pistes, le compositeur a recours aux fracas violents d’un piano préparé. Le thème principal, enfin, est une grande valse en mineur qui englobe ces différents principes musicaux dans son tournoiement vertigineux, comme le reflet de la griserie du monde qui s’empare de Pip et de la vanité de son oubli du temps qui passe, inexorablement.