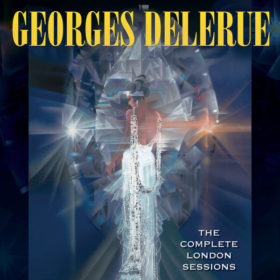WOMEN IN LOVE (1969)
WOMEN IN LOVE (1969)
LOVE
Compositeur : Georges Delerue
Durée : 47:37 | 22 pistes
Éditeur : Quartet Records

Les nombreux détracteurs de Ken Russell n’y ont peut-être vu qu’une énième roublardise, mue davantage par sa proverbiale inclination à la controverse que par une franchise virginale. La vérité est que le rejeton terrible du cinéma britannique ne faisait rien d’autre que mettre ses tripes et son cœur à nu lorsqu’il professait que Georges Delerue, son ami et partenaire de deux films, était le plus extraordinaire compositeur à avoir jamais œuvré pour le cinéma. L’hommage n’a rien d’anodin, venant d’un réalisateur dont l’amour immodéré de la musique l’a conduit à brosser les portraits peu orthodoxes de Debussy, Franz Liszt, Richard Strauss, Tchaïkovski ou bien encore des Who. Autant d’artistes qu’un franc-tireur cinglé a extirpés de leurs bocaux dûment étiquetés pour en faire les héros d’ovnis hallucinatoires, à cent lieues des biopics compassés qu’appelait leur inrayable statut. Il n’en va pas différemment pour Don’t Shoot The Composer qui, en 1966, met en scène Delerue dans une singulière histoire oscillant sans cesse entre l’érudition déférente et la farce absurde. Loin d’effaroucher le musicien, cette expérience l’avait ravi au point qu’une solide camaraderie s’était tissée entre l’iconoclaste Russell et lui. Aussi n’eut-il pas besoin d’y réfléchir à deux fois quand celui-ci fit appel à ses services, trois ans plus tard, pour illustrer l’adaptation d’un roman de D.H. Lawrence autour duquel flottaient les lourds remugles du scandale.
Ce n’est un secret pour personne que l’auteur de The Devils (Les Diables) et Music Lovers s’était fait un sacerdoce de traquer l’hypocrisie et les convenances de façade, qu’il faisait voler en éclats avec un nihilisme baroque pour révéler, sous leur vernis, l’éclat trouble d’inextinguibles pulsions. Quoique plus pondéré en apparence que les titres précités, Women In Love (Love) ne déroge nullement à la règle en foulant aux pieds les mœurs aristocratiques des années 20, avec la complicité d’un Delerue renchérissant brillamment dans ce jeu de dupes. D’emblée, l’ironie doucereuse du prélude promet beaucoup : accompagnées par le timbre guilleret du tandem formé par la trompette et la clarinette (qui arrange avec brio la mélodie de I’m Forever Blowing Bubbles, chanson appelée à devenir très populaire au cours de cette décennie), les deux héroïnes qu’interprètent Glenda Jackson et Jennie Linden prennent place dans un bus rempli de mineurs, où le festoiement de couleurs vives de leur toilette jette une clarté incongrue au milieu des visages barbouillés de suie. L’esthétique du faux-semblant que Russell s’ingéniera à travailler est déjà à pied d’œuvre, mais il est trop tôt encore pour que le spectateur, charmé par cette reprise musicale pleine de sève, y voit une franche volonté de nuire. Et du reste, c’est tout naturellement que Delerue embraye sur une courte envolée lumineuse lors d’une cérémonie nuptiale gonflée de rires. Plus tard, une mélodie voisine prendra son chatoyant essor pour saluer l’arrivée de couples hilares dans un chalet niché au creux des montagnes. Mais Ken Russell n’est pas homme à se complaire dans cet impressionnisme factice et, avec toute la férocité qui érigera sa légende, ne tarde pas à le retourner comme un gant : les jeunes mariés se noient dans un lac, leurs corps étroitement imbriqués ne recevant pour toute oraison funèbre que le chant mélancolique du hautbois, et Oliver Reed, orphelin de ses maigres illusions romanesques, se perd dans des immensités neigeuses dont la désolation est exacerbée par la musique, subtile alliance entre les cordes et les vents.
A l’instar d’un film prenant plaisir à faire sauter les verrous de la bienséance, la partition de Women In Love dissimule l’éclat froid d’un scalpel, manipulé par Delerue avec la dextérité d’un chirurgien résolu à taillader ces oripeaux trop artificiels. Quand les personnages se prêtent machinalement au rituel de la séduction courtoise, un désir enfoui électrise les échanges de regard en même temps que la harpe et la flûte, parfaits clichés instrumentaux pour cajoler une idylle fleur bleue, se drapent dans une sourde ambivalence. Au lieu de se conclure par un dernier mot acrimonieux, une vulgaire scène de ménage voit la femme hors d’elle étourdir son compagnon d’un coup à la tête, pas moins furieux que les cordes qui éclatent alors en stridences frénétiques. Libre à chacun de voir en elles le subit accès d’une folie impossible à réfréner ou l’audace, honorée en fanfare, d’avoir refusé à l’homme la victoire domestique que les usages sclérosés de l’époque lui certifiaient. Delerue, pour sa part, préfère jouer sur les deux tableaux à la fois, usant des bouquets de nuances dont ses orchestrations regorgent pour galvaniser l’ambigüité inhérente aux superbes images de Ken Russell.
A dire vrai, les protagonistes ne consentent à tomber le masque que leur impose la vieille Angleterre qu’au moment où ils capitulent devant leurs sens. Ces instants cruciaux pendant lesquels le corps, lassé des machinations stériles de l’esprit, s’abandonne à son propre langage, authentique, violent, ont inspiré à Delerue les plus formidables pics de son labeur. En témoigne cette incroyable séquence où Glenda Jackson, bondissant et pirouettant sur elle-même, met en déroute un troupeau de bovidés. La musique s’intensifie au rythme de sa chorégraphie enfiévrée, palpite d’une lueur qu’on jurerait presque tribale, et bientôt les bois saisis de démence, les percussions convulsives métamorphosent ces pas de danse en un véritable sabbat de sorcière. Derrière son visage où pas un muscle n’a tressailli, Oliver Reed est comme foudroyé, et il ne connaîtra plus un instant de repos avant de faire finalement sienne cette envoûtante créature. Il y parviendra, dans l’étrange atmosphère secrétée par d’abrupts cahots sonores. Les deux amants se fondent moins l’un dans l’autre qu’ils ne s’entrechoquent, et les cordes grinçantes s’inquiètent des rives sombres vers lesquelles une passion si désespérée pourrait les emporter.
La passion, le besoin inarticulé de succomber à une sexualité interdite, n’est-ce pas précisément ce qui pousse Reed et Alan Bates à s’affronter en tenue d’Adam ? La scène s’avère d’abord d’un ridicule achevé, avec ces deux hommes dans le plus simple appareil se roulant sur un tapis moelleux, tandis qu’un bon feu de bois crépite dans l’âtre. Mais ce qui ne devait être qu’un jeu destiné à tromper leur ennui se mue insensiblement en une lutte primitive, que la partition arbitre d’un ton lancinant. La clarinette, quittant le manteau coloré dont elle s’était vêtue lors du prologue, éclate en hoquets furtifs et obsédants, diabolique contrepoint à ces cordes montant crescendo dans l’angoisse, vers un dénouement que le spectateur ne peut s’empêcher d’imaginer tragique. Et c’est là, sur ce fil invisible tendu par la musique entre d’obscurs élans homo- érotiques et de soudaines pulsions de mort, que réalisateur et compositeur parviennent à faire de Women In Love l’objet mystérieux, quasi crépusculaire, qu’ils avaient fantasmé. Pour eux, ce somptueux achèvement artistique dévoilera de nouvelles et riches perspectives. Ken Russell, alors à la tête d’une œuvre considérable de téléaste, laissera derrière lui la BBC pour soumettre le cinéma à des excès toujours plus grandiloquents. Quant à Georges Delerue, cette incursion dans les sombres territoires de la modernité marquera au fer rouge les seventies naissantes, théâtre de certaines de ses musiques les plus âpres et tourmentées. Hélas, les chemins arpentés par ces créateurs d’exception ne se croiseront jamais plus, nimbant d’une flamme d’autant plus précieuse leur chef-d’œuvre commun.