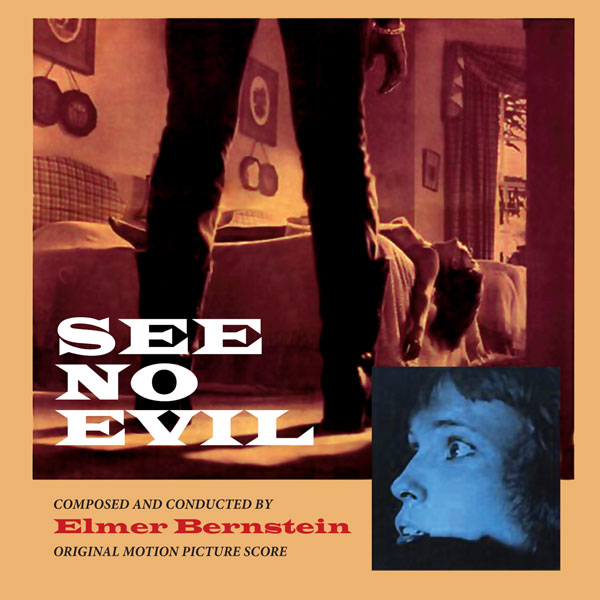THE MAN WITH THE GOLDEN ARM (1955)
Réalisateur : Otto Preminger
Compositeur : Elmer Bernstein
Séquence décryptée : The Fix (0:36:20 – 0:40:23)
Éditeur : Fresh Sound Records
Les malandrins hypocrites de la drugsploitation ne s’en sont jamais relevés. A des lieues des pensums obnubilés par une morale de pacotille, des complaisances alarmistes où d’apocryphes alibis scientifiques légitimaient qu’on exhibât violence cool et tétons turgides et des pères-la-pudeur qui, armés d’une caméra, décrivaient les paradis artificiels comme un aller simple pour les flammes de l’enfer, une production hollywoodienne osa braver les interdits du tout-puissant code Hays pour raconter le combat d’un homme aux prises avec la drogue. Sans fard, sans malhonnêteté idéologique. C’était en 1955. Son metteur en scène, Otto Preminger, jouait à quitte ou double son avenir sur les plateaux de cinéma et sa vedette, un Frank Sinatra peu à peu ringardisé par les bêtes vociférantes du rock’n’roll, avait soif de rôles difficiles. Ces deux-là, côte à côte, étaient de taille à soulever des montagnes. Avec son curriculum vitae famélique, où figurait entre autres navets désopilants le super-fauché Robot Monster, ce n’est certes pas le tout jeune type embauché pour écrire la musique qui eût pu se prétendre l’égal de têtes brûlées pareilles… Du moins le croyait-on !
Pourtant, The Man With The Golden Arm n’a pas fait que ceindre de gloire les vieux briscards Preminger et Sinatra, il a également mis au jour les hautes ambitions d’Elmer Bernstein. Quand on a eu, tout comme lui, Aaron Copland pour cicérone, on rêve forcément d’un autre destin que de combler avec un peu de papier à musique froissé les blancs abyssaux des séries B sans le sou. Le chemin de croix du junkie repenti Frankie Machine, abandonné par ses soi-disant amis au lendemain de sa sortie de prison, rabaissé plus bas que terre par sa compagne à la raison vacillante, est l’occasion rêvée pour notre jeune loup de braquer le feu des projecteurs sur un certain courant populaire, future pierre philosophale de sa carrière : le jazz. Evidemment, rétorqueront, blasées, les âmes pragmatiques : Frankie étant un batteur prometteur, qui espère trouver la rédemption en écumant les jazz bands, l’aiguillage musical du film paraissait tout trouvé. Ça ne l’était pourtant pas durant les années 50, où le vieil Hollywood avait encore pour habitude de snober tout ce que ne préconisait pas son rigoureux cahier des charges. Cette pudibonderie de mégère, Bernstein allait la chahuter à plaisir en donnant aux terribles dilemmes écartelant Frankie pléthore de reflets stylisés, suspendus quelque part dans le miroir de la musique américaine par excellence.
Oui, il est possible de réaliser un film sur la drogue, de se désoler de l’épouvantable addiction qu’elle provoque, et de faire malgré tout l’économie des sermons d’usage auprès des malheureux tombés sous sa coupe. Preminger pousse même l’insoumission jusqu’à se glisser dans la peau de l’infortuné Frankie, pour éprouver au plus près la remuante houle de ses sentiments alors qu’il vient de rendre les armes face à la tentation omniprésente. L’on discerne bien du désarroi au fond de ses yeux hagards, ainsi que la certitude, ardue à étouffer, palpitante sous la soudaine voltige des cordes, qu’il commet une terrible erreur. Mais le soulagement déferle sur tout le reste — parole donnée, belles résolutions, mise en scène. S’il advient parfois qu’un swing s’évase en bouches rieuses dans la partition d’Elmer Bernstein, comme autant de signes d’allégeance à la tradition décorative que laissait peser le cinéma américain sur le jazz, c’est un bebop enfiévré, cramoisi de modernité, qui s’en va secouer les moments-clés du récit. Dans la dernière partie, il s’empourprera violemment de détresse et de culpabilité. Pour l’heure, cependant, trompettes et trombones, englués ensemble, rugissent les volumineuses scansions du thème principal avec toute l’allégresse de la délivrance. Au diable le repentir ! Frankie s’est jeté de son plein gré dans l’œil du cyclone, et il prend un pied infernal.
Des symphonies jazzy nichées au sein des impasses noires de New York, la ville de cœur de Bernstein, des cuivres à la cool battant le pavé sur les traces des pires oiseaux de nuit, il y en eut d’autres, et beaucoup, dans l’œuvre du compositeur. Mais peu réussirent, à l’égal de The Man With The Golden Arm, à plaquer sur les tourments d’un damné pareil camaïeu de notes écorchées vives. Elles sont tantôt l’adrénaline qui gicle le long des veines de Frankie, poussée par le piston de la seringue, tantôt la foi en de meilleurs lendemains, désespérée et toujours à deux doigts de s’éteindre, que fait brasiller dans ses tripes la douce et bienveillante Molly. Ni colifichet à destination des oreilles endormies, ni source music ouatant sagement les cabarets chics, le jazz déploie ici une séduction féroce et abrasive à laquelle le héros se livre aveuglément, titubant entre raison et folie, innocence et péché. Qui sait de quel côté basculera-t-il finalement ?