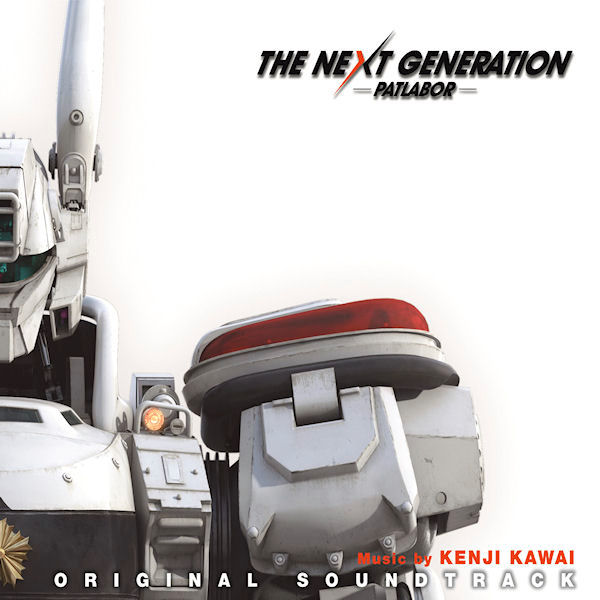Jamais Hitler n’eût pu subodorer ce genre d’héritage pour son idéologie mortifère ! Les groupuscules néo-nazis non plus, qui, essaimés en divers points du globe, se languissent encore et toujours de l’avènement de la race aryenne. Ceux-ci, malgré leur zèle fétide, sont pourtant battus à plate couture par des nuées de fétichistes (pas nécessairement) pervers, entretenant à loisir depuis la fin de la seconde guerre mondiale le rayonnement underground du Troisième Reich. Cuir luisant dont se gainaient les SS, brassards rouges frappés de la redoutée svastika, bottes aux talons sonores déroulant jusqu’aux genoux leurs plis noirs… Tout un arsenal érotisé sans vergogne, succès indémodable des soirées en l’honneur de Sacher-Masoch, inondant de tortures démentielles les couvertures peintes des Men’s Adventure Magazines, et jeté au fronton des cinémas de quartier où la nazisploitation s’épanouit un temps. On ne prêtera pas forcément de si peu avouables penchants à Mamoru Oshii, d’autant que sa marotte à lui concerne plutôt les chiens, et les liens ambigus qu’il s’ingénie à tisser entre l’homme et son fidèle compagnon à quatre pattes (on y reviendra). Reste que les Kerberos (plus communément appelés Panzers hors de l’Archipel), ces machines à tuer hérissées de flingues et d’acier, stars récurrentes sur son curriculum vitae, ont sans conteste de qui tenir. Et pour cause ! Ils sont les agents impitoyables d’un Japon uchronique, qui endura des lustres durant le joug de l’Allemagne nazie.
En 1987, alors multipliant les économies de bouts de chandelle pour venir à bout du tournage d’Akai Megane (Les Lunettes Rouges), Oshii pressentait-il, obscurément peut-être, que le résultat poserait le jalon liminaire d’une quête obsessionnelle ? Le gaillard étant d’une nature opiniâtre, pour ne pas dire têtue, il y a gros à parier qu’il ne comptait en tout cas pas s’arrêter à ce film déroutant, à même de fouler aux pieds presque tous les critères d’appréciation traditionnels du spectateur. Par contre, seuls des talents divinatoires prodigieux auraient été en mesure de lui prédire le partenariat fécond qu’avec deux collaborateurs encore néophytes, il consolida au cours des ans : le scénariste Kazunori Ito, dont la plume brillante dessina les formes de quelques-unes des plus grandes réussites d’Oshii, et un jeune chien fou du nom de Kenji Kawai, pour une large part autodidacte, jusque dans un look hirsute qu’il demeure à ce jour le seul à cultiver. Anecdote cocasse, ces trois-là, chacun de son côté, fourbirent leurs premières armes sous l’égide de la mangaka Rumiko Takahashi, ou plus précisément des adaptations animées de son œuvre. Bien davantage que ses compères, Mamoru Oshii conserva longtemps un penchant appuyé pour l’humour loufoque d’Urusei Yatsura (Lamu), dont il tira en particulier l’époustouflant Byutifuru Dorima (Un Rêve Sans Fin) et son carrousel de mélancoliques merveilles. Les Kerberos peuvent en témoigner, eux que ce legs a grossis d’une foultitude de protubérances.
L’exorde d’Akai Megane cache pourtant bien son jeu. Glacial, ombrageux, jonché de cadavres, il se double d’une musique idoine, pleine de palpitations métronomiques empestant le fer, lesquelles n’empêchent curieusement pas un lointain arrière-goût ibérique. À l’horizon miroitent déjà les riches promesses d’un film d’action énervé… qui ne se dévoilera jamais. Oh, il y aura bien, un quart d’heure plus tard, un guet-apens tendu par des hommes-chats au faciès peinturluré, et flanqué d’un petit ruban pulsatile résolu au minimum syndical. Mais sa conclusion abrupte et burlesque, aussitôt suivie d’une carapate « pour rire » où la musique s’élargit sur un rictus goguenard, bruitage cartoon à l’appui, met une bonne fois la puce à l’oreille : ce film-là n’a pas l’intention de se laisser apposer sans regimber une étiquette commode. Perdu dans une zone grise, un no man’s land cinématographique dont les extrêmes seraient délimités par Alphaville, Chris Marker et un Kafka ivre de saké, il fait sa pitance d’incongruités en tous genres — la moindre n’étant pas ces restaurants de nouilles déclarés hors-la-loi sur tout le sol japonais. Les audacieux y pénètrent avec l’angoisse aux tripes et d’étranges rythmes électroniques sur leurs pas, qui donnent à l’interdit une saveur un peu revêche. À cet instant, Oshii s’est déjà enfoncé gaillardement dans le n’importe quoi dénué a priori de rime comme de raison. D’humeur kamikaze, il s’empresse d’envenimer son cas en collant à son héros repu une chiasse digne de l’apocalypse, laquelle écope d’un morceau d’action plein d’engouement où le saxophone s’en paye une joyeuse tranche.
Entre autres saynètes timbrées, une escarmouche parmi les clairs-obscurs d’une salle de billard tourne au numéro de cabaret, sa pantomime potache soulignée par un piano bastringue, des cordes tout sourire et une trompette débordante de jovialité. Faute de repères un tant soit peu « sensés », on hésite même à se laisser prendre au piège tendu de douce soie rose que déploie soudain Kenji Kawai, craignant inconsciemment que l’émouvante mélodie posée sur la moue triste d’une ancienne Kerberos n’abrite qu’une de ces absurdités dont Oshii s’est entiché. Un autre court-circuit noircit l’un des rares synapses encore vierges du cinéaste lorsque le bad guy en chef, que son imperturbable faciès et ses lunettes noires préservaient jusqu’à ce moment du ridicule, se trémousse sans crier gare sur un simulacre guilleret de mambo ! Ce sera l’ultime tarte à la crème jetée par Akai Megane, comme si la nécessité d’apposer un point peu ou prou crédible à ce qui promettait d’être un cauchemar paranoïaque se faisait enfin sentir. Les synthétiseurs fabriquent alors en hâte une ambiance délétère, non dépourvue d’adrénaline, avant que celle-ci n’éclate telle une bulle de savon. En-dessous, une jolie petite mélodie de boîte à musique, dévidée en l’honneur d’une frêle silhouette encapuchonnée de rouge, dont on retrouverait la trace une décennie plus tard, courant sans espoir contre le destin fatal.
La bagatelle de quatre années s’écoula avant que les Kerberos ne revinssent ensanglanter les écrans. Dans l’intervalle, Mamoru Oshii n’avait pas chômé, inaugurant aux côtés du dessinateur Kamui Fujiwara le manga Kenrou Densetsu où il donna libre cours à ses antiennes fétiches. L’une des histoires courtes qui le composent, celle d’un Panzer déchu mais déterminé à retrouver son maître coûte que coûte, finit par prendre vie au cinéma sous le titre de Keruberosu, Jigoku No Banken, dont la transcription anglaise, Stray Dogs, ne laisse planer nulle ambiguïté quant aux intentions d’Oshii d’unir le chien et l’homme en un même trot vagabond. Préquelle plutôt que suite à Akai Megane, il ignore avec superbe le surréalisme étouffant de celui-ci pour mieux prendre la tangente. Cap sur les plages désertiques de Taïwan, cadre serein à une mélancolie mâtinée de bouffonnerie qu’il est terriblement tentant de rapprocher d’un certain Kitano. Facétie du sort, à ce moment-là, Beat Takeshi tournait lui aussi les pieds dans l’eau le très ascétique Ano Natsu, Ichiban Shizukana Umi (A Scene At The Sea), une œuvre dont les mélomanes gardent surtout souvenance pour les débuts d’un tandem avec Joe Hisaishi qui fit date. Celui noué par Oshii et Kawai était déjà bien rodé. En 1989, Kido Keisatsu Patoreiba Gekijoban (Patlabor) avait ciselé le modèle archétypal, prévalant toujours aujourd’hui, de l’univers commun aux deux hommes, panachage d’hypnotique morbidesse, de rares parenthèses chargées de fureur et d’existentialisme suspendu entre ciel et terre. La partition de Keruberosu s’engage résolument sur des clous identiques, contaminée elle aussi par les états d’âme de son héros en mal d’autorité. Dès lors que Mamoru Oshii les spolie de leur formidable cuirasse, les Kerberos semblent se recroqueviller dans les abîmes de l’autisme. Leur incapacité anxieuse à prendre leur destin en main est l’idée maitresse du cinéaste, et la guitare sèche, l’immuable reflet de cette psyché en proie à tous les tourments.
Bien moins excentrique que la précédente, la musique demeure constamment égale, à l’abri des humeurs volages et de leurs abruptes détentes. Elle se laisse porter par des riffs nonchalants, dans le dédale d’une petite ville décrépite, puis le long de routes vierges de presque toute circulation, jusqu’à un bord de mer étriqué ou l’ancien soldat esseulé retrouvera le collier de chien dont son cou se morfondait. Ça n’empêchera pas l’ennui de le ronger, tout comme le spectateur pour le moins perplexe face à une œuvre poussant l’analogie canine au point d’errer également sans but. In extremis, Mamoru Oshii et Kenji Kawai chasseront de concert la coriace torpeur, le premier en filmant une embuscade déjouée à terribles rafales de mitrailleuse lourde, le second en caparaçonnant les hostilités de battements électroniques corsetés par une raideur quasi-mathématique. On a connu des tirs d’artillerie moins rigoristes que ceux-là, bien qu’ils aient paradoxalement pris une place toujours plus prépondérante dans le corpus du compositeur, à telle enseigne que ce dernier devint avec le temps un spécialiste souvent sollicité de la musique d’action au kilomètre. C’est hélas sa fantaisie première qui en fit les frais, cet imbitable grain de folie dont Keruberosu n’est pas irrémédiablement orphelin, cependant : alors que le calme règne encore avant la tempête, les porte-flingues à l’affût s’octroient un instant de détente en sirotant quelques cocktails, larges sourires dignes d’une publicité au rabais et jingle ringard en renfort.
De cette déroutante paire de films mis en scène avec les moyens du bord, que diable reste-t-il à présent ? Pas grand-chose, à dire vrai. Un statut de brebis galeuses plutôt que de titres cultes les garde embastillés, à des distances faramineuses du royaume enchanté de la japanimation où leur géniteur figure au milieu des têtes couronnées. Peut-être parce qu’il réalisa un jour que jamais il ne parviendrait, caméra au poing, à s’engouffrer dans un champ des possibles aussi démesurément vaste que celui ouvert par ses chers amas de celluloïd, Mamoru Oshii tira un trait (provisoire) sur les prises de vue réelles pour donner vie à Jinro (Jin-Roh, la Brigade des Loups). À l’époque, toujours convalescent du tournage éreintant de son magnum opus Kokaku Kidotai (Ghost In The Shell), il se résolut un peu à contrecœur à déléguer le projet au chef-animateur Hiroyuki Okiura, lui-même éberlué de prendre si spectaculairement du galon. Pour périlleux qu’il s’annonçait, le baptême du feu n’en fut pas moins relevé avec maestria. Le parrainage d’Oshii, auteur d’un script splendide qu’il considère d’ailleurs en toute modestie comme un chef-d’oeuvre, eût pu tourner à l’étouffe-chrétien. Bien au contraire, le novice s’y arc-bouta pour donner à son galop d’essai une formidable densité dramatique. Succédant à Kenji Kawai dans cette nouvelle exploration d’une dystopie ténébreuse, Hajime Mizoguchi se révéla un autre soutien de taille — mieux, une clef de voûte ! Le compositeur et violoncelliste de formation, rapetissé plus souvent qu’à son tour par une paresse coupable au simple statut de « monsieur Yoko Kanno », livrait là l’une de ses plus éclatantes réussites, vrai parangon de lyrisme douloureux.
Pas forcément du genre à malmener les codes, bien moins enclin que Kawai à flirter avec les marges, Mizoguchi ne se satisfit cependant pas d’ouvrir le robinet d’eau tiède avec la complicité du Czech Philharmonic. Un film de l’envergure de Jinro réclamait à toute force une plus stimulante médecine. Après la farce claustrophobe et la fugue littorale, où l’homme est décrit chaque fois comme un chien à peine plus évolué, l’ombre du loup danse au-dessus de ce troisième chapitre de la saga des Kerberos, raconté à la manière d’une fable imbibée de ténèbres. Ô ! stupeur, le terrible prédateur, au lieu de dévorer le Petit Chaperon Rouge, tombe sans presque s’en apercevoir amoureux. Il n’en finira pas moins par ôter la vie à sa victime désignée et, par la même occasion, au merveilleux Love Theme qu’ils s’étaient tous deux escrimés à couver, comme la flamme d’un lumignon fluet menaçant à tout instant de mourir. Face à une meute de Panzers jamais repus de sang, que pouvait espérer le solo mélancolique de guitare au creux duquel se recroquevillent des sentiments tendres ? Harcelées par de sombres factions militaires et politiques ne rêvant que d’accroître leur pouvoir, comment pouvaient garder contenance ces cordes portant en germe leur propre tragédie ?
C’est aux causes perdues que, parfois, l’on reconnaît les âmes braves. Ainsi en va-t-elle de celle d’Hajime Mizoguchi, qui témoigne jusqu’au bout une fidélité presque héroïque à ce crédo fondamentalement dramatique. Même les tétanisants éclairs de violence dont le film est ensanglanté se voient contraints d’abdiquer, dépouillés tous autant qu’ils sont des bacchanales de cuivres pyrotechniques qu’un mercenaire de l’ostinato aurait succombé au réflexe mécanique de déchaîner. C’est manier l’euphémisme en orfèvre que de dire au sujet du tardif remake coréen de Jinro, vingt ans plus tard, qu’il ne fait pas tout à fait preuve d’une ambition comparable. Et pour cause ! Avec le va-t’en-guerre Kim Jee-Woon aux commandes… En glissant d’une strate géographique à une autre, l’histoire, nouvellement baptisée Inrang (Illang : La Brigade des Loups), ne fait pas qu’égrener les obstacles sur la voie de l’impossible réunification des deux Corées, elle renonce surtout à sa térébrante tristesse. Le thème de Mizoguchi, téléporté à l’identique depuis le modèle nippon, ressemble à un aveu grommelé d’impuissance, une tentative flasque de munir d’un peu d’émotion un film obnubilé d’abord par son impact balistique. Éclairages fluo et fusillades hénaurmes écopent de plages musicales frelatées, sans inspiration ni caractère, d’où émerge le seul souci du compositeur Lee Sung-Hyun, alias Mowg, d’ouvrir le plus large éventail possible des poncifs modernistes. Mission accomplie, hélas !
À l’inverse de ce que d’aucuns escomptaient, Mamoru Oshii ne s’insurgea nullement. Il se déclara ravi du design des armures (très réussi, admettons-le) portées par les Kerberos, louangea le résultat dans ses grandes lignes et encaissa, on l’imagine, de substantielles royalties. Le feu rouge de l’obsession semblait s’être éteint en lui — finalement. Depuis l’entrée dans le nouveau millénaire, il n’a porté qu’une seule fois à l’écran son uchronie au goût de rouille… Et encore s’y affaira-t-il en empruntant un chemin qui laissa ébaubis jusqu’à ses plus dévoués paroissiens. Tachiguishi-Retsuden plante en effet son décor dans les restaurants de nouilles prohibés d’Akai Megane, dont le héros ne poussait les portes qu’à ses risques et périls. Consacrer un film complet à ces drôles de bastions de la liberté tenait de la folie douce. Et le résultat, surréaliste équivalent cinématographique d’une cocotte en papier, est à tomber des yeux. On imagine avec un sourire moqueur à quel point Kenji Kawai dut béer de sidération en découvrant ce salmigondis d’avant-garde, totalement figé, pour ne pas dire statufié, loufoque à ses heures perdues et bavard à en perdre haleine. Dans le doute, plutôt que d’essayer de dérouler un fil rouge qui n’aurait pas mis longtemps à lui échapper, il choisit d’entasser ses idées pêle-mêle, comme à l’intérieur d’une valise sur laquelle il eût ensuite sauté à pieds joints pour faire claquer ses fermoirs.
Ce joyeux fourre-tout rappelle bien sûr l’exubérance débridée d’Akai Megane, à laquelle se grefferaient les us et coutumes stylistiques d’une écriture ayant beaucoup évolué en l’espace de vingt ans. Il y a ici à boire et à manger, un thème dont le bellicisme latent galvanise des synthés sans cela bien creux, neuf minutes indolentes et fouillées d’une plage minimaliste où le trademark Kawai pulse sourdement, cors et trombones évincés par un pis-aller électronique, un sitar rescapé d’une nouba bollywoodienne et ramené peu à peu à de plus solennelles dispositions par un pouls mystérieux, les piaulements fripons du saxophone fusant sur une pop song pleine de petites bulles… Kawai fait feu de tout bois, avec l’espoir de s’approprier le mantra que martèle Tachiguishi-Retsuden à longueur de séquence : les restaurateurs des bas-fonds et leur clientèle sont les héros de ces temps troublés. Vraiment, quel singulier appendice à la saga de Mamoru Oshii ! Durant ses déambulations au cœur d’un Japon déliquescent, le cinéaste qui se rêvait démiurge sera passé par bien des états, tour à tour funèbre, paranoïaque, méditatif, cabot, furibond, quand ce n’était pas tout ça en même temps. Quelque part dans ce paysage filmique torturé, cette histoire condamnée à l’inachèvement, la musique creuse moult sillons comme autant de ramures à un écheveau chaotique, caressant ou hérissant le grain de ses instruments au gré de trajectoires décousues.