MARK IL POLIZIOTTO  (1975)
(1975)
UN FLIC VOIT ROUGE
Compositeur : Stelvio Cipriani
Durée : 36:10 | 15 pistes
Éditeur : Cinevox Record
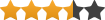
À bas les tergiversations empotées ! Inutile de mimer la candeur, le poliziottesco est une affaire d’hommes. C’est assez dire s’il représente une ère de cinéma révolue, dont les mœurs d’aujourd’hui rendent modérément probable la spectaculaire résurrection, un jour prochain. Quelque sociologue, un peu féru aussi d’archéologie, en quête des archétypes centenaires de la virilité latine, trouverait amplement à se rassasier avec les intraitables héros des années de plomb. Bien sûr, à moins d’être animé de facétieuses intentions, on n’aiguillerait pas d’emblée le prospecteur vers les gibbosités déformant la silhouette du truand fou furieux « il Gobbo », ni vers le bonnet bariolé et le look broussailleux de Delitto, qui rend un hommage hilare à la prestation d’Al Pacino dans Serpico — autant de postiches de carnaval sous lesquels se démène à en perdre haleine l’ineffable transformiste Tomás Milián. En revanche, loin de cette exubérance sans la moindre gêne, fleurissent de plus orthodoxes durs à cuire. Ainsi, des blonds dont le regard aux lueurs de cobalt surmonte une moustache poussant dru, une catégorie dominée par Franco Nero et son ersatz démolisseur Maurizio Merli. Dans le compartiment d’à côté, les bruns ténébreux se distinguent par une allure de jeune premier, avec Fabio Testi en chef de file, talonné par le je ne sais quoi d’ombrageux de Luc Merenda. Et puis, parmi ceux-ci, il y a Franco Gasparri, chez qui la fadeur du bellâtre de roman-photo, spécialité italienne dont il fut un stakhanoviste très populaire, l’emporte sur la masculinité supposée hargneuse du superflic Mark Terzi qu’il interpréta bon gré mal gré à trois reprises. Ce fut là son plus gros succès dans les salles obscures, paradoxalement emblématique de ses insolubles difficultés à malmener cette image de gendre idéal plus collante qu’un sparadrap. Rien n’y fit, ni les scripts où macère l’ordinaire du polar violent, ni la caméra engourdie de Stelvio Massi… ni même le concentré d’adrénaline brandi telle une chandelle romaine par Stelvio Cipriani !
Qu’aurait pu mieux réussir le musicien ? Il n’y était indubitablement pas allé à l’économie, non plus qu’avec les tâtonnements d’un néophyte pétrifié par la peur de l’échec. En 1975, nul ne lui eût contesté ses galons de petit prince de la mitraille, remportés de façon éclatante grâce à La Polizia Sta a Guardare (Le Grand Kidnapping), entre autres partitions mafflues. Le thème de ce dernier marqua au fer rouge bien des mémoires, arrachant aux cuivres des aboiements rauques et faisant du clavecin un maniement très personnel, toute parenté avec l’auguste distinction de ses racines baroques jetée aux orties. L’instrument rempile dans Mark il Poliziotto, et de nouveau, son ostinato rouge de fièvre modèle le kaléidoscope d’une sirène de police hululante, projetée au fin fond des coupe-gorge dont les grandes villes italiennes possèdent un vivier manifestement inépuisable. Mais cette fois, les trucs redoutables d’efficacité que prise Cipriani se compliquent d’une influence tout autre ; celle, groovy en diable, de la blaxploitation — en espérant envers et contre tout que la physionomie lisse, polie de Gasparri s’enfoncera d’une providentielle crevasse, d’une aspérité au moins pour y accrocher une bribe du charisme voyou d’un Richard Roundtree ou d’un Jim Brown. La cause est perdue d’emblée, mais le plaisir qu’éprouve Cipriani à la défendre, son pied tressautant tout contre la pédale wah-wah, un saxophone dépenaillé passé en bandoulière, rappelle combien les compositeurs des spasmodiques heures populaires de Cinecittà ne rechignèrent jamais à donner de la confiture aux cochons. Nous voilà d’autant plus dépité, écumant de rancune à l’encontre d’un film qui, au milieu d’affreux narco-trafiquants, déroule si paresseusement son fil rouge que les occasions de cravacher l’orchestre se font bien rares. Lorsque surviennent ces soubresauts, en tout cas, ils trouvent le petit arsenal de Cipriani sur le pied de guerre, et flanqué des gammes rentre-dans-le-gras d’un piano sur les touches duquel les doigts du compositeur, familier du clavier depuis ses jeunes années de formation, courent avec autorité.
Il n’est pas de guerre imaginable sans son lot de victimes collatérales, innocentes ou complaisantes, qu’importe. Le combat sans merci que livre Terzi à l’empire de la drogue ne fait pas exception. Sa croisade l’amène à se prendre d’une curieuse affection pour l’un de ces infortunés, une toxicomane au regard hébété, emplie d’une sourde détresse qui, peut-être, dans l’esprit du flic solitaire, remue âprement les souvenirs de son service dans la police américaine, où lui-même tomba sous l’emprise des paradis artificiels. Le masque indéchiffrable de Franco Gasparri devient par bonheur complice d’une relation souvent mutique, love story qui s’ignore, estimeront certains à l’aveuglette, pas beaucoup plus secourus par la sobre ligne mélodique qu’adopte Stelvio Cipriani. Quand expire la malheureuse jeune femme, aucun pathos ne vient grossir de protubérances mélodramatiques les discrets accords de la guitare sèche, la flûte esseulée, le spleen sourdant de l’harmonica tel un crachin d’automne. Engoncé en silence dans son fauteuil, groggy de désarroi nous semble-t-il, Terzi rumine déjà sa vengeance, la laisse se congestionner derrière la façade du devoir. Revolvers dont on fait cliqueter le chien et caisses à savon parties à l’assaut du bitume rythmeront ainsi le dernier acte du film, symphonie rituelle du poliziottesco. Cipriani, bien sûr, est là pour la fortifier de ses propres trombes sonores, administrées selon le tempo moite de la batterie et d’un tambourin enchevêtrés. Un vrai musc de jungle, qui exacerbe la hâte bouillante avec laquelle le compositeur se démène dans le sillage funk des rois noirs Isaac Hayes et Johnny Pate, pour ne citer qu’eux. À coup sûr, il se rencontrera quelque esprit chagrin, sanglotant que la furia all’italiana se diluât dans ces appels du pied au modèle américain, brillants certes, mais trop hardis. Eh, quoi ? Il fallait bien tout mettre en œuvre, quitte à racoler en terre lointaine, pour tatouer sur les joues blêmes du stoïque Gasparri deux vigoureuses fleurs roses.

















