 THE LAST BOY SCOUT (1991)
THE LAST BOY SCOUT (1991)
LE DERNIER SAMARITAIN
Compositeur : Michael Kamen
Durée : 78:07 | 28 pistes
Éditeur : La-La Land Records
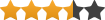
Parfois, Shane Black s’en amuse encore, comme d’une excellente farce dont il aurait mystifié les ronds-de-cuir d’Hollywood. Devenu, au carrefour des années 90, le scénariste le plus grassement payé de la profession, l’homme voyait surtout dans l’orgie de zéros grossissant son compte en banque de vifs encouragements à cajoler ses maux à l’âme, alors pluriels. Ce qu’il fit, troussant chaque nouveau script à la manière d’un cabinet psychiatrique où lui-même n’avait qu’à vider son sac. À ce titre, le prologue de The Last Boy Scout n’y va pas de main morte. Dans l’espoir fiévreux et largement hallucinogène d’endiguer son terrible déclin, une star du football américain mise le paquet sur un flingue — qu’elle retournera contre sa tempe après avoir ensanglanté le terrain de jeu ! Paradis artificiels et pulsions suicidaires en guise d’apéritif, ne reste donc plus, pour parachever la sainte trinité selon Black, qu’une redoutable mamelle : l’alcoolisme. Bruce Willis s’en établit le porte-étendard quelque peu crasseux avec un charisme à son zénith, et une ostensible jubilation à pousser l’archétype du privé à la dérive dans des retranchements voisins de la parodie. Faire se jauger, presque en chiens de faïence, les clairs-obscurs des séries noires d’après-guerre et la vulgarité triomphale car m’as-tu-vu du cinéma d’action nouveau, telle est la gageure, relevée non sans panache, du film de Tony Scott. Idem pour Michael Kamen, lui aussi de l’aventure, production Joel Silver oblige. Et pourtant ! Difficile de concevoir gouffre plus abyssal entre le bien nommé Black, perclus de névroses, dépressif au dernier degré, et notre jovial compositeur, dont le sourire franc et généreux, fendant d’une oreille à l’autre sa face hirsute, demeure la plus vivace des images rattachées à son souvenir.
De facto, modérément captivé par les lignes tapageuses de la chose, Kamen préfère mettre à nu la sensibilité d’écorché vif qui, sous un vernis trop huileux, frissonne avec violence. Il sacrifie d’abord au protocole, flanquant d’un embryon de fanfare cuivrée l’en-tête du film, où les crédits du générique arborent une typographie d’écrasant airain, avant d’en prendre le contrepied en un geste un tantinet indolent. Tandis que Willis rumine son crâne en capilotade, sa fille qui n’a pour lui que mépris et, s’apprête-t-il à découvrir, son meilleur ami qui le cocufie, Kamen s’abandonne au rappel de ses précédentes incursions dans le buddy movie, à savoir les deux premiers Lethal Weapon, où il caractérisait le duo de flics mal assortis grâce à un instrument au bénéfice de chacun. The Last Boy Scout lui offre de récidiver, d’une façon sans doute un peu plus feutrée, en gratifiant le détective d’un cor affligé d’une gueule de bois analogue, laquelle explique qu’il se garde bien de débiter ses notes dans l’excès. Quant au second larron, vedette déchue de l’ovalie, il mange son pain noir aux grattements d’une basse acoustique désabusée. Dans cette litanie morose, rivalisant de sécheresse avec sa sœur d’armes la contrebasse, jamais un accord plus haut que l’autre. Les deux hommes, que vont réunir tant bien que mal les convulsions écarlates d’une intrigue sise dans le milieu des paris interlopes, sont clairement au bout de leur rouleau. Ils n’ont dorénavant plus qu’à remonter la pente, quitte, pour ce faire, à en découdre avec des cols blancs véreux et des nervis à la gâchette fébrile. Parmi ce gibier de potence qui s’amasse, un tueur sinistre, maniéré jusqu’au dandysme, prendra un plaisir sardonique à se dresser entre nos héros et la rédemption. Plutôt qu’un thème en bonne et due forme, Michael Kamen lui fait l’aumône d’un motif rampant, chuintement électronique hérissé d’arêtes aigües où rien d’humain ne s’esquisse. À force de diabolique persuasion, il devient même plus grand que nature, outrepassant le rôle de simple signature à l’adresse du bad guy de service pour embrunir le sport professionnel, les pilules prohibées qu’ingurgitent les athlètes au pied du mur, les vertueux politiciens affublés de sourires de requin, les combines retorses et les mensonges minables… Tout un méli-mélo hard-boiled, que ces bizarres vergetures synthétiques semblent vouloir précipiter dans les buissons de ronces d’une féérie noire.
Soit. Partons du principe que le dernier boy-scout et son compère d’infortune sont bien les peu fringants farfadets d’un conte maculé de sang. Considéré sous cet angle de guingois, il n’y a plus rien que de très normal à voir Bruce Willis, sur le point de finir truffé de plomb, s’essayer à la ventriloquie avec un ours en peluche… puis tirer dans le tas à l’aide du Teddy Bear en question. Au lieu de renchérir alors dans l’incongru, un exercice à propos duquel il n’avait de leçon à recevoir de personne, Michael Kamen cède assez classiquement la parole aux armes, plaçant au sortir du canon ces cuivres tonitruants, bâtis sur de vertigineuses accélérations, dont il fut toujours si friand. Lorsque bons et méchants écrasent le champignon immédiatement après, les voitures lancées à tombeau ouvert sur des chemins de terre et des raidillons aux airs d’à-pics terrifiants jouissent du même modus operandi. Cantonnée jusqu’à présent aux mornes joies de l’auto-apitoiement, la guitare jumelée à l’ex-footballeur gagne tout à coup en assurance et muscle sa gratte. Un regain de confiance qui ne sera pas de trop pour la poursuite des hostilités sur une autoroute, saturée comme il se doit. D’appétence martiale, pilonnant le bitume de ses inépuisables scansions, ce morceau de bravoure ébouriffant dévie pourtant de sa méthodique trajectoire sans crier gare, le temps d’un solo de flûte irlandaise. L’auditeur guère au fait du film n’y comprendra goutte, et imputera peut-être même à une catastrophe éditoriale l’insolite parenthèse, close par Kamen aussi vite qu’il l’avait ouverte. Elle n’est cependant que le reflet du serment saugrenu dont Willis vient de se rendre coupable au cœur de l’action : s’il se tire vivant d’un tel guêpier, il dansera sur-le-champ la gigue ! Et en effet, une fois son tourmenteur expédié en enfer à l’état de pulpe sanguinolente, il se met à se dandiner en harmonie avec des cordes délicieusement folkloriques. Pas de la plus orthodoxe célébration de la victoire qui soit, mais l’on n’en attendait pas moins de sa part. Après tout, les bons samaritains n’ont qu’une parole.




















