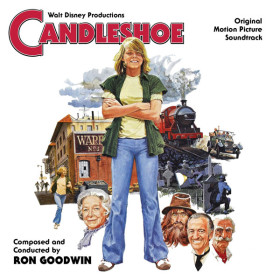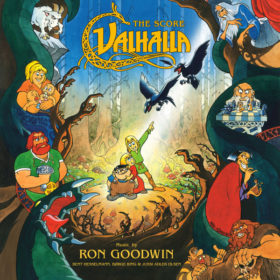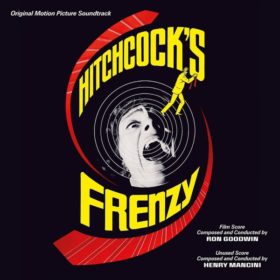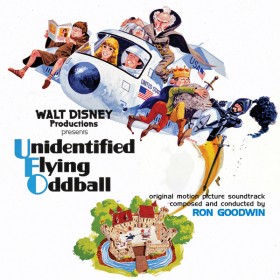WHERE EAGLES DARE 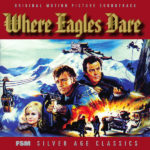 (1968)
(1968)
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
Compositeur : Ron Goodwin
Durée : 73:19 | 20 pistes
Éditeur : Film Score Monthly
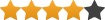
Une toile de fond tendue sur les pires cataclysmes militaires de l’Histoire, la Seconde Guerre mondiale caracolant à la tête des heureux élus ; une mission aux atours d’épopée suicide derrière les lignes ennemies, aux confins desquelles se dresse, une fois sur deux, l’imposante silhouette hérissée de tourelles d’une forteresse que sa sinistre réputation dit imprenable ; et, pour mener à bien l’opération, une poignée de trompe-la-mort peu ou prou galonnés, des durs à cuire prêts à toutes les extrémités. On ne sait plus au juste combien de cette soldatesque assaillirent sulfateuse au poing les salles obscures. Une tripotée, c’est certain, depuis les swinging sixties qui les virent hégémoniques jusqu’aux années 80, ère pétaradante où une autre bête de guerre nommée Rambo et ses clones débraillés leur disputèrent le monopole de la mitraille. Dans leurs rangs se trouve un peu de tout, entre ardents patriotes, vieux briscards blasés face au jeu des armes, et même quelques fieffés salopards. L’équipe de choc de Where Eagles Dare compte trois de ces derniers et fourbes spécimens, ce qui, pour un Richard Burton acharné à les démasquer dans les Alpes autrichiennes, représente toujours une besogne moins ardue que s’ils avaient été douze… Mais sus aux comparaisons bringuebalantes ! Aussi capable soit-il (et il l’est éminemment), Brian G. Hutton, derrière la caméra, n’éprouve pas des penchants semblables à ceux de Robert Aldrich pour le sarcasme trempé dans le vinaigre. Quant à la musique, même combat, les ironiques épanchements d’un Frank De Vol pas plus respectueux que les Dirty Dozen envers la bannière étoilée se muant, sous l’égide de Ron Goodwin, en un hymne martial fracassant. L’héroïsme s’abstient certes de jaillir de ses gonds (pas trace, ou alors si peu, de ces flonflons joyeux voués à couvrir de gloire les héros en uniforme), mais un premier degré sacerdotal comble jusqu’aux moindre interstices d’où eût pu suinter quelque vitriol antimilitariste. L’introduction on ne peut plus classique par une caisse claire aiguille déjà sans traîtrise les oreilles affranchies, avant que le Main Title ne déverse puissants staccato et tintamarre de cuivres comme autant de signes irréfutables de ce qui va suivre : en l’occurrence, un film de commando dans les règles de l’art.
Ce sillon viril, Ron Goodwin va le parcourir de long en large, gardant ses sourcils perpétuellement joints en un cumulus menaçant, à l’instar de Clint Eastwood sacré ici virtuose de la gâchette. Tout juste s’autorisera-t-il un brin de détente grâce à de menus échantillons de source music, dont celle égayant avec son humble instrumentarium rond comme une queue de pelle une auberge bondée, où le compositeur s’amuse à honorer l’abyssal décolleté d’Ingrid Pitt d’un folklore bavarois moins égrillard que guilleret. Ailleurs, un filet de romantisme capiteux s’échappe d’une radio sur laquelle se penche un soldat allemand, mais l’invitation à baisser les armes que d’aucuns croiraient y déceler n’est qu’un leurre : Eastwood s’approche en tapinois, un couteau à la main. L’ancien Homme sans Nom n’a rien perdu de son brio surnaturel à semer la mort. Aux côtés de Ron Goodwin, bien plus finalement qu’avec Richard Burton, le cerveau de leur binôme, absorbé d’abord à détricoter l’écheveau d’une intrigue improbable, l’acteur défourailleur peut casser du Fritz en ne doutant point qu’il sera à chaque instant robustement épaulé. Operation Crossbow, Squadron 633 (Mission 633) et ses envolées fleurant doux le western, sans omettre, dans l’immédiate foulée de Where Eagles Dare, sa participation polémique à Battle Of Britain (La Bataille d’Angleterre), vrai crime de lèse-majesté aux yeux des admirateurs du vénérable Sir William Walton qu’il supplanta : pour tout ce qui touche aux grandes manœuvres, difficile de confondre Goodwin avec un bleu-bite pas fichu de tenir la cadence. Le rythme, justement, se révèle ici un atout-maître, notamment lors d’une dernière partie sacrément fournie où les héros tentent d’échapper à des essaims d’assaillants. Écrasant, omnipotent, au point de figurer les clameurs de stentor de quelque dieu belliciste, le thème principal subordonne le moindre des innombrables roulements percussifs, nourrit à n’en plus pouvoir le vibrato des cordes, sacralise la débauche des trombones et des cors. La guerre revendique sans équivoque son droit musical à l’hypertrophie, et c’est ainsi blindée de fer qu’elle rend parfaitement digeste l’impression que le taciturne Clint est en train d’éradiquer presque à lui seul la moitié des armées allemandes.
Deux des paroxysmes du film laissent pourtant les cracheuses en bandoulière et les flingues dans leur holster. Frank McCarthy, artiste génial qui voyait tout en démesurément grand, ne s’y méprit pas en faisant converger les extravagantes lignes de fuite de son affiche peinte vers un seul moyeu : le téléphérique au toit duquel s’agrippent Burton et Eastwood. La tension rencontre ici son summum, à l’aller et mieux encore au retour. Outre un usage ingénieux et relativement peu voyant des transparences, ennemis létaux de la suspension d’incrédulité lorsqu’on y a recours au petit bonheur, cette paire de séquences haletantes peut également s’arc-bouter contre les modèles d’efficacité écrits par Ron Goodwin. Dès l’instant où la cabine entame sa lente ascension vers les contreforts du château que « seuls les aigles peuvent atteindre », la musique, à son tour, s’arrache à la gravité. Son essor doit beaucoup au pupitre princier des cordes, dont les trémolos délicieux s’affinent au coupant de l’archet. Une portion de mystère (des suceurs de sang blafards ne se terreraient-ils pas là-haut, dans les entrailles de cette citadelle qu’on jurerait surgie des Carpates ?) en profite pour s’immiscer par le truchement d’une harpe, proche d’évoquer, grâce à son patient ostinato, les énigmes nautiques que chérissait Bernard Herrmann. Quand, de nombreuses péripéties plus tard, le commando de la justice, sa mission presque accomplie, rebrousse chemin, Goodwin exploite derechef ses précédentes figures de style, mais corsées de manière à jeter bas le sentiment de déjà-entendu qui menaçait. En vérité, le compositeur s’y sent d’autant plus enclin que la furtivité de la première équipée s’éclipse au bénéfice d’un combat au firmament digne de James Bond. Tout secoué de cuivres hargneux, livré au martèlement des timbales, le téléphérique devient pour Richard Burton suant sang et eau la plus mortelle des arènes. Ron Goodwin, à l’opposé, ne saurait s’estimer davantage heureux d’avoir été mandé pour sonner une si formidable charge. Avec un clairon de ce calibre, les vils casqués d’en face n’ont qu’à bien se tenir !