 SANGUE DI SBIRRO (1976)
SANGUE DI SBIRRO (1976)
POUR UN DOLLAR D’ARGENT
Compositeur : Alessandro Alessandroni
Durée : 48:07 | 18 pistes
Éditeur : Cinedelic Records
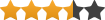
Passée l’hébétude première, le mélomane croit à une méprise, une malencontreuse bévue ayant, dans le ventre du lecteur, substitué à Sangue di Sbirro un tout autre disque, furieusement familier. Le cinéphile, pour sa part, se trouve aussi assailli de doutes en rafales, bien que les colosses de brique emplissant les images du générique ne ressemblent guère à ceux de Harlem et que George Eastman, mémorable Anthropophagous pour le compte de Joe D’Amato, aussi hirsute qu’à l’accoutumée dans le cuir d’un flic endeuillé et revanchard, ne soit pas précisément le portrait craché de Richard Roundtree. Mais enfin, comment ravaler une homophonie à ce point flagrante au rang de bête coïncidence ? Mêmes riffs crâneurs de guitare électrique, même propension marquée par le batteur à se déhancher sur un rythme syncopé, mêmes cuivres ponctués de gouleyantes exclamations, même fièvre funk ruisselant de tout l’orchestre à grosses gouttes… Si ce n’est Shaft, c’est donc son frère ! Absolument pas, en vérité. Le hit immédiat que fut la musique d’Isaac Hayes en 1971 engendra une foultitude d’envieux, au milieu desquels le cinéaste-papier buvard Alfonso Brescia, si bien tombé sous le charme qu’il tint mordicus à ce que son minuscule poliziottesco, cinq ans plus tard, roulât des mécaniques sur un mode semblable. Au diable le procès pour plagiat ! Celui-ci n’advint de toute manière jamais, preuve par a plus b de l’extrême confidentialité d’un film qui se noya dans le pullulement des polars a mano armata. À considérer de près l’oeuvrette en question, nul ne dénoncera en vociférant une sinistre injustice.
Il y a en revanche pas mal d’autres choses à dire au sujet de sa partition, et du type qui la composa. Un cas passionnant que celui d’Alessandro Alessandroni, dont la cavité buccale frémissante lui accorda le privilège de devenir le siffleur génial des westerns de Leone et Morricone. D’aucuns sont entrés dans la légende pour moins que ça… Nonobstant cette mirifique prouesse, flanquée parfois de l’euphonie d’un nom qui put faire croire ici ou là à un pseudonyme facétieux, le musicien demeure peu distingué, presque inconnu au bataillon. Ses talents pluriels d’instrumentiste sont passés sous silence, alors que l’égale dextérité avec laquelle il jouait de la guitare, du saxophone, de la mandoline et même du sitar, pour ne citer que ceux-ci, l’intronise sans peine homme-orchestre — au sens littéral de l’expression ! Quant à sa carrière de compositeur, elle est le parent pauvre qu’on snobe superbement, quand son existence n’est pas tout bonnement ignorée. L’enseigne tachée de couleurs criardes du bis européen bringuebalant au-dessus de presque tout le corpus d’Alessandroni, on s’explique mieux ce rendez-vous manqué avec l’immortalité. Les quelque cinquante titres musicalisés par lui se dégustent donc comme des plaisirs (loin d’être) coupables, à l’instar du présent Sangue di Sbirro et de son générique éhonté. Décalcomanie de contrebande, certes, mais pourvue d’un réel et spectaculaire clinquant, et qui, tout bien réfléchi, fait harmonieux ménage avec le rictus prédateur d’Eastman. Rebelote dès la piste suivante, plaquée à la hussarde sur une course-poursuite pédestre, où l’on reconnaît (quoique de façon moins flagrante cette fois) derrière certaines embardées teigneuses le célébrissime refrain du Black Is Black de Los Bravos. Lequel, fait notoire dans l’Hexagone, n’en était déjà pas à sa première resucée.
Damned ! L’auteur de ces lignes voudrait travestir Alessandroni en pique-assiette, à l’affût des bonnes idées mises en œuvre par ses petits camarades, qu’il ne s’y activerait pas différemment. Mais, réelles ou apocryphes, ces soupçonneuses conjectures ricochent, tels d’inoffensifs jets de gravier, contre la robuste carapace d’un savoir-faire écumant à tous les niveaux. On l’a vu, l’action est la première à en jouir, suivant la droite lignée d’une blaxploitation avide de vibrations chaloupées et de pédales wah-wah en surchauffe. Dans cet opuscule parmi une cargaison d’autres de sa frénétique période italienne, le grand Jack Palance, point trop cabot à l’inverse de ses (mauvaises) habitudes, vêtu d’un complet-veston copurchic, voit son rôle de mafieux roué déjà très secondaire rapetisser encore sous la féroce modernité de la musique. Dédaigneuse, cette dernière ne lui donne qu’un unique os thématique à ronger : la frime, moyennement évocatrice de l’acteur, du groove titré sans ambages Palance. Alessandroni, pour qui les desiderata d’un Alfonso Brescia rompu aux vieilles marmites de l’exploitation sont des ordres, n’insiste donc pas et s’en va se trémousser sur commande express auprès d’une go-go danseuse. Allez savoir, une bonne lampée de disco vigoureusement cuivré, s’arc-boutant contre la croupe frétillante, parviendra peut-être à fissurer le stoïcisme d’une clientèle snobinarde… La chair n’est cependant pas vouée, dans le polar italien patibulaire des années de plomb, à n’être que tristesse et spectacle blême. À l’exemple de ce thème romantique dont la flûte détoure d’abord les inclinations fleur bleue, avant qu’une recrudescence du suspense, lors d’une piste suivante, ne l’affuble de l’embonpoint charmant d’une trompette pop-jazz. En outre, c’est audit thème qu’échoit l’honneur de clore Sangue di Sbirro, arrangé en une version séduisante qui fait la part belle à des sifflements un rien mélancoliques — sifflements modulés par la bouche de vous-avez-parfaitement-deviné-qui. On ne se refait décidément pas.











