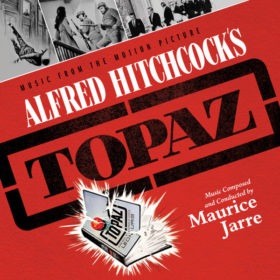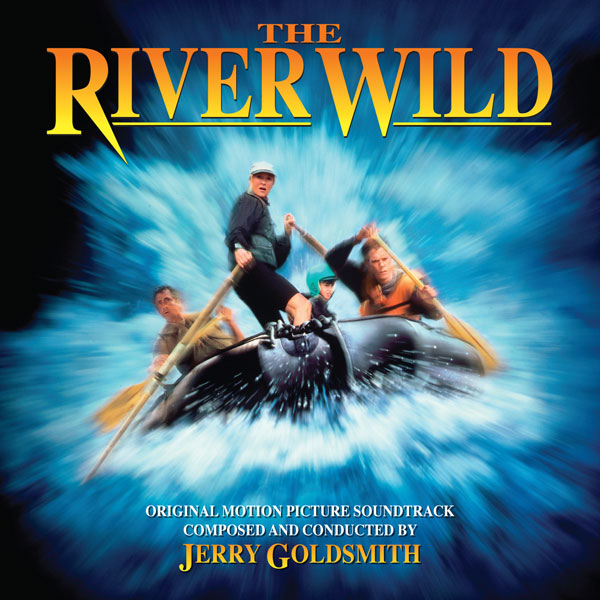CONCERT WORKS (2008)
CONCERT WORKS (2008)
Compositeur : Maurice Jarre
Durée : 72:44 | 7 pistes
Éditeur : Film Score Monthly
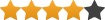
Si on ne remerciera jamais assez Lukas Kendall et Film Score Monthly d’avoir permis la mise à disposition discographique de ces oeuvres de jeunesse, on peut également décerner le césar de l’amnésie et du mépris aux éditeurs français qui ne l’ont pas fait, tout comme aux médias qui n’ont pas évoqué la récente récompense berlinoise de Maurice Jarre… Mais est-ce vraiment étonnant ?
Première remarque sur ce disque : un excellent séquençage qui déploie au fur et à mesure de l’écoute une palette toujours plus grande de l’orchestre et de l’expression jusqu’à la Ronde de Nuit, avant d’ouvrir un second acte avec les Mobiles pour Violon et Ochestre. Les Trois Danses évoquent immédiatement le musicien percussionniste que fut Jarre, le goût prononcé de cette époque pour les instruments à résonance et l’adoption, très tôt, de la sirène des ondes Martenot, un instrument cher à de nombreux compositeurs avant et après la deuxième guerre mondiale. L’ambiance envoûtante et austère, la recherche de timbres et de rythmes évoquent quelque rituel mystérieux.
La Passacaille en hommage à Honegger présente un Jarre moins connu : énorme travail de contrepoint (Honegger vénérait Bach), dissonances, ambiance presque angoissante. La trompette qui démarre la pièce fait effectivement de suite penser à Pacific 231, partition phare de l’œuvre d’Arthur Honegger. De cette passacaille à celle que Jarre offrira au film de Peter Weir, Witness, c’est toute une époque qui défile !
La Ronde de Nuit permet de retrouver plus que jamais le Jarre des grandes fresques symphoniques. A l’image des Trois Danses, le tempo initial évoque un rituel païen (proche des rythmes «hypnotiques» de Wojciech Kilar). Les accords typiques dans les vents et les cuivres sont sa marque de fabrique (comme cette première petite fanfare qui conclut l’introduction) : personne n’écrit comme Jarre, et personne n’a d’ailleurs jamais cherché à l’imiter. Cette construction en augmentation, qui finalement rejoint celle de la Passacaille précédente et l’esprit de Pacific 231, est tout à fait admirable. Plus on avance dans la pièce, plus l’orchestre se déploie et s’affirme à chaque épisode (séparés les uns des autres par une petite fanfare) jusqu’à atteindre l’ivresse dionysiaque d’un rythme implacable et d’une dernière fanfare dissonante, avant que l’énergie musicale ne s’étiole pour se terminer sur la douceur de la flûte…
Retour à une ambiance de réflexion austère avec les notes du violon solo des Mobiles, œuvre plus pointilliste, au maillage serré, exploitant les dissonances, les attaques sèches, les pizzicatos… Bientôt, les couleurs des percussions à résonance (à environ 18 minutes) se déploient telles des voiles derrière un violon qui se détend chemin faisant et se fait plus sensuel, plus onirique. On retrouve dans cette pièce un goût prononcé pour un instrumentarium riche en percussions, permettant le jeu et le contraste des notes brèves, des longues résonances, des timbres secs et des timbres doux, à l’image de ce que Pierre Boulez a fait pour le Marteau sans Maître ou Explosante/Fixe, et ce malgré la grande différence de langage entre Jarre et son ancien compère.
La Suite Ancienne pour Percussions et Piano est à la base une œuvre de concours, donc un exercice de style où l’on retrouve l’aisance du compositeur avec les percussions et une facilité avec les formes anciennes qui fait de lui l’excellent dramaturge caméléon qu’il est devenu. On appréciera en particulier l’idée du contraste entre le langage historique invoqué et la modernité des sonorités.
Ce disque permet ainsi de découvrir un peu mieux le visage d’un Jarre héritier de Stravinsky ou du Horace Victorieux d’Honegger (certainement la plus belle œuvre du compositeur d’origine suisse), un compositeur attentif aux préoccupations de son époque mais sachant développer un langage unique. Tout comme Marcel Landowski un peu avant lui, l’héritage d’Arthur Honegger s’avère pour Maurice Jarre une voie naturelle vers l’expression la plus libre, débarrassée de systèmes étouffants, et vers la palette d’émotions la plus riche qui soit (Landowski aimait aussi, soit dit en passant, le chant des Ondes Martenot). On peut regretter peut-être qu’il n’ait pas poursuivi et travaillé plus encore ce langage entre deux commandes hollywoodiennes. Son langage a pu s’adapter à la diversité des sujets pour le cinéma, mais s’est-il assagi avec le temps ? La question pourrait être posée. Avait-il déjà donné le meilleur de lui-même, très tôt ? Peut-être. Comme Jerry Goldsmith, sa musique s’est adaptée à l’époque. Cela n’empêche en rien le grand plaisir d’écoute de ses partitions électroniques des années 80, qui recèlent toujours une véritable écriture et une recherche sonore très personnelle. Belle découverte en tout cas que ce retour aux sources.