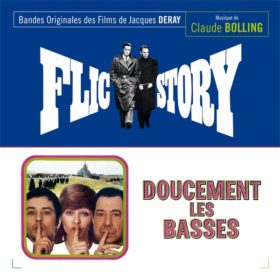LUCKY LUKE : LA BALLADE DES DALTON (1978)
Réalisateurs : Goscinny, Morris & Henri Gruel
Compositeur : Claude Bolling
Séquence décryptée : Dalton’s Musical (Le Rêve Délirant de Joe) (30:50 – 36:09)
Éditeur : Music Box Records
Fumer tue ! Il est permis de douter que l’hypocrite mise en garde, martelée en lettres capitales sur les paquets de cigarettes, ait réussi à sauver des vies. En revanche, les victimes collatérales d’un tel prêchi-prêcha, conduit depuis longtemps déjà, ne se comptent plus : Telly Savalas, obligé de troquer son barreau de chaise contre une sucette au coca dans Kojak ; Jacques Tati, dans la bouche duquel des affiches de sinistre mémoire substituèrent un moulin à vent jaune à sa fidèle pipe ; ou encore Lucky Luke qui, au début des années 80, dut commencer à mâchonner en lieu et place de cigarette un pauvre brin d’herbe. Il s’en est fallu de très peu que le réjouissant La Ballade des Dalton, sorti en 1978 dans les salles, n’essuie l’ire du politiquement correct. Les dieux soient loués, la clope est toujours là, nonchalamment pendue aux lèvres du poor lonesome cowboy. D’étranges substances hallucinogènes sont même de la partie, qu’un Indien facétieux a répandues dans l’eau que les Dalton assoiffés ont commis l’erreur de boire.
S’ensuit une incroyable scène onirique, n’ayant définitivement rien d’un cri d’alarme contre les périls de la drogue. Les bons souvenirs qu’avait laissés à Claude Bolling Daisy Town, précédente adaptation animée de Morris, constituaient en soi un excellent prétexte pour remettre le couvert. On parierait sans hésitation cependant que la perspective de musicaliser cette séquence seule a bien davantage stimulé le compositeur. Franchement, le rêve comico-glamour, étincelant hommage aux musicals hollywoodiens, dans lequel s’abîme l’irascible Joe semble avoir été conçu pour lui ! En smoking et redingote, en veste à rayures ou en robe fanfreluchée, portant haut-de-forme ou canotier malicieusement incliné, et claquant avec entrain de leurs pieds chaussés de rutilants souliers ou de bottes pailletées, les Dalton revisitent en un éclair plusieurs décennies d’une des plus enchanteresses traditions du spectacle qui soient. Mais si, à l’image, le quatuor nigaud monopolise également tous les pupitres symphoniques, il convient de ne pas s’y tromper : le véritable homme-orchestre demeure sans discussion Bolling.
Il aurait eu tort de ne faire que dans la demi-mesure, notez bien. Grands seigneurs, Morris, Goscinny et Pierre Tchernia lui ont accordé le privilège, rare pour un musicien de cinéma, de concevoir à l’amont du tournage son ambitieuse partition. C’est donc à celle-ci, délicieusement chamarrée, qu’il incombait d’emblée de guider les Dalton au cœur d’un tourbillon de chants et de danses. Avec un thème aussi onctueux qu’un bol de crème pour fer de lance, capable de résonner au diapason de cuivres orgueilleux puis, un battement de cils plus tard, de fusionner avec d’espiègles pizzicati, la musique se paye la tournée des grands ducs : Gene Kelly partant à l’assaut des flaques d’eau dans Singin’ In The Rain, Frank Sinatra déployant toute sa séduction veloutée, les immenses kaléidoscopes géométriques dont le fabuleux chorégraphe Busby Berkeley avait fait sa marque de fabrique… et la liste n’est pas exhaustive. De quoi risquer de déséquilibrer toute la scène, qui ne dure guère plus de cinq minutes, par un trop-plein pataud.
Mais Claude Bolling a retenu les leçons des maîtres. Pas moins élastique qu’eux, il court d’une saynète à une autre grâce à d’inventives transitions, comme jadis, les comédies musicales américaines prévenaient de l’irruption d’une féérie chantée et/ou dansée via un ample mouvement de caméra ou des éclairages se parant soudain de nouvelles moirures. Le grand dadais Averell est lui-même mis à contribution, ses maladresses proverbiales concluant parfois un numéro en queue de poisson. On le voit dégringoler un escalier, emporté par d’anarchiques claquettes que le compositeur traduit avec humour en un petit ostinato cliquetant. Un peu après, il se prend les pieds dans les touches d’un piano bastringue géant, et achève le swing qui s’y jouait par un énorme couac. Mais cette fantasmagorie en Technicolor peut aussi être troublée de façon bien moins burlesque, quand apparait sur fond de dissonances des cuivres et de la clarinette qui s’étrangle, le pire des trouble-fête : Lucky Luke en personne, la trogne patibulaire sur les avis de recherche qu’aussitôt prennent pour cible des six-coups vindicatifs, dont Bolling s’amuse à singer le bruit des détonations. Pauvre Joe, qui n’attend que de descendre son pire ennemi une fois pour toutes… Tu rêves, amigo !