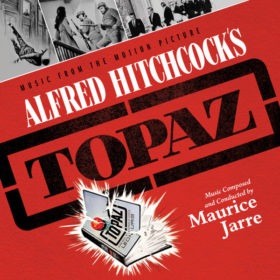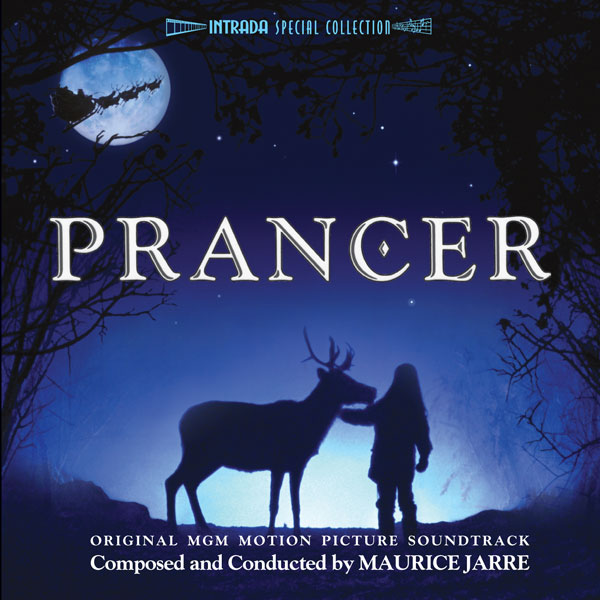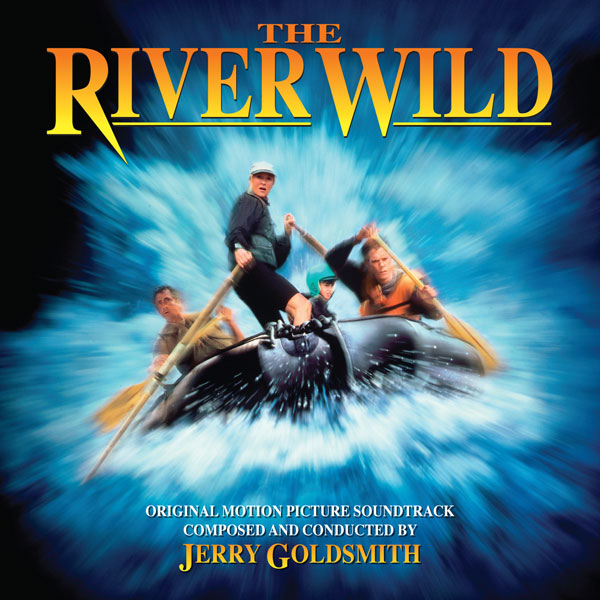LES YEUX SANS VISAGE (1960)
LES YEUX SANS VISAGE (1960)
Compositeur : Maurice Jarre
Durée : 12:37 | 6 pistes
Éditeur : Disques Cinémusique
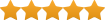
« Ma tête me fait peur, mon masque me fait plus peur encore. »
Extérieur nuit. Le long d’une route de campagne, les formes squelettiques d’une rangée d’arbres dressés sur le bas côté sont illuminées par le passage d’une 2CV solitaire. Une femme est au volant, visiblement anxieuse. Soudain le regard accusateur d’une paire de phares apparaît dans l’encadrement de la vitre arrière. Au cours de cette scène en apparence quotidienne, l’angoisse s’installe progressivement, pendant que retentit une valse entêtante et dissonante. Ainsi commence Les Yeux Sans Visage, un des rares classiques du film fantastique et d’horreur du cinéma français et une des premières partitions remarquées de Maurice Jarre.
Intérieur jour. Le professeur Génessier, brillant chirurgien, donne une conférence qui relate ses recherches sur l’hétérogreffe devant un public attentif et admiratif. Deux scènes contrastées se succèdent au début du film qui opposent brutalement l’inavouable et le caché (la route la nuit puis la rivière emportant un cadavre) au brillant des dorures et de la terminologie scientifique (qui permet d’occulter une réalité faite de souffrances et de coups de bistouris). Pourtant, dans ces deux lieux, le maître de jeu est le même homme, conservant son air bourru et impassible, qu’il soit face à ses admiratrices ou en train de voler son visage à une jeune fille innocente.
Comme il le dit lui-même, le professeur Génessier aime l’ordre. Cet ordre a beau reposer sur une inavouable monstruosité, il n’est pas homme à s’en effaroucher, lui qui par son métier connaît l’agencement des viscères sous la peau de ses semblables. Sa conscience, à l’image de son château par métonymie labyrinthique, est organisée en compartiments hermétiques qui lui permettent de ranger chaque chose à sa place. Peu importe si certaines pièces sont, par nécessité, moins visitées que d’autres, au risque de voir dépérir ce qu’elles contiennent. La société dans laquelle il vit n’est-elle pas organisée aussi comme cela ? Pour le brillant de l’esplanade du Trocadéro ou du quartier latin, il y a en effet comme envers du décor, toute la morne réalité de la banlieue, de la morgue et du cimetière, où chacun trouve sa place, en fin de course.
Pour le professeur le but de la course est clair : rendre à sa fille Christiane le visage qu’elle a perdu par sa faute. Dans cette fin, il y a pour lui, inextricablement mêlés, la gloriole du succès professionnel et le soulagement d’une culpabilité fondatrice. Homme méthodique, il ne s’embarrasse pas de principes ou de considérations morales pour y parvenir. Dans son travail comme dans les domaines moins avouables de son activité, tous les moyens sont bons. L’anesthésie forcée d’une victime innocente dans sa cave transformée en salle d’opération comme le mensonge ambigu à un de ses jeunes patients et à la mère de celui-ci sont autant de façons d’éviter la confrontation avec ce qui pourrait entraver son entreprise : la manifestation de la dimension humaine des autres protagonistes. Ceux-ci sont-ils cependant moins monstrueux ?
Au dehors, le professeur rencontre des personnages eux aussi fort ambigus. Leur milieu, Franju le décrit dans un style sèchement réaliste. Jarre suit ce parti-pris en n’y apposant aucune musique. On y voit des policiers qui n’hésitent pas eux-mêmes à recourir à la manipulation et au chantage en offrant en appât à Génessier une nouvelle victime. Pourquoi, d’ailleurs, rentreraient-ils en conflit avec ce dernier ? Ne sont-ils pas comme lui dévoués au maintien de l’ordre ? Leur méthode, comme celle du professeur, est basée sur une confiance aveugle dans la rationalité et fait fi de toute autre considération. Le soupirant de Christiane lui-même a beau avoir entendu sa voix au téléphone, il préfère continuer à la croire morte plutôt que de remettre en question l’assise rationnelle de son existence. Ainsi, ces personnages partagent-ils tous à différents degrés le péché d’orgueil du professeur, ce qui explique son impunité face, du moins, à la justice des hommes.
Au château, Franju abandonne le réalisme pour adopter un style fantastique qui trouve ses motifs dans l’univers du conte : les figures du père, de la jeune fille et de la marâtre sont convoquées avec leurs sous-textes de culpabilité (filiale et paternelle) et d’inceste. Les deux résidentes de ce lieu, en dehors du professeur, sont affectées par deux monstruosités opposées : Christiane, défigurée dans un accident de voiture, est le personnage auquel le titre fait allusion. Ce visage que le père veut cacher à tous, y compris à sa fille, comme le reflet de ses péchés s’avère cependant moins effrayant que le visage lisse et sans âme du personnage d’Alida Valli, chef d’œuvre du professeur. Elle est la créature du savant fou, entièrement déshumanisée et ramenée à l’état d’un automate qui se charge pour lui de la basse besogne : repérer leurs victimes potentielles à la sortie de la Sorbonne, les prendre au piège et finalement se débarrasser de leurs corps après en avoir fait usage et, tout cela, sans états d’âme.
Pour caractériser ces deux personnages, Jarre compose deux thèmes qui, certes, ont en commun d’être tous deux des valses, mais que tout oppose par ailleurs. Il associe à Christiane une mélodie mélancolique, néo-classique dans son écriture, à l’orchestration précieuse et délicate (solo de hautbois et accompagnement léger au piano). Le thème suggère par sa beauté éthérée l’innocence de la jeune fille ainsi que le monde morbide et clos dans lequel elle est consignée par son père : elle, blanche colombe dans une cage dorée (autre motif iconographique du film), le décor, hors du temps, représentant les appartements d’une parfaite jeune fille, ornés de luths et d’une harpe mais où l’on a pris soin de faire disparaître tous les miroirs.
Par contraste, le thème associé au personnage d’Alida Valli sonne comme une valse brisée mais qui continuerait à retentir. Le rythme à trois temps, habituellement associé à l’idée inoffensive de la danse ou des attractions de fête foraine, y devient obsédant, mécanique, associé à une instrumentation qui est une collection de sons stridents. La mélodie au rythme pointé, chromatique et sinueuse, connaît une progression harmonique à la fois régulière (toutes les quatre mesures) et morbide dans sa dissonance. C’est le thème le plus utilisé dans le film et celui qui représente le mieux le sujet central de l’œuvre et la source de son horreur : la déshumanisation, dont le personnage d’Alida Valli est la plus glaçante incarnation.
Cette approche musicale originale ne prend pas le spectateur par la main en en rajoutant dans l’effet choc et suggère une horreur moins viscérale qu’intellectuelle. Une horreur qui naît d’un décalage ironique qui sera, pour les années à venir, une des signatures du compositeur. Surtout, au contraire d’une musique empathique qui accompagne les réactions du public et, dans une certaine mesure les dicte, la partition crée une distance vis à vis des actions représentées et des personnages, refusant au spectateur le confort de l’identification.
Les rares fois où Franju a recours à la caméra subjective, il montre la vision partielle, brouillée d’un personnage : les phares dans la nuit qui n’illuminent la route que sur une faible distance, le plan flouté lors du réveil d’Edna lorsque celle-ci voit Christiane sans son masque. Seul le spectateur accède au point de vue omniscient et c’est dans cette solitude qu’il fait l’expérience de l’horreur du film. Le metteur en scène lui présente une effrayante vue en coupe des différentes sphères de l’action, et il est le seul à toutes les appréhender. Franju se rappelait ainsi lors d’une interview que le film le plus effrayant qu’il avait jamais vu était un film médical consacré à une trépanation. Il analysait ainsi la source de son effroi, alors même que le médecin dans le film expliquait que le cerveau était indolore : « Ce qui fait que c’est véritablement de l’horreur, c’est que la souffrance du spectateur est sans partage. Bien sûr, si on voyait le patient souffrir, ce serait équilibré, mais pas du tout, alors, c’est terrible ! »
Franju nous place dans cette position suprêmement inconfortable tout au long de son film. Aucun héros ne viendra mettre au grand jour toute l’affaire et c’est dans une séquence toute surréaliste que le film s’achève marquée, à l’image, par un retour à l’obscurité initiale (celle de la scène d’ouverture) et, dans la musique, par une reprise des accords dissonants qui lui servaient d’ouverture et qui accompagnaient la mort d’Edna. Jarre, en accord complet avec son sujet, nous refusait une résolution réconfortante et signait là son premier chef d’œuvre.