
NANKAI NO DAIKETTO / GODZILLA VS. THE SEA MONSTER (1966)
GODZILLA, EBIRAH & MOTHIRA : DUEL DANS LES MERS DU SUD
Compositeur : Masaru Satô
Durée : 42:33 | 37 pistes
Éditeur : Futureland
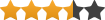
Rétrospectivement, c’était un vrai cadeau empoisonné pour Jun Fukuda. Lui, l’artisan scrupuleux abonné aux polars virils et aux films d’hommes, promu du jour au lendemain successeur d’Inoshiro Honda, le père fondateur en personne, sur la très populaire et lucrative série des Godzilla. Beaucoup s’en seraient sentis honorés. Mais Fukuda, de son propre aveu, ne goûtait guère le sabir high-tech et les déchaînements de couleurs de la science-fiction japonaise. Il y a gros à parier que les fans du titan atomique avaient eux-mêmes accueilli la nouvelle avec un scepticisme analogue, d’autant que Gojira No Gyakushu (Le Retour de Godzilla), premier film de la saga où Honda s’était temporairement désolidarisé de sa création, n’avait pas précisément traumatisé les foules. En acceptant donc en 1966 de réaliser Nankai No Daiketto (Godzilla Vs. The Sea Monster), Jun Fukuda avait sans le savoir scellé son destin. Il resterait à jamais aux yeux des amateurs furibonds le yes man coupable d’avoir estourbi les grands monstres japonais par un trop-plein d’infantilisme, de péripéties parodiques et de combats dignes d’une mêlée de bac à sable.
Entre honnêteté et masochisme, le cinéaste a toujours plaidé coupable. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fameuses fanfares militaires d’Akira Ifukube, l’un des plus indéfectibles complices d’Inoshiro Honda, n’ont pas été du voyage. Fukuda voulait enrober les rocambolesques aventures du Roi des Monstres d’une musique moins ombrageuse qu’à l’accoutumée, et l’excellent Masaru Sato, lui aussi un artiste de première force, s’en est acquitté avec talent. En vérité, pour son retour dans le giron du kaiju eiga et de ses délires naïfs (le type à l’origine de la partition du Retour de Godzilla, c’était lui, déjà), le compositeur, suivant à la lettre les stipulations d’un Fukuda avide de légèreté, a carrément remis les compteurs à zéro. L’horreur martiale d’auparavant s’est évanouie, cédant sa place à un ton savamment métissé où une forme de burlesque le dispute à des montées de suspense on ne peut plus sixties. Mis eux aussi sur la touche, les cuivres noirs et implacables, jusqu’alors indissociables des ravages du lézard atomique, se muent dans Rebirth Of Godzilla en de curieux glissandi de guitares. Une menace couve encore, sous-jacente, derrière ces gammes exécutées avec vigueur, mais le fantôme de l’ancienne terreur de l’Archipel s’effiloche davantage à chaque nouvelle strophe rigolote.
On a fait essuyer les plâtres à Jun Fukuda pour moult raisons. L’une des plus récurrentes concerne la décision, malheureuse il est vrai, d’avoir abandonné au cours des années 60 les mégalopoles japonaises, théâtre de tant de destructions des fameuses miniatures amoureusement façonnées par Eiji Tsuburaya, pour parachuter les monstres en plein cœur d’îles tropicales. Dans le cas de nombreux kaiju eiga, ces nouveaux décors ne furent qu’un dérisoire cache-misère, voué à masquer des budgets de plus en plus rabotés. Mais pour Sato, l’occasion était propice à faire bifurquer le genre une bonne fois vers le second degré qu’on exigeait de lui. Transportation By Yaren, avec son carnaval très animé de flûtes aux vertus exotiques, de brusques sursauts de trompette et de percussions où le xylophone est roi, est un essai très conscient de pousser vers un rivage moins belliciste le caractère tribal qu’Akira Ifukube lui-même, dans Kingu Kogu Tai Gojira (King Kong Contre Godzilla) en particulier, avait naguère ébauché. Le résultat, jubilatoire, apporte un supplément d’âme vital aux palmiers en plastique que les techniciens de la Toho ont semé (plutôt chichement) sur le chemin de Godzilla.
Bien qu’il ait lui aussi tâté plus souvent qu’à son tour de cette veine pseudo-naturaliste, Inoshiro Honda n’aurait sans doute œuvré qu’avec la plus froide répugnance sur un film tel que Godzilla Vs. The Sea Monster. Témoin impuissant de la défaite de son pays lors de la Seconde Guerre mondiale puis de sa déchéance, il en garda toute sa vie une rancœur qui, dans ses réalisations, affleure sous l’apparence dune mélancolie quelque peu rétrograde. En tout cas, on imagine qu’il n’aurait pu s’empêcher d’insuffler une ironie distanciatrice à la scène où de jeunes Japonais dansent le jerk et sirotent des boissons pétillantes. Ce qui nous vaut le plaisir d’un Young Go Go où Sato, bien plus décomplexé dans son rapport à la modernité, donne quartier libre à sa fiévreuse inspiration pop.
Dans le même ordre d’idée, les apparitions d’Ebirah, le crustacé communiste (!), sont systématiquement soulignées par d’étranges bourdonnements électroniques, là encore très sixties. Lesquels, pour modernes qu’ils sont, ne font à l’évidence rien pour intensifier le faible capital « dangerosité » du monstre. Au moins avons-nous échappé à un échantillon de musiquette de plage quand Ebirah et Godzilla, se renvoyant mutuellement à la figure un énorme roc, paraissent livrer en toute amabilité une compétition de beach volley.
A ce stade, les inconditionnels du fabuleux tandem Honda/Ifukube n’avaient plus qu’à verser des larmes de sang. C’eût été faire bien peu de cas de Mothra, le célèbre papillon géant, dont le traitement tant visuel que musical se révèle l’objet de toutes les délicatesses. Rien de surprenant à cela, considérant que le majestueux lépidoptère a toujours figuré aux côtés de l’indétrônable Godzilla sur la liste des grands monstres japonais les plus populaires. Un succès ayant eu pour fâcheuse conséquence de le griser au-delà du raisonnable, car durant les deux tiers de Godzilla Vs. The Sea Monster, Mothra se complait dans un rôle de diva capricieuse et tourne obstinément le dos aux aborigènes court vêtus qui se perdent en invocations en son honneur. Au grand dam des enfants frustrés devant l’écran, sans doute, mais à la vive satisfaction de Sato, qui met à profit le running gag (involontaire ?) des danses rituelles pour se fendre d’autant d’hommages à la fameuse Mothra’s Song, imaginée cinq ans plus tôt par Akira Ifukube. Il a beau être constellé de tam-tams profonds qui le parfument d’un musc primitif, le résultat, sincèrement respectueux, découle de la même féérie lumineuse qu’autrefois. Reste que des compositeurs tels que Kunio Miyauchi ou Riichiro Manabe, suiveurs dilettantes dans l’univers extravagant du kaiju eiga, se référeront moins aux symphonies taillées dans l’obsidienne du grand Akira qu’au dynamisme « à l’occidentale » caractérisant Masaru Sato. Sans jamais retrouver, néanmoins, la pétulance pleine de couleurs dont le musicien avait su faire, auprès de films sacrément bancals, un allié de poids.














