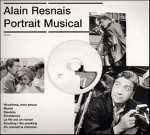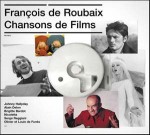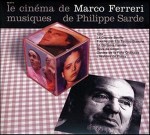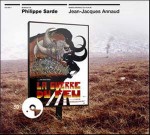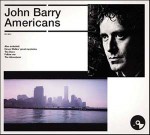Il y a dix ans déjà naissait au sein d’Universal Music France la collection Ecoutez le Cinéma ! À cette occasion, le producteur de cette collection sans équivalent avait exprimé ses désirs et ses attentes dans un entretien publié sur TraxZone (et que vous pouvez maintenant découvrir sur UnderScores). Dix ans et plus de quatre-vingt albums plus tard, l’heure du bilan a sonné. Stéphane Lerouge a ainsi partagé avec nous ses souvenirs d’une décennie consacrée à sauvegarder le patrimoine musical du cinéma. Un long entretien riche en anecdotes qui apporte un nouvel éclairage sur un aspect de l’univers de la musique de film mal connu, souvent incompris, et pourtant indispensable pour nourrir la passion des amateurs du monde entier.
Quel regard portes-tu sur les dix années passées ?
Si, en 2000, on nous avait annoncé que la collection continuerait dix ans après, on n’y aurait pas cru, sincèrement. Cela paraît miraculeux qu’en 2010, on soit toujours actifs, qu’on ait pu préserver cette idée de deux cycles de parutions annuels, deux saisons, printemps et automne. Au départ, les fondations de la maison, c’était Georges Delerue, François de Roubaix, Michel Magne, Antoine Duhamel, sans oublier Philippe Sarde qui avait ouvert les hostilités, Eric Demarsan avec les Melville… Ils constituent le noyau dur d’Ecoutez le cinéma !, la collection a été pensée pour eux et, du coup, je n’aurais pas davantage cru la personne qui aurait prédit : «Dans dix ans, Nino Rota, Jerry Goldsmith, Jimmy Smith, Lalo Schifrin, John Barry, Krzysztof Penderecki, Luiz Bonfa vous auront rejoint…» Cela m’aurait paru complètement incongru, baroque, parce qu’a priori, ce n’était pas l’intention de la collection. Donc, sans fausse modestie, le premier motif de satisfaction, c’est d’avoir traversé le temps, d’avoir enrichi la collection d’invités-surprise, de certaines bandes originales que l’on croyait à jamais égarées… alors même qu’en dix ans le marché du disque à beaucoup bougé.
Mais, à vrai dire, je n’ai pas vu passer cette décennie : ça a été un mouvement permanent, continu, avec des moments d’accélération, d’exaltation, parfois de déception aussi. Ce qui m’a fait mesurer l’écoulement du temps, ça a été le départ de Daniel Richard, directeur du label Universal Jazz. Son département a été intégré au Classique pour devenir Universal Classics & Jazz France, sous la houlette de Yann Ollivier. En 2009, Yann a donc hérité de cette collection dont il est devenu une sorte de père adoptif, bienveillant et attentif. Et je serais toujours reconnaissant à Daniel de nous avoir donné les moyens de nos ambitions en disant : «Voilà, j’ai envie que cette mémoire musicale du cinéma français existe en CD, avec des versions intégrales de certaines bandes originales». Sans lui, nous n’en serions pas là. Et, à son départ, je lui ai dit : «Ecoute, c’est très émouvant parce que, sur cette collection, nous avons tout de même passé…» Et là, j’ai commencé à faire le compte et je me suis aperçu que huit ans, presque neuf, s’étaient écoulés : le départ de Daniel a donc sonné comme une prise de conscience que finalement, ce n’était plus une collection débutante. Tout en relativisant, car face à des labels comme Varèse Sarabande, Intrada ou même FSM, Ecoutez le cinéma ! est d’une relative jeunesse.
La collection a-t-elle toujours la même ambition qu’il y a dix ans, ou a-t-elle évolué ?
L’ambition originale ou originelle s’est déplacée, à cause de certaines rencontres, de circonstances totalement imprévisibles. Par exemple, Les Félins ne faisait pas partie de nos projets initiaux. Mais il y a eu un hommage à Lalo Schifrin au Festival de Cannes 2004, un concert en trio jazz, en référence à ses prestations en clubs quand il était étudiant au Conservatoire de Paris, cinquante ans plus tôt. Puis une leçon de musique suivie d’un dîner où Schifrin me dit : «Le souci sur Les Félins, c’est que j’ignore à qui appartient la bande…» Je lui réponds : «Lalo, je peux essayer de retrouver la trace du propriétaire. Mais, malgré tout, ça ne résoudra pas le problème du support…» Grand sourire de Lalo : «Mais j’ai toutes les bandes chez moi, à Los Angeles !» Et là, d’un seul coup, on a pu réunir les deux pièces du puzzle : la vérification juridique d’un côté, l’accès à la bande master de l’autre. Voilà comment la bande originale des Félins, inédite en disque, a rejoint Ecoutez le cinéma ! Idem pour John Barry : son arrivée dans la collection découle de notre rencontre à l’occasion du Festival d’Auxerre en 2007, grâce à l’ami Jon Burlingame, formidable historien américain de la musique de film. Jon m’a permis d’entrer en contact avec les Barry, John et sa femme Laurie, alors qu’ils vivent assez en retrait du métier, par le fait même que Barry n’écrit plus pour le cinéma depuis neuf ans cette année (son dernier score est Enigma en 2001 – NDLR). J’ai rencontré John Barry à Londres le 21 juin 2007, jour de la fête de la musique en France… et anniversaire de Philippe Sarde et Lalo Schifrin. Et John a accepté de venir en France, cinq mois plus tard : il a été décoré des Arts et Lettres et, le lendemain à Auxerre, a reçu une ovation du public. C’était son premier concert en France. Nous avons gardé le contact, je lui ai parlé de la collection et il m’a dit : «Il y a deux ou trois enregistrements de ma période Polydor que j’aimerais voir ressortir. Ça appartient à Universal…» Là encore, hasard des rencontres, des circonstances… Et pareil pour Plein Soleil, dont j’ai découvert les bandes incidemment, je dirais même miraculeusement.
Il y a deux ou trois ans, j’étais passé voir Agnès Varda sur le tournage des Plages d’Agnès, rue Daguerre. Au fond de sa boutique, il y a une salle de montage avec des rayonnages, des boîtes, des bobines… Brusquement, sur une tranche, je vois écrit Delerue / Documenteur. Des musiques au piano seul, semi-improvisées par Delerue, sur les images d’Agnès, et rejouées par Michel Colombier, pour des raisons techniques. Une bande qu’Agnès était la seule à posséder… Sur une autre étagère, je découvre les bandes multipistes de Parking : un véritable choc car Michel Legrand n’avait qu’une seule envie, réenregistrer les chansons de ce film avec un chanteur professionnel. Autrement dit, l’ambition originelle de la collection s’est déployée différemment, elle nous a emmenés à des endroits ou l’on ne devait, a priori, pas aller. Par exemple, au départ, on devait sortir les musiques de Sarde, mais uniquement celles propriétés d’Universal Music. Et rapidement, Philippe m’a dit : «Mais pourquoi ne pas éditer une partition comme Mort d’un Pourri, film de ma rencontre avec Stan Getz ?» En l’occurrence, cette bande originale appartenait à Warner. Mais comme Warner ne l’exploitait pas, il était absurde de ne pas l’intégrer à la collection. Voilà comment les choses se sont faites. A l’ambition de départ s’est ajoutée une autre ambition, celle d’explorer d’autres territoires. Parfois de façon vraiment déterminée, parfois en se laissant porter par les évènements.
Quels sont tes meilleurs souvenirs, tes déceptions concernant ces dix dernières années ?
Evidemment, j’ai une mémoire plus fraîche sur les projets récents. Le jeu de piste pour retrouver les masters de The Concert John Barry restera un vrai grand souvenir. Universal Music Angleterre m’annonce que la bande est manquante à la référence correspondante. Qu’il y a un trou entre la 4001 et la 4003. A défaut, le service technique nous propose de nous fournir un 33 tours neuf, solution pas très satisfaisante sachant que les pressages Polydor anglais de l’époque ne sont pas forcément des références : le son des morceaux en fin de face est très limite (en l’occurrence The Adventurer) à cause de la compression du sillon. L’autre pays à avoir publié le 33 tours, c’était le Japon. En désespoir de cause, nous contactons alors Universal Tokyo en leur donnant la référence du 33 tours japonais. Réponse trois jours plus tard : «On a deux bandes en archive : la matrice japonaise et la matrice anglaise qui nous a été envoyée en 1973 pour faire notre matrice japonaise.» Depuis tout ce temps, la bande originale dormait dans un bunker, quelque part dans la banlieue de Tokyo ! Nous l’avons récupérée, remasterisée à Paris, puis renvoyée à Londres, où elle a retrouvé sa place dans la bandothèque de Polydor UK, trente-huit ans après ! Les bons moments, ce sont aussi les réenregistrements, seule solution face à l’absence définitive de support : Fantômas de Michel Magne, Week-End d’Antoine Duhamel…
Week-End était un réenregistrement ?
Oui, et l’aventure était assez unique parce que, en réalité, Duhamel avait profité de l’enregistrement d’une nouvelle musique de film, celle de L’Affaire Marcorelle, de Serge Le Péron. Le metteur en scène, lui-même ancien critique aux Cahiers du Cinéma, enfant de la Nouvelle Vague, souhaitait intégrer des extraits de la partition de Week-End dans son film. Donc, Duhamel s’est dit : «Autant en profiter pour écrire une musique originale avec exactement la même nomenclature orchestrale que Week-End». Du coup, ils ont pu enregistrer d’abord la musique originale du film et ensuite le Godard dans la foulée. Grand souvenir également pour le réenregistrement des van Parys (French Cancan, Casque d’Or) sous la baguette de Laurent Petitgirard ou encore Barbarella avec Jean-Claude Petit, expérience encore plus radicale. Jean-Claude Petit avait été orchestrateur pour Michel Magne, entre autres sur Barbarella. Quand j’ai retrouvé les bandes complètes de la musique composée par Michel Magne (et rejetée par Dino de Laurentiis), celle-ci contenait tous les morceaux… dont une jolie bossa nova pour orchestre sur laquelle on n’avait que le play-back. Le morceau était beau mais nu, puisque privé de ligne de chant. Donc Jean-Claude Petit s’est réapproprié ce matériel et, d’après le play-back, a inventé une mélodie. Et c’était très insolite comme expérience de studio : vous vous retrouvez dans le A de Guillaume Tell, dans lequel on peut accueillir quatre-vingt musiciens. Mais là, il y a juste Jean-Claude Petit au piano. Tout seul. On envoie le play-back, Jean-Claude l’a dans le casque et au piano, il joue le thème qu’il vient de composer. Ensuite, on mixe le play-back de 1968 avec une ligne de chant de 2007 ! Tout comme avec Michel Legrand qui pose sa voix sur le play-back des chansons de Parking : orchestre enregistré en 1985, voix en 2008. Comme une fusion du passé et du présent.
Il faut aussi mentionner la relecture des thèmes de L’Homme de Rio et des Tribulations d’un Chinois en Chine par Alexandre Desplat, héritier de Georges Delerue… notamment auprès de Philippe de Broca. Alexandre s’est notamment réapproprié le Thème d’Alexandrine, le thème d’amour des Tribulations, quelque part entre John Barry et le Spartacus d’Alex North. Alexandre a retraité Alexandrine pour combo de jazz, accompagné par le Traffic Quintet, avec au milieu avec un chorus de flûte. Il a ressorti sa flûte de l’époque du Conservatoire de Paris et il s’est lancé dans cette improvisation. Vous avez les bases enregistrées par le Traffic, il est 19h30 à Guillaume Tell, on baisse la lumière, Alexandre se lance dans ce chorus envoûtant, sur des harmonies très sophistiquées, presque paradisiaques… J’étais vraiment au bord de la panne de pacemaker ! (rires)
Les plus beaux souvenirs, ce sont aussi les rencontres. Dont certaines embuées de mélancolie, notamment avec des cinéastes qui ne sont plus là aujourd’hui. Claude Sautet, forcément. Sa dernière interview un jour d’été, en 2000, ajoutée en bonus audio à la fin du disque Sarde/Sautet. Un après-midi déchirant avec Philippe de Broca pour les deux disques consacrés à sa collaboration avec Georges Delerue. Pour réveiller sa mémoire, j’avais apporté des CD tests, pour lui faire écouter des extraits : «Tu te souviens de ce thème ? Quelle était son intention ?» Pour que les souvenirs soient plus précis. Et il se met à pleurer. Tout simplement parce que Delerue n’est plus là, qu’il mesure le temps écoulé : en écoutant ces musiques, il prend en plein visage des fragments de sa vie, de son passé. Et il mesure que cette double compilation, c’est une peu une compression musicale de sa carrière. Et pareil avec Jerry Goldsmith : je suis entré en contact avec lui pour Papillon, afin de réaliser un entretien, sur cette partition et son travail avec Franklin Schaffner. Ça n’a pas été possible car il était en traitement à ce moment-là. J’ai simplement eu le temps de lui envoyer un test du CD qu’il a validé, car nous avions intégré des thèmes qui n’étaient pas dans le montage du 33 tours original. C’est forcément émouvant quand vous recevez un fax de Goldsmith : «OK, c’est très bien. J’ai écouté. Cette musique, pour moi, c’est ce que j’ai fait de mieux dans le registre du lyrisme, en tout cas d’un certain lyrisme influencé par l’école française.» C’est toujours troublant de confronter un créateur à son œuvre, a fortiori quand on sait que le temps lui est compté.
Pas de déception alors ?
Ah si, des déceptions, il y en a aussi. Précisément, faire aboutir le projet Papillon mais sans pouvoir interviewer Goldsmith, c’est un immense regret. Autre aspect des choses, le droit moral qui, heureusement, protège en Europe le créateur, qui lui donne un droit de regard sur son œuvre. Quand, par exemple, on a élaboré le disque Martial Solal avec l’intégrale d’À Bout de Souffle, on s’est intéressés à une autre partition, d’esthétique complètement différente, écrite par Solal pour Jean-Pierre Melville, Léon Morin Prêtre, avec une musique pour orchestre, harmonica et orgue. Il n’y avait pas de bandes, pas de disque sorti à l’époque, pas de version internationale chez le producteur, personne n’avait de support. L’éditeur Bertrand Liechti, qui avait déjà financé le réenregistrement de Fantômas, me dit : «Pour Solal, compositeur important, je casse ma tirelire.» Martial Solal avait conservé sa partition et les éléments séparés. Il avait tout en archive, pupitre par pupitre, donc ce n’était pas la peine de payer un copiste pour établir le matériel d’orchestre. Dans un premier temps, Solal s’est montré enthousiaste : «Si l’éditeur est d’accord, oui, on peut réenregistrer à l’identique. Pour l’harmonica, j’ai même pensé à un jeune musicien étonnant, Olivier Ker Ourio.» Tout se met donc en marche jusqu’au jour où Solal m’appelle, un peu abattu: «Je viens de relire la partition et je suis assez déçu. Venant du jazz, c’était ma première expérience d’écriture pour orchestre : l’orchestration est parfois gauche, malhabile, patagauche. Si nous sortions l’enregistrement original, avec un son d’époque, je serais d’accord. Mais une prise de son actuelle va mettre en lumière toutes les maladresses harmoniques et orchestrales. C’est trop douloureux pour moi, d’autant que j’ai fait des progrès depuis. Il faut abandonner cette idée de réenregistrement !» J’ai insisté, lourdement, mais Martial n’a pas cédé. Refus catégorique.
D’autres compositeurs aussi ont refusé la sortie de leur album ou c’est un cas unique ?
Concernant un réenregistrement, oui, c’est la seule personne qui ait vraiment dit non. Sinon, Pierre Jansen, très proche de la musique contemporaine, a refusé catégoriquement certaines musiques dans son album autour de Claude Chabrol. Il a vraiment fallu que je lui colle une Kalachnikov dans le dos pour qu’il accepte d’inclure la musique de Docteur Popaul. Une partition assez morriconienne qu’il a appréhendée comme un exercice de style, un peu second degré. Belmondo sortait du Casse et Chabrol a dû lancer à Jansen : «J’aurais bien engagé Morricone !» Réaction de Pierre: «Je vais t’en faire du Morricone, ce n’est pas très compliqué !» C’est tellement un gag qu’il a violemment renâclé à l’intégrer au montage de l’album…
Sarde aussi, contrairement à ce que l’on pourrait penser, peut se montrer très intransigeant et sucrer les morceaux qui ne lui plaisent pas. Ou plus. Dans l’anthologie consacrée à Robin Davis, il y a des thèmes qu’il a sauvagement trappés, parfois à juste titre comme tous les titres rock de Hors-la-Loi. En revanche, dans Le Choc, il y avait deux morceaux be-bop qui n’étaient pas dans le 33 tours, mais que Etienne Chicot, qui incarnait dans le film un fan de jazz, écoutait en situation. Les morceaux étaient plutôt soignés mais Sarde les a virés sans l’ombre d’une hésitation : «Ça n’a rien à voir avec le reste du score. Une rythmique de jazz fusion, le son de Wayne Shorter mélangé au London Symphony… C’est autre chose, ça casse la continuité.» J’ai essayé de le convaincre, je trouvais précisément que ça apportait une autre couleur mais il n’a rien voulu entendre… J’ai respecté sa volonté : après tout, c’est lui le compositeur.
Certains morceaux sont justement parfois absents de certaines intégrales. C’est un choix éditorial ou plutôt celui du compositeur ? Ou une volonté de ne pas aller vers l’intégralité à chaque fois ?
A chaque cas de figure, la réponse est différente. Il y a par exemple une omission que l’on nous a parfois reprochée pour Le Locataire : une rumba bizarroïde pour trio de jazz et marimba, avec des harmonies très étranges, qui est en fait construite sur le «B» du générique. C’est une musique de source sur laquelle dansent Adjani et Polanski mais qui, comme la rumba de La Grande Bouffe, possède une dimension inquiétante, venimeuse… Elle a été mise en boîte à Paris, séparément de l’enregistrement londonien de la partition à proprement parler… et Sarde n’en avait pas gardé la bande, malheureusement. Difficile de convaincre l’éditeur de financer une séance complète juste pour une rumba d’une minute cinquante !
Autre cas, celui de Police Python 357. Je n’aurais pas été contre l’idée d’inclure d’autres morceaux : ils ne figuraient pas, hélas, sur les seules bandes en notre possession, incomplètes. Là encore, problème de conservation du matériel. Et les trois morceaux supplémentaires figurant sur la bande n’étaient que des découpes plus courtes du thème principal. Pour être complet et complétiste, devait-on ou non les inclure au montage de l’album ? En l’occurrence, c’est une décision qu’on a prise à trois, avec Colette Delerue et l’ingénieur du son, dont le regard nous apporte une certaine distance sur ces partitions : «Pourquoi mettre en version d’une minute vingt un thème déjà inclus dans sa version longue de trois minutes trente ?» Et par ailleurs, ça nous empêchait d’intégrer d’autres œuvres dont ce serait la seule possibilité d’exposition (Les Aveux les Plus Doux, Malpertuis, Paul et Virginie…). Alors on s’est dit : «Oublions !» Personnellement, j’ai eu un petit regret mais voilà, c’est un travail d’équipe.
En parlant d’intégrale, comment se fait-il que L’Homme de Rio se soit finalement retrouvé chez un éditeur américain ?
Il y a des statuts juridiques différents en fonction des pays : certains masters ont un propriétaire pour un premier territoire, un autre pour un second. L’Homme de Rio était un film co-produit par les Productions Ariane et les Artistes Associés. Pour la France, c’est Ariane et pour, notamment, les territoires nord-américains, ce sont les Artistes Associés, c’est-à-dire aujourd’hui MGM. Au départ, notre idée était de publier Les Tribulations d’un Chinois en Chine en version intégrale. Nous étions à 200% sur la même longueur d’onde avec Colette Delerue : L’Homme de Rio est une partition qui relève d’avantage de l’underscore, qui souligne vraiment tous les détails de l’action. C’est d’abord un travail de pure orchestration. Brillant, mais de pure orchestration. Dans Les Tribulations d’un Chinois en Chine, il y a plusieurs thèmes, clairs, lisibles, distincts, qu’on peut mémoriser : la valse du générique début, le thème de Mister Go, le thème d’Alexandrine dont on parlait tout à l’heure. Et donc avec Colette Delerue, on a voulu en faire une vraie intégrale, compte tenu du fait que nous avions localisé les bandes master complètes. Une fois l’album monté, sa durée s’élevait à 40-45 minutes. Du coup, pourquoi ne pas ajouter L’Homme de Rio ?
On a fait la demande aux Etats-Unis, mais la réponse a été : «On n’est pas sûr d’avoir les bandes. Les recherches vont prendre un peu de temps…» On a donc complété le CD avec le seul matériel à notre disposition sur L’Homme de Rio, c’est-à-dire la bande montée du 45 tours sorti à l’époque. Et à cela, une nouvelle idée s’est ajoutée quand Alexandre Desplat m’a dit : «Mais moi, j’ai toujours adoré le thème d’Alexandrine. Je voudrais l’enregistrer et ce serait un double hommage, à Delerue et de Broca.» Pour Alexandre, c’était une façon de tendre la main à travers les nuages à deux hommes qu’il a connus. L’un, compositeur, qui a été l’un de ses phares, Delerue ; l’autre, cinéaste, dont il a été l’un des derniers compositeurs. Comme la séance était d’environ trois ou quatre heures, finalement, Alexandre en a profité pour faire des relectures de L’Homme de Rio, de cette petite valse mélancolique qui clôt le film… et qui dure trente secondes dans le score original. Alexandre en a fait un truc à lui, l’a développée…
Donc ce disque-là, c’était davantage Les Tribulations d’un Chinois en Chine avec L’Homme de Rio en complément, plus l’hommage d’Alexandre Desplat au tandem Delerue / de Broca. Si on avait eu les bandes, on n’aurait pas couplé les deux bandes originales car cela nous aurait obligé à effectuer des coupes dans l’une et l’autre… mais nous aurions sans doute sorti ensuite une intégrale de L’Homme de Rio. Quand on m’a prévenu de la sortie de l’album Kritzerland, je m’en suis aussitôt réjoui : les bandes existaient dans les archives de la MGM et allaient être exploitées en version intégrale. Mon seul bémol, totalement subjectif, est le suivant : je crois que nous n’aurions pas monté l’album dans l’ordre du film. C’est un parti pris, bien sûr. C’est ma seule (petite) restriction car, quand la partition d’un film aussi mythique sort enfin, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde. L’enseignement de cette histoire est donc que tout se joue territoire par territoire. Pour nous, l’accès aux bandes des films européens est plus simple en Europe. Inversement, si des labels américains cherchent une bande précise en France, ils auront plus de mal car ils n’ont pas forcément les connexions sur place, ni le temps d’effectuer de longues fouilles. Même mon camarade espagnol Jose Benitez de Quartet Records a échoué à mettre la main depuis Madrid sur les bandes de Shout At The Devil (Parole d’Homme)… alors que je les avais localisées depuis dix ans. Il a dû faire appel au producteur James Fitzpatrick et utiliser d’autres sources, là où j’aurais pu lui fournir les masters, qui ont d’ailleurs servi pour les deux extraits figurant dans le coffret Maurice Jarre.
Plusieurs labels américains ont d’ailleurs essayé de trouver les bandes de Moonraker, partition qui a été enregistré à Paris…
Voilà une autre déception majeure… C’est quelque chose d’assez agaçant parce qu’il y a quelques années, les bandes de ce film auraient pu être sauvées. J’ai commencé à assister vers 1992 à des enregistrements au studio Davout, où Moonraker avait été enregistré. Il faut savoir que John Barry, à l’époque, avait passé deux ou trois mois à Paris pour écrire la musique du film, qui a été tourné et monté en France parce qu’il était coproduit par Eon et Artistes Associés France. En fait, les bandes multipistes complètes étaient restés à Davout. Et il y a un peu plus de quinze ans, Davout a envoyé une série de lettres à des producteurs et éditeurs de musique : «Vous êtes venus travailler chez nous autrefois. Nous avons ici une pièce remplie de bandes, certaines vous appartiennent peut-être. Si vous ne venez pas les chercher dans un délai de trois mois, les bandes non récupérées seront détruites.» Certains compositeurs, comme Vladimir Cosma ou Claude Bolling, ont légitimement foncé chez Davout pour sauver leur matériel. Voilà dans quelles conditions les bandes complètes de Moonraker ont disparu : personne de la MGM n’est allé les récupérer. Mais ses responsables ont-il bien reçu la lettre de Davout ? Je l’ignore. Car, dans l’intervalle, United Artist avait fermé son bureau à Paris et son catalogue avait été transféré à la MGM… Voilà comment Moonraker reste l’un des derniers Graals de John Barry, mais un Graal inaccessible, une chimère. A moins d’un réenregistrement, seule solution possible, cette musique ne peut être publiée en version intégrale.
A propos des regrets et des titres impossibles à sortir, dans l’interview de 2000, tu parles de René Cloërec. Et depuis la compilation Play Time que tu as faite en 1993, aucun titre ne lui a été consacré au sein de la collection…
C’est lié à une situation juridique complexe. S’il était né américain et avait travaillé pour un studio, René Cloërec aurait pu devenir l’équivalent d’un Waxman ou d’un Steiner. C’est un compositeur qui possède une écriture néo-romantique parfois un peu conventionnelle mais d’une grande puissance, d’une grande beauté d’inspiration, notamment dans l’expression du lyrisme, par exemple dans Le Diable au Corps, Le Rouge et le Noir ou Le Comte de Monte-Cristo. Je ne parle pas de son célébrissime indicatif pour Jean Mineur Publicité qui dure depuis cinquante ans ! Quand j’ai commencé à travailler avec Michel Legrand, on a parlé de Cloërec. C’était l’un des compositeurs qui l’avait le plus marqué. Et curieusement, il ne le connaissait pas, Cloërec s’étant très tôt retiré du métier. Un jour, j’ai mis sur pied un déjeuner, et Cloërec s’est retrouvé devant ce type dont il avait entendu parler autrefois par son pianiste de studio, Raoul Gola : «Tu sais, l’un de mes élèves est un petit prodige : s’il commence à mettre le doigt dans l’engrenage du cinéma, tu vas avoir de la concurrence !» Ce long déjeuner, entre un compositeur de l’Ancien Monde et un grand ambassadeur du nouveau a été un moment de grâce, très émouvant… J’aurais également aimé présenter à René Cloërec Bertrand Tavernier ou Pierre Tchernia, deux autres de ses admirateurs. Mais le temps m’a manqué… Sur Cloërec, malheureusement, il n’y a pas de support autre que ceux utilisés dans la compilation Play-Time en 1992. Il faudrait réenregistrer à l’identique… La situation est également complexe car Cloërec avait désigné comme titulaire de son droit moral des œuvres caritatives. Même si on fait un travail de lutte permanente contre la mémoire qui s’érode, contre le temps qui rétrécit, on sait que, dans le marché du disque actuel, sans aide publique ou Sacem, on aura du mal à équilibrer sur un album de Cloërec.
La charte graphique d’Ecoutez le cinéma !, qui est la même depuis le début, a ses admirateurs et ses détracteurs…
J’en profite pour souligner que la collection est le résultat d’un travail en commun, fruit de plusieurs étapes successives : il y a d’abord un studio de mastering, Art et Son, qui effectue tout le travail de restauration. Puis les graphistes, Jérôme Witz et Gilles Guerlet, présents depuis l’origine : ce sont eux qui ont forgé l’identité graphique d’Ecoutez le cinéma ! C’est un parti-pris, mais ils sont allés jusqu’au bout de ce parti-pris. Et puis le service juridique, étape décisive, avec Christelle d’Almeida, qui clarifie avec précision et opiniâtreté la situation juridique d’enregistrements souvent vieux de plusieurs décennies. A l’échelle du coffret Delerue, par exemple, qui rassemble quarante propriétaires différents, c’est un travail absolument titanesque. Quand Robert Mitchum disait de David Lean : «Travailler avec Lean, c’est comme construire le Taj Mahal avec des cure-dents», c’est un peu comparable à la tâche de Christelle ! La cohésion de cette équipe, inchangée depuis dix ans, est déterminante au sein du département Universal Classics & Jazz France.
Les graphistes, à l’image de l’ingénieur du son, apportent aussi un recul : ils n’ont pas forcément vu tous les films. Du coup, ils les visionnent, ils ont un œil neuf et apportent des idées auxquelles je n’aurais pas pensé. Ils font des propositions visuelles alternatives qui peuvent s’avérer meilleures que celles envisagées spontanément. Ce qui est curieux, c’est qu’au départ, on partait uniquement sur deux principes visuels : soit la collection primaire avec des affiches mises en situation dans un contexte qui évoque le film ou un des films, soit la collection dite Cube. Et puis, en cours de chemin, quand on a dû élaborer le disque Le Monde Électronique de François de Roubaix, qui n’entrait dans aucune case, on a imaginé cette troisième voie graphique, la collection Logo, avec le logo de la collection, qu’ils ont fait fabriquer en dur. Witz et Guerlet sont deux mecs qui travaillent en binôme, qui sont des esthètes, et qui aiment l’épure. Quand, par exemple, on fait Les Cavaliers (The Horsemen), l’affiche d’origine déclenche logiquement l’envie d’une image de désert, comme un appel à l’infini. Ou pour La Guerre du Feu, où ils peuvent encore jouer sur les espaces naturels. Ou encore le Resnais ou le Godard, par exemple dans la collection Logo. L’un qui est complètement noir, l’autre complètement blanc. Le logo central, quelques photos disposées et, en peu d’éléments, on raconte en raccourci l’univers d’un cinéaste. Je sais qu’ils ont une conception graphique qui est en contrepoint, en contraste total avec ce que l’on peut faire, notamment aux Etats-Unis. Mais je ne vois pas comment, après dix ans, on pourrait maintenant changer la charte. Et ce qui est assez étonnant d’ailleurs, c’est qu’on ait réussi à l’imposer à des compositeurs ou des metteurs en scène qui ont des personnalités aussi différentes.
Aucun compositeur n’a voulu imposer un style différent, ou sa griffe ?
Non. Mais, par exemple, pour le Concert John Barry, on a fait plusieurs essais de pochettes avec différentes couleurs et c’est Barry lui-même qui a choisi celle qu’il souhaitait. Sur Americans, on a fait différentes propositions graphiques et c’est lui qui a validé la pochette finale. Ce qui est logique : par le graphisme, on doit trouver un équivalent visuel au contenu musical de l’album. Surtout quand on est dans la collection Logo où la création est plus libre que dans la collection primaire, où il s’agit simplement de trouver un contexte précis pour y intégrer l’affiche d’origine. Et Jean-Jacques Annaud, qui connaissait le concept de la collection, m’a dit que c’était une idée forte et évidente d’insérer l’affiche de La Guerre du Feu en situation, dans un paysage de toundra. Non, il n’y a jamais eu de refus. Au contraire, il y a des compositeurs, ou des ayants droit, qui se sont vraiment impliqués : pour la conception de l’album hommage à Georges van Parys, sa petite-fille Natalie nous a apporté des crayons, un bout de partition, une photo originale de van Parys, son chronomètre, celui avec lequel il avait déterminé les minutages de Casque d’Or. Tous ces éléments, issus des archives van Parys, ont permis de composer la pochette. Certains compositeurs sont venus directement à l’atelier des graphistes, pour se faire tirer le portrait, par exemple Eric Demarsan ou Antoine Duhamel. Antoine était sidéré par la rapidité du processus : on le prend en photo, on fait la sélection de celle qui lui plait le plus et, en direct, on l’intègre sur le recto. Et là, Duhamel, il voit la pochette de sa deuxième anthologie prendre forme en temps réel. Ça a duré une heure : il était ahuri !
Et concernant les boîtiers cristal, qui ont récemment remplacé les digipacks ?
Alors là, on va entrer dans des aspects moins excitants que la recherche de bandes perdues ou le fait d’aller passer un après-midi avec John Barry ou Lalo Schifrin. Ce sont simplement des questions d’économie globale. Les coûts de fabrication des digipacks, dans le contexte du marché du disque actuel, sont beaucoup plus lourds aujourd’hui qu’ils ne l’étaient à l’époque. On fabrique moins de digipacks et cela coûte plus cher. L’autre déclic, c’est le Japon. Dès 2001, mon camarade Takayuki Hamada a fait sortir chez Universal Japon plusieurs albums de la collection, notamment une salve de douze albums à l’automne 2009. Là-bas, tous sont sortis en boîtier cristal. Ils ont fait aussi un truc assez étonnant, une compilation Ecoutez le Cinéma Jazz uniquement destinée au marché japonais : Jimmy Smith, Stéphane Grappelli, Martial Solal, Claude Bolling… Donc une compilation et douze volumes en boîtier cristal : Plein soleil, Mort d’un Pourri, Les Tribulations d’un Chinois en Chine, ce qui représente une opération d’une certaine ampleur pour le marché japonais. Et ils nous ont dit : «Tout cela nous coûte cher. Si vous aviez fabriqués vos albums en cristal, on aurait pu les importer directement, en leur intégrant des livrets additionnels en japonais.» Donc, en considérant le fait que ce soit beaucoup moins cher de fabriquer en cristal, plus l’export au Japon et dans les pays anglo-saxons, on s’est dit que ça allait nous faciliter la vie de fabriquer directement en cristal. Pendant longtemps, on s’est dit qu’il fallait conserver la collection en digipack, que c’était l’une de ses caractéristiques, que passer au cristal risquait de créer une rupture. Mais si la rupture nous permet de durer plus longtemps, c’est en même temps l’option de la sagesse. Et, paradoxalement, beaucoup de fans de la collection, notamment des étrangers, ont salué le passage au cristal, ce à quoi je ne m’attendais pas.
Est-ce que tous les volumes sont tirés au même nombre d’exemplaires ?
Oui, ils sont tous tirés au départ à 2 500 exemplaires. Et globalement ils ont tous eu droit à un retirage, ils ont tous dépassé le tirage initial. Mais certains sont uniquement au deuxième retirage alors que d’autres en sont évidemment au troisième, quatrième. Evidemment, surtout ceux parmi les premiers car plus ils sont anciens et plus les ventes sont élevées. Ils ont le cumul de quasiment dix ans pour les premiers et forcément, ils ont des retirages supérieurs, mettons à celui des Cavaliers qui pour l’instant, quelques mois après sa sortie, en est encore à son premier tirage.
Ce qui veut dire que même les premiers numéros de la collection continuent à se vendre encore maintenant ?
Lorsqu’il y a une pub avec le thème de Camille du Mépris, les gens achètent l’album concerné. Par exemple, quand Gaumont ressort en Blu-ray Les Tontons Flingueurs ou quand La Folie des Grandeurs passe pour les fêtes sur France 2, ça réactive les ventes. Et puis il y a toujours des partenariats avec certains magasins pour organiser des opérations commerciales sur l’ensemble de la collection. Tout se tient. Ce qui fait vendre globalement une collection, ce sont aussi les nouveautés. Une collection qui n’est pas réactivée par des nouvelles publications finit par disparaître d’elle-même. Ce qui se produit sur certaines collections de bandes dessinées. Si elle n’avait pas signé un accord avec Spielberg pour Tintin, je pense que la famille Hergé aurait vu au fil du temps les ventes des albums se réduire, parce qu’on ne peut pas réactiver auprès des nouvelles générations une collection, aussi mythique soit-elle, sans nouveautés… Ce sont des logiques de marketing absolument imparables. Concernant Ecoutez le cinéma !, il y a encore tellement de choses à entreprendre. Par exemple, l’exploration récente des archives de Maurice Jarre a amené plusieurs idées assez évidentes… Ça semble sans fin. Mais malheureusement, tout dans la vie est éphémère : il faut avoir la sagesse de savoir qu’un jour il y aura une fin.
 Concernant le côté juridique, les recherches de bande… C’est plus facile qu’il y a dix ans ?
Concernant le côté juridique, les recherches de bande… C’est plus facile qu’il y a dix ans ?
L’avantage, sans fausse modestie, lorsqu’il s’agit de mettre en route un projet avec un compositeur qui n’est pas encore représenté dans Ecoutez le cinéma !, c’est que nous disposons de certaines cartes de visite. Philippe Sarde dit tout le temps : «C’est la pléiade, cette collection ! Enfin, surtout mes albums !» (rires) La façon dont la collection s’est étoffée, développé sur la durée plaide pour elle-même, surtout sur des projets ambitieux hors normes, compliqués comme le coffret six CD Georges Delerue, coffret qui n’est d’ailleurs pas exempt d’erreurs. A posteriori, pour faire un peu d’autocritique, je crois que ça a été une erreur (commerciale, pas artistique) de ne pas y inclure les standards du compositeur. Nous avons vraiment voulu privilégier des œuvres plus secrètes, plus enfouies, plus souterraines. Résultat, ça nous a privés d’un certain public, à la recherche d’une synthèse idéale de Delerue, et qui n’a pas compris pourquoi ce coffret ne contenait pas Le Mépris, La Nuit Américaine ou Le Dernier Métro.
Tu as déjà exploré de nombreuses pistes… Peut-il y avoir encore de bonnes surprises à trouver ?
Il y a toujours des choses à trouver, à localiser. L’Antarctique de François de Roubaix pour Cousteau, vraiment, c’était une grande découverte de musique inédite. Très expérimental. Et quand on compare ce que Delerue et John Scott ont fait pour Cousteau ensuite, on peut comprendre pourquoi Cousteau a rejeté la partition barrée de l’ami de Roubaix. Et quand Delerue écrit Le Nil et Le Testament de l’Île de Pâques, il est conscient de là où il met les pieds. Il connaissait ce qui était arrivé à de Roubaix, il savait jusqu’où aller trop loin. Non, comme dirait l’autre : «Tout reste encore à faire.»
Est-ce qu’internet joue un rôle particulier dans ton travail ?
Au début de la collection, internet existait, mais à un état embryonnaire. Dix ans plus tard, on se rend compte que tout va tellement vite. Une information à peine soufflée, murmurée, à Paris ou Caracas se retrouve sur des blogs américains qui eux-mêmes fédèrent des fans du monde entier. Donc, bien sûr, internet influe dans un sens, bon ou mauvais d’ailleurs. Une information non vérifiée ou un sentiment purement subjectif peuvent très vite devenir une réalité, qui se démultiplie, qui prend une ampleur démesurée, qui déclenche des réactions en chaîne. Dans internet, y a le bon et le mauvais, l’avantage d’une communication planétaire immédiate et le risque, en même temps, qu’un détail anecdotique déclenche une sur-réaction, totalement disproportionnée, parfois fondée sur une source erronée.
Es-tu à l’écoute des internautes sur ce qu’ils pensent des disques de la collection ? Et sur ce qu’ils aimeraient voir édité ?
Evidemment. Normalement, Universal Music va créer un site pour Ecoutez le cinéma ! sur lequel on pourra communiquer, annoncer les nouveautés. On ne sait pas encore s’il faut y intégrer un forum. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est un vrai retour sur les publications, connaître les attentes des adeptes de la collection… Il est parfois frustrant de passer des semaines, des mois voire des années sur un projet et de ne pas avoir de commentaires précis. Le coffret Delerue a nécessité deux ans : deux ans pendant lesquels vous construisez, progressivement, étape par étape, cette espèce de cathédrale. Et c’est toujours frustrant de ne pas avoir un retour précis. Parce que, à force de connaître les disques par cœur, on ne les entend plus. Une absence totale de recul finit par s’installer. Et c’est toujours intéressant d’avoir le point de vue d’auditeurs qui, eux, ont un regard neuf, vierge sur votre travail. Sur le coffret Delerue, ça a été une semi déception de ne pas avoir plus de réactions sur la suite inédite de La Foire des Ténèbres (Something Wicked This Way Comes). Avec Colette Delerue, nous avons suivi un long parcours du combattant pour avoir l’autorisation de Disney. Nous avons mis l’énergie du désespoir pour retrouver le matériel, construire cette suite, qui est différente de celle des Londons Sessions, convaincre Disney de donner son accord, ce qui n’était pas gagné d’avance. Cette partition, c’est un Graal, reconnu comme tel. Eu égard aux efforts déployés, nous aurions aimé avoir plus d’avis sur ce trophée qui, pour nous, est le joyau noir de ce coffret.
Alors aujourd’hui, l’édition de ce score dans son intégralité paraît impossible ou rien n’est jamais impossible ?
Non, pas forcément. Il est arrivé tellement de choses à priori impossibles. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte et qu’on ne contrôle pas. Si vous me disiez demain : «Telle partition de Philippe Sarde, est-ce dans l’ordre du possible ou pas ?» Et je pourrais tout de suite vous dire si la bande existe et si Philippe accepte qu’on s’y colle. Quand on est, notamment, dans le domaine des partitions rejetées sur des productions américaines, il est toujours difficile de deviner de quel côté la balance va pencher. Car, aux Etats-Unis, le compositeur est payé par une société qui devient ensuite entièrement propriétaire de l’œuvre musicale. Son contrôle échappe totalement au créateur. L’implication dans les projets de réédition des compositeurs (ou de leurs ayants droit) n’est pas un argument aux yeux des majors hollywoodiennes.
Pour finir avec internet, est-ce que tu as envisagé, puisque tu parlais de ne pas avoir assez de retour sur ton travail de la part des amateurs, de dialoguer avec eux par l’intermédiaire du net ?
Une précision : le contenu du disque, ce n’est pas mon travail mais d’abord celui du compositeur. Nous sommes là pour le servir. Quant à intervenir sur les forums, j’y ai songé plusieurs fois. Notamment quand certains reproches me semblent injustes, quand certains béophiles ne mesurent pas le chemin de croix effectué pour arriver à tel résultat, qu’ils oublient les contingences auxquelles nous sommes confrontés… Vous savez, on ne peut pas inventer des années plus tard une bande qui n’a pas été conservée à l’époque. On ne peut pas refaire le son du seul support existant sur un enregistrement, faire un son d’aujourd’hui avec une bande quart-de-pouce mono 19 de 1962. Donc certaines critiques, sincères mais injustifiées, peuvent donner la tentation d’intervenir. Mais en ce qui me concerne, et contrairement à d’autres producteurs, je n’ai jamais plongé : j’ai toujours craint que ça ne calme pas le jeu, que ça déclenche une surenchère, un tsunami de questions supplémentaires, en me mettant dans une situation où je sois plus obligé de me justifier qu’autre chose.
Concernant le marché plus général de la musique de film, en France et même au niveau mondial, est-ce que cela a évolué depuis que tu as commencé à sortir des disques ? Est-ce que cela à beaucoup changé ? Au sein de la collection mais aussi sur les disques hors collection, les titres plus contemporains ?
Il y a du positif et du négatif. Le positif, c’est qu’une nouvelle génération de compositeurs a, malgré tout, réussi à s’imposer dans les limites du contexte, à savoir la gangrène de la synchro excessive. Parce qu’il y a des synchros qui sont justifiées, légitimes et intelligentes. Mais je déplore que les cinéastes n’osent pas davantage confier leurs films au regard d’un compositeur qui va leur offrir une œuvre musicale originale Etant donné ces conditions, ça me réjouit de voir Alexandre Desplat prendre son envol et s’imposer à un niveau international, sans parler de Philippe Rombi et Bruno Coulais. Rombi, je l’ai connu quand il était élève d’Antoine Duhamel : je l’ai vu pour la première fois de ma vie chez Antoine, en 1993. Et j’ai rencontré Alexandre en 1994 lors d’un hommage à George Delerue au Puy-du-Fou, il venait d’écrire la musique de Regarde les Hommes Tomber. C’est étrange, d’ailleurs : se rencontrer grâce à Delerue, qui n’était plus là depuis deux ans. Il y a aussi d’autres jeunes compositeurs doués comme Pierre Adenot, Jean-Michel Bernard, Krishna Levy ou Béatrice Thiriet qui oeuvrent sur des films intéressants.
Le négatif, c’est de constater que le marché du disque s’est effondré. Sur la musique de film, disons de répertoire, c’est beaucoup moins flagrant : c’est malgré tout une niche. Aujourd’hui, on ne vend pas moins de disques d’une réédition de John Barry qu’il y a six ou sept ans. C’est plutôt la grande consommation du disque qui a pris du plomb dans l’aile. La différence, c’est qu’il est beaucoup plus difficile d’arriver à imposer une nouvelle bande originale qu’une réédition. Parce que sur une réédition, on sait quel est le parcours du film et de sa partition, la trace qu’ils ont laissée dans la mémoire collective, la demande qu’ils suscitent, en fonction de la notoriété du compositeur. Alors que sur une nouveauté, c’est une prise de risque plus grande : le marché est très aléatoire, on ignore quel sera le résultat du film en salles. A une époque, au début de la collection, on sortait pas mal de nouveautés, comme des tirés à part. C’étaient des titres hors collection, mais de compositeurs reliés à Ecoutez le cinéma ! Quand Sarde, Legrand, Duhamel ou Demarsan travaillaient sur de nouvelles partitions, on en publiait les disques. Cette année, si nous sortons la bande originale de La Princesse de Montpensier, par fidélité à Sarde et Bertrand Tavernier, c’est littéralement une exception.
Y a-t-il des partitions que tu as regretté ne pas voir sortir, ou que tu n’as pas pu sortir ?
Il y a certaines partitions d’Alexandre dont j’aurais adoré publier les albums. Soit elles ne sont pas sorties du tout, parce que le film était un peu risqué, soit c’étaient des films américains et l’accord s’est fait directement avec des labels américains. En fait, très franchement, c’est un peu douloureux, quand on compare la production actuelle de musique de film et celle, mettons, des soixante-dix. Sur la seule année 1976, on peut se dire : «Mais en l’espace d’un mois, on a eu dix partitions décisives, qui vont compter dans l’histoire de la musique pour l’image !» Souvent, je regarde Le Film Français, les affiches des films qui sortent : mais qui a composé la musique ? Quel est le compositeur ? Et souvent je me dis : «Qu’est-ce qu’il va en rester de tout ça dans vingt ou trente ans ?» Quand devant OSS 117 par exemple, on reconnaît le temp-track, notamment le fameux Jim On The Move de Lalo Schifrin, on peut être en colère. Pourquoi n’a-t-on pas laissé le compositeur s’exprimer, écrire une musique à la première personne, plutôt qu’un simple copier-coller ?
Tu as sorti deux titres en téléchargement. Quel est le bilan de cette tentative ?
L’idée sur Ecoutez le Cinéma !, c’est de concevoir des albums ou des concepts d’albums originaux à destination exclusive du téléchargement. Car il y a certaines bandes originales sur lesquelles on ne fera jamais d’albums physiques : le marché ne permettrait pas de les amortir. Mais on peut parfaitement les sortir en téléchargement. Et puis, on peut aussi trouver des idées originales, des concepts nouveaux, différents, d’albums qui seront uniquement virtuels. Et ça, j’ai commencé à y travailler. Ce sera l’un des prochains chantiers de la collection. Par exemple j’ai retrouvé des masters sur Jean Marion, ses musiques de capes et d’épées pour André Hunebelle… Si on sortait l’album, on en vendrait peut-être 600. Mais en téléchargement, ça limite la casse, le risque est moindre.
Et tu penses que les amateurs de musiques de films, qui sont aussi souvent collectionneurs, vont suivre ? Est-ce que la collection Ecoutez le cinéma ! peut un jour complètement basculer dans le téléchargement uniquement ?
Je l’ignore, je ne suis pas le Paco Rabanne du disque. A la base, on est tous fans de musique de film, on est matérialistes, et le support a son importance. Mais, en même temps, entre une œuvre en téléchargement et rien du tout, il vaut mieux un téléchargement.
Donc aujourd’hui, c’est plus qu’une réflexion ?
Ah oui, bien sûr. Ce n’est pas moi uniquement qui décide des choix d’avenir. Il y a un responsable du département, Yann Ollivier, un responsable du marketing, Pascal Bod, avec lesquels on organise des réunions. On décide de ce que l’on a envie de faire, mais on tient également compte de l’économie générale et du marché…
C’était la fête de la musique la semaine dernière, qui visiblement ne prête pas grand intérêt à la musique de film. En particulier dans tout ce qui est organisé à un niveau officiel… Il y a eu une année un peu plus dédiée à la musique de film, soit disant, il y a deux ans, centenaire oblige mais déjà, il n’y a pas eu grand chose et le reste du temps, il n’y a rien…
C’est vrai mais, malgré tout, on parle davantage de musique de film qu’il y a vingt ans : Auxerre a existé pendant neuf ans, La Leçon de Musique du Festival de Cannes a accueilli Schifrin, Doyle, Desplat et Shore, la Cinémathèque Française organise des hommages à des compositeurs, les sites se développent, dont le vôtre… Donc la musique de film existe quand même. Mais au niveau des institutions, il y a encore beaucoup de choses à faire. Regardez la confusion qui règne autour des conditions d’attribution du César de la meilleure musique de film ! Faire évoluer les mentalités de façon durable, c’est difficile : il suffit qu’il y ait un responsable, un jour, qui ait une sensibilité particulière à la musique de film, il lance une opération puis trois ans plus tard, son mandat s’arrête, il va ailleurs et il faut tout recommencer. Moi ça m’inspire à la fois l’envie de faire bouger les lignes et, en même temps, une forme de découragement. Il faut être fataliste par rapport aux choses sur lesquelles on ne peut avoir aucune influence. Alors que sur la collection, sur le fait de choisir d’éditer certaines œuvres, on a une maison de disques qui a enclenché le processus depuis dix ans, on peut entreprendre des projets. Donc, faisons-le à ce niveau là. Peut-être que quand Ecoutez le cinéma ! n’existera plus, il sera assez temps pour faire autre chose à ce moment-là. Je ne sais pas encore…
Es-tu en relation avec les autres labels ?
Non, pas vraiment. Je les connais peu. Mon seul grand ami américain, c’est Jon Burlingame, historien et journaliste spécialisé, qui écrit notamment pour Variety et le New York Times. J’ai rencontré Lukas Kendall car le studio où j’ai fait les copies des bandes pour le coffret Jarre était voisin de son bureau, à Los Angeles ! Et Lukas a eu la gentillesse d’intervenir auprès de la Paramount pour accélérer leur accord sur l’utilisation des bandes originales Paramount de Maurice. Sinon, j’ai fait la connaissance à Gand de Robert Townson, à l’enthousiasme communicatif. Et, depuis peu, je développe une très bonne relation avec Jose Benitez qui, sur son label espagnol Quartet, a effectué quelques sorties spectaculaires.
Ont-ils édité des CD que tu aurais bien aimé avoir faits ?
Je suis admiratif du travail de Lukas sur les Schifrin ou, évidemment, de Robert sur le coffret Spartacus, une véritable somme. Quant à Jose, parvenir un dégoter les bandes d’un Panthère Rose inédit signé Mancini, c’est également un magnifique trophée de chasse.
Il y a des précédents de collaborations inter-labels comme FSM et Intrada pour Ice Pirates et FSM et Kritzerland pour Islands In The Stream où Kendall avait les droits pour sortir le CD et Bruce Kimmel, l’unique bande originale restante…
Je n’ai jamais connu ce genre de situation. En Europe, quand un compositeur souhaite qu’une musique de film sorte sur un label précis, a fortiori s’il en possède les bandes, sa volonté et son droit moral doivent être respectés. La situation est vite réglée, d’autant qu’en France, Ecoutez le cinéma ! n’a pas de concurrence concernant l’exploitation discographique du patrimoine. Seule nuance : sur Les Félins, nous nous sommes répartis les territoires, entre d’un côté Universal et, de l’autre, Aleph, la société de Lalo et Donna Schifrin. Mais nous avons été chronologiquement les premiers à publier l’album.
 Que nous réservent les dix prochaines années ?
Que nous réservent les dix prochaines années ?
Beaucoup de découvertes de bandes, dont celles de Moonraker (rires) ! Je fais confiance aux rencontres, aux circonstances, aux imprévus pour nous amener à mettre la main sur de futurs trésors. Le long-box Le Cinéma de Maurice Jarre qui sort cet automne en contient déjà pas mal : qui aurait un jour pensé trouver dans un même coffret les versions originales de Topaz (L’Etau), El Condor, The MacKintosh Man (Le Piège), The Island At The Top Of The World (L’Île sur le Toit du Monde), sans parler de séances de travail avec Hitchcock, David Lean ou John Huston ? Non, sérieusement, nous avons un planning chargé pour les prochains mois, avec pas mal de surprises à la clé… et un double CD compilation prometteur, grâce au récent partenariat avec Radio Classique, qui se montre très motivée envers la collection. Que vous dire d’autre ? On se revoit dans dix ans pour un deuxième bilan ?
Entretien réalisé le 27 juin 2010 par Olivier Desbrosses & Olivier Rouyer
Transcription : Olivier Rouyer
Illustrations : © Universal Music France | Olivier Desbrosses
Remerciements à Stéphane Lerouge pour sa disponibilité et sa passion insatiable pour la musique de film.