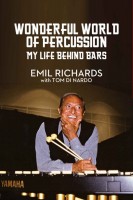 WONDERFUL WORLD OF PERCUSSIONS: MY LIFE BEHIND BARS (2013)
WONDERFUL WORLD OF PERCUSSIONS: MY LIFE BEHIND BARS (2013)
Auteurs : Emil Richards & Tom Di Nardo
Langue : Anglais
Format : Broché | 250 pages
Éditeur : BearManor Media
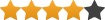
Rares sont les musiciens d’orchestre à Hollywood qui peuvent s’enorgueillir d’une authentique notoriété auprès d’un public, même restreint, d’avertis. Emil Richards est incontestablement de ceux-là. Qui parmi nous n’a en effet jamais relevé la récurrence de son nom au bout des pourtant très longues listes d’instrumentistes de l’American Federation of Musicians crédités dans bon nombre de livrets (rééditions et nouveautés confondues), en particulier depuis que la mention imposée de la composition exacte des ensembles est devenu une pratique courante ?
Il est parfois considéré qu’un percussionniste tient une place bien singulière au sein d’un orchestre. Non qu’un violoniste ou un trompettiste ne puisse pareillement se distinguer lui aussi, pour peu que ses qualités de solistes soient recherchées, mais la richesse de l’éventail de moyens à sa disposition et la variété des sonorités qu’il peut donc être amené à fournir confère au percussionniste une position qui attire et séduit presque immanquablement. Par ailleurs, cette diversité instrumentale est presque naturellement le signe d’une diversité de styles et de répertoires. La carrière d’Emil Richards est de fait loin de n’être que celle d’un « simple » musicien d’orchestre et cette courte autobiographie, co-écrite avec son complice Tom Di Nardo et joliment intitulée Wonderful World Of Percussion: My Life Behind Bars, se charge de nous détailler un parcours incroyable dont le prologue nous amène près de vingt ans avant sa naissance avec le périple proprement rocambolesque de son père qui mènera celui-ci, sur fond de meurtre passionnel et de vengeance, du petit village de Percosansonesco en Italie à la ville d’Hartford dans le Connecticut. C’est en 1938, tandis que son frère aîné se voit offrir un accordéon, que le jeune Emilio Radocchia choisit, par hasard, son premier xylophone : « Je veux ça ! » affirme-t-il en pointant du doigt le plus gros et le plus proche instrument de musique de la boutique. « Pour soixante-cinq dollars, j’ai eu le xylo, une paire de maillets, et six mois de leçons hebdomadaires. » En quelques secondes, un enfant âgé d’à peine six ans jette ainsi les fondations d’une vocation qui ne cessera de s’épanouir et le mènera au sommet de son art.
Ainsi qu’on peut s’y attendre, le livre se présente comme un recueil chronologique de souvenirs sobrement illustré, organisé par décades, et dont l’aspect rédactionnel quelque peu brut semble parfois adopter le ton d’une simple conversation orale. La mémoire n’étant du reste pas infaillible, le résultat n’évite pas les confusions, la réitération de certaines anecdotes et les petites coquilles par ci par là, notamment lorsqu’il s’agit de réattribuer chaque partition à son compositeur : ainsi par exemple Danny Elfman se voit-il gratifier de l’entière paternité des musiques de Howard The Duck et Ghostbusters II (SOS Fantômes 2) tandis que l’on doit apparemment à John Williams celles d’Airplane (Y a-t-il un Pilote dans l’Avion ?) et de Beyond The Poseidon Adventure (Le Dernier Secret du Poséidon). Faute d’un pointage systématique de chacune des informations livrées (et il y en a pléthore), il faut donc prendre pour argent comptant tout celles concernant d’autres éléments plus difficilement vérifiables.
On pardonnera néanmoins facilement ces menus désagréments à la lecture tant la carrière d’Emil Richards est proprement fascinante. Fortement marquée par le jazz (comme souvent chez les percussionnistes américains), elle est en effet d’une richesse extrême, chaque page de ce livre relatant à l’envi opportunités et rencontres, du chef d’orchestre Arthur Fiedler invité à diriger le Hartford Symphony au crooner Frank Sinatra qu’il accompagnera en tournée de 1959 à 1972, de Frank Zappa à George Harrison qui figurent tous deux parmi ses plus proches amis, du pionnier de la microtonalité Harry Partch dont il est extrêmement fier d’avoir été le disciple à Igor Stravinsky devant lequel, en 1969, il prend part à une singulière version des Noces, datée de 1919, pour deux cymbalums, harmonium, piano mécanique et percussions. A compter de son premier enregistrement professionnel en 1956 avec Stu Phillips, qu’il croise deux ans plus tôt lors de son service au sein d’un band de l’armée américaine au Japon, les noms défilent à toute vitesse jusqu’à nos jours : Charlie Mingus, Bing Crosby, Toots Thielemans, les Beach Boys, Dean Martin, Dionne Warwick, Lionel Hampton, Diana Ross, Michael Jackson, Ravi Shankar, Diana Krall… Stop ! C’est bien simple : la liste des artistes, chanteurs et musiciens de tous horizons géographiques et de tous milieux musicaux, avec lesquels il a enregistré pendant près de soixante ans, paraît à ce point infinie qu’il serait fastidieux d’en faire ici un inventaire complet. Et parmi eux, bien entendu, une tripotée de compositeurs hollywoodiens pour une plus grande somme encore de partitions pour le cinéma et la télévision.
Les percussions asiatiques de la série Kung Fu ? C’est lui. Les bols de salade renversés pour le Planet Of The Apes (La Planète des Singes) de Jerry Goldsmith ? Encore lui. Le xylophone endiablé du thème des Simpsons de Danny Elfman ? Toujours lui. Les tambours africains du Amistad de John Williams ? Devinez quoi… Au plus fort de sa carrière pour l’écran, ce ne sont pas moins de 35 à 40 compositions par an auxquelles Richards apporte sa contribution de musicien, parfois d’une manière très active. Sa passion et sa carrière l’ont en effet amené à constituer très vite l’une des plus grandes collections privées d’instruments à percussion, profitant entre autres de la soute des avions pendant une tournée mondiale de Sinatra en 1962, de sa longue lune de miel en 1972 avec Céleste, sa seconde épouse, ou de vacances passées en Amérique Latine en 1974 : en tout plus de 750 pièces rapportées d’innombrables pays, une chasse inoffensive mais insatiable (et, on l’imagine, bien encombrante) qui ne trouvera sa limite qu’en une occasion, au Tibet, lorsque le musicien renoncera à rapporter un tambour de prière et une trompette formés d’ossements et de peaux humains !
« Au regard du temps et de l’argent investis dans ma collection, il était vraiment gratifiant pour moi de voir des compositeurs venir les examiner et demander de quelle manière ils sont utilisés, comment écrire pour eux, et quels rythmes sont employés dans les pays d’où ils sont issus. » Henry Mancini en recherche d’instruments Inuits, Maurice Jarre lorgnant sur son cymbalum, Bill Conti réclamant tout un panel de wadaikos, Jerry Goldsmith faisant son marché au milieu de tout ce que le musicien possède de congolais, Lalo Schifrin réclamant qu’il apporte une trentaine de balais pour sa section de cordes, Emil Richards prend un plaisir légitime à citer tous ceux qui, pour une unique visite ou très régulièrement, ont fait un petit (dé)tour sous son toit pour bénéficier de sa collection, de ses connaissances, de son expertise. Sur nombre d’entre eux il livre de brèves impressions (Dave Grusin est l’un de ses compositeurs préférés, il admire grandement Alex North et Elmer Bernstein et apprécie particulièrement de jouer pour Lalo Schifrin) et parfois de légères mais bien savoureuses anecdotes : « Quand je suis arrivé dans la place, John Williams Jr. était pianiste aux studios, et quand il est devenu compositeur, son père jouait les timbales pendant ses sessions. Lorsqu’il dirigeait et avait quelque chose à préciser à son père, il disait : « Oh, timbales, à la mesure sept, donnez-moi un forte. » Deux des autres fils étaient aussi percussionnistes (…) et ils m’ont raconté qu’à Noël, John senior envoyait à John junior une carte signée « Love, Mom and Timpani ».
Plus instructif, on apprend également, exemple parmi d’autres, que John Barry et Sydney Pollack lui ont accordé toute confiance pour décider des instruments et rythmes à apposer sur une séquence entière de Out Of Africa. Michael Kamen effectuera une démarche similaire sur Lethal Weapon (L’Arme Fatale), lui demandant d’écrire un segment complet pour percussions avant de s’en emparer et l’habiller de l’orchestre, le compositeur reversant même au musicien en remerciement les royalties pour ce morceau : « Cela arrive occasionnellement, et il est toujours satisfaisant d’être amené à sortir du cadre de la partition écrite et être quelque peu créatif ». Il évoque aussi ses relations avec ses collègues instrumentistes, en particulier Shelly Manne et Joe Porcaro, un ami d’enfance dont le fils Jeff, fondateur du groupe Toto, deviendra d’ailleurs son filleul, et s’attarde brièvement sur sa seule et unique partition pour l’écran en tant que compositeur, pour un petit film sur le surf aujourd’hui oublié et intitulé Stoked, The Wave People, recevant à cette occasion le soutien d’un certain Hugo Friedhofer alors dans ses dernières années de vie.
Malgré les quelques réserves qu’on peut formuler sur le style, pas toujours fluide sans être pour autant fastidieux, et les approximations, on ne peut que conseiller à tous les férus de musique et de cinéma de se procurer cette petite autobiographie foisonnante (complétée par plusieurs appendices dont un cataloguant les étendues de près de 650 percussions différentes), ne serait-ce que pour élargir leur vision du monde musical hollywoodien côté coulisses. De derrière sa famille instrumentale, Emil Richards en aura été l’un des acteurs et témoins privilégiés dès le début des années 60 (il initiera même alors la renégociation des contrats des percussionnistes auprès des grands studios) et, encore aujourd’hui, il est une personnalité influente et indispensable aux yeux de nombre de compositeurs tels que Danny Elfman et Michael Giacchino, figurant d’ailleurs encore au générique du tout récent Dawn Of The Planet Of The Apes (La Planète des Singes : l’Affrontement). Inscrit au tableau d’honneur de la Percussive Arts Society entre Buddy Rich et Max Roach (« pas en mauvaise compagnie » dit-il non sans malice), Emil Richards s’impose tout bonnement au sein du paysage musical américain comme l’égal hollywoodien d’un Michael Bookspan à l’Orchestre de Philadelphie ou d’un Arnie Lang au New York Philharmonic : un virtuose, un maître, une légende.












