 BERNARD HERRMANN, UN GÉNIE DE LA MUSIQUE DE FILM (2016)
BERNARD HERRMANN, UN GÉNIE DE LA MUSIQUE DE FILM (2016)
Auteur : Vincent Haegele
Langue : Français
Format : Broché | 204 pages
Éditeur : Minerve
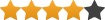
A l’occasion de la sortie aux éditions Minerve de la première biographie en langue française consacrée à Bernard Herrmann, son auteur Vincent Haegele nous invite à replonger dans l’œuvre complète de ce grand compositeur de musique de film dont nous avons, il faut bien l’avouer, souvent méconnu le travail, tant il pouvait rester dans l’ombre des grands noms tels que Hitchcock, Welles, Mankiewicz, ou du moins, dont nous avons connu la musique sans le savoir. Avec cet exceptionnel ouvrage, nous avons enfin la possibilité de reconnaître à sa juste mesure la musique de Bernard Herrmann grâce à la vue d’ensemble que nous offre l’auteur, avec autant de sérieux que de passion. Si, après cette lecture, nous retournons vers les films mis en musique par Herrmann, ses partitions feront immanquablement apparaître le film sous un jour nouveau, car sa composition n’est pas une simple musique platement soumise au film, comme le démontre abondamment toute cette biographie, mais elle en fait partie, participe expressivement et structurellement au film.
Nous constaterons au fil des visionnages qu’il ne s’agit pas d’un accompagnement assaisonnant d’effets le jeu de la mise en scène, ni une sorte de chorégraphie comme celles de Morricone pour certains films de Leone, et encore moins un refrain rituel comme dans les œuvres de Tarkovski. En réalité, Herrmann semble avoir trouvé une quatrième voie en faisant de sa musique une sorte de personnage qui, sans se surajouter à l’atmosphère du déroulement du film et sans être non plus secondaire, hante l’image sans se substituer à son apparence : il a créé une musique qui se manifeste dans l’apparence cinématographique en s’y évanouissant et, par instant, se décalque pour elle-même. Quel est donc ce personnage sonore qui s’exprime au travers de l’image par la musique ? Qu’exprime cette force spectrale qui se manifeste en s’évanouissant ?
Si l’on considère l’ensemble de son œuvre, nous constatons que, même en nous en tenant à la seule musique de Bernard Herrmann (qu’elle soit destinée ou non au cinéma), demeure à son écoute la force évocatrice de l’image toujours liée à la Mort. Au-delà des fameuses scènes transies de meurtres des films d’Hitchcock, ou encore de ses premières collaborations comme The Ghost And Mrs. Muir (L’Aventure de Madame Muir), Herrmann atteste clairement de ce lien essentiel dès ses premières créations où domine, selon Vincent Haegele, l’ambiance gothique : que ce soit avec November Dusk ou la musique radiophonique sur le poème de Yeats La Belle Dame Sans Merci où « une rose mi-flétrie achève de mourir… », mais aussi dans ses collaborations à des films dont les thèmes ne sont pas explicitement morbides tels que Jason And The Argonauts (Jason et les Argonautes) pour lequel Herrmann composa pourtant un superbe Scherzo Macabre, ou bien encore The 7th Voyage Of Sinbad (Le Septième Voyage de Sinbad) dont la musique reprend la fameuse Danse Macabre de Camille Saint-Saëns, ou encore dans le film de Truffaut Fahrenheit 451, qui se termine par une reprise de la fameuse Pavane pour une Infante Défunte de Ravel.
Cette obsession herrmanienne liée à l’image de la Mort est aussi et surtout présente dans sa musique pure et pas uniquement dans l’illustration cinématographique. Ici foisonnent fantômes, danses macabre et revenants, notamment dans les formes classiques en leurs tonalités lugubres comme son opéra de 1943 sur le texte d’Emily Brontë Wuthering Heights (Les Hauts de Hurlevent), le scherzo de son quatuor Echoes, ou encore la Nuit Ressuscitée de son quintette, et évidemment sa reprise de la noirceur panique de L’Île des Morts de Rachmaninov dans sa symphonie. Toutes ces références macabres apparaissent maintenant clairement grâce au profond parcours exhaustif de Vincent Haegele et sa parfaite connaissance musicologique : nous pouvons donc interroger en lui-même ce lien de la musique de Herrmann à l’image de la Mort et ce qu’il exprime comme esthétique propre.
En effet, l’auteur nous dévoile dans cet ouvrage les principes de composition de Herrmann, ainsi que ses procédés esthétiques qui cherchent à lier musique et cinéma. La musique fait « partie intégrante de ses procédés créateurs » selon Herrmann : il lie image et musique tout en distinguant cette dernière, et c’est sur cette tension que repose sa force expressive. Mais si Herrmann suggère ainsi systématiquement et obsessionnellement image et Mort, ne signe-t-il pas par-là même son impossibilité ? Car en effet, l’image appartient au régime de la spatialité statique, et cela même si elle est projetée ensuite dynamiquement par le cinéma ou l’évocation symbolique ; de même, la Mort est par définition l’arrêt définitif et irrémédiable du temps vécu : alors, comment une musique dont l’essence constitutive appartient au temps – donc au développement continuel et à l’interprétation infinie – peut-elle ainsi offrir dans sa composition et suggérer à ses auditeurs Image et Mort, deux réalités hétérogènes et antithétiques quant aux modes expressifs de la musique ?
En tant que telle, dans sa pure présentation fixe, l’image est cet inquiétant silence, ce mutisme sourd que même les débuts du cinéma voulaient à toute force accompagner avec les pianos médiocres des premières projections, comme si la magie de l’image « animée » ne suffisait jamais à soutenir le spectacle de l’image en mouvement mais révélait son silence insupportable, sa ressemblance vide de simulacre, son origine d’image « d’ombre » silencieuse. Or traditionnellement, la musique est précisément cette « articulation du silence », elle fait donc plus qu’accompagner stricto sensu l’image à l’écran, mais elle l’épelle en son silence, le prononce pour faire vivre l’image au-delà du mécanisme qui la met en mouvement : l’image respire alors dans le souffle qui la projette. Car cette image est bien à l’origine Imago Mortis, le « masque mortuaire » qui prend la forme ultime du visage défunt offert une dernière fois aux lumières du monde. Quand la musique appartient au temps vécu donné, au temps émotionnellement reçu en son apparaître sonore, l’image appartient déjà au silence de la Mort.
Aussi, la musique est par son articulation la Mort du silence : la spatialité matérielle fixe de l’instrument vibre lorsqu’on en joue, et par là l’espace figé devient temps, s’extirpe vibrant, transformé dans les ondes sonores hors du régime de l’espace qui l’a vu naître, pour se mouvoir et se développer ensuite comme durée, temps. Dans la musique meurt le silence qui par vibration spatiale doit sa résurrection au temps comme son : la musique articule donc le silence par choc spatial de l’instrument, par vibration du régime de l’image dont elle fait sonner la Mort spatiale pour la faire renaître selon le temps. Et plus que nulle autre, on constate que la musique de Bernard Herrmann se tient au plus près de ce cycle : elle souligne même expressément ce processus par ses transitions composées de silence et d’accords, sans céder à la séduction populaire aisée de la mélodie, de la rengaine. Ses compositions assument cette origine silencieuse et sa résolution cinétique qui anime alors véritablement l’image en retour ou en écho de sa première origine. La musique d’Herrmann n’est donc pas générée selon l’image, mais plus profondément, créée selon les suggestions de l’origine de l’image qui est essentiellement « masque mortuaire », moins lié à l’espace fixe qu’à la Mort même dont Herrmann semble avoir scruté à travers toute son œuvre l’ambiance angoissée et l’écho du Néant.
Dans son domaine propre, Bresson avait lui aussi vu et éprouvé cette intimité de l’art cinématographique avec la Mort lorsqu’il écrivait dans ses fameuses notes : « Mon film naît une première fois dans ma tête, meurt sur le papier, est ressuscité par les personnes vivantes et les objets réels que j’emploie, qui sont tués sur pellicule mais qui, placés dans un certain ordre et projetés sur un écran, se raniment comme des fleurs dans l’eau (1) ». En regard de cela, on peut dire que Bernard Herrmann a retrouvé à sa manière dans sa musique l’expression de ce cycle gothique de Mort et de résurrection en suggérant le silence en son origine, ce fantôme de l’image et en faisant ressusciter, résonner la source dans les respirations sonores et les échos de la béance vide angoissée des rythmes cinématographiques purs.
Par sa musique, Herrmann articule plus que n’importe qui ce silence de l’image, mais il n’en a pas fait pour autant un « design sonore » contrairement à son maître Charles Ives : Herrmann le manifeste non pas dans un chaos mais dans une plasticité et une teneur concrètes, c’est-à-dire une croissance créative simultanée avec l’image (qu’elle soit faite ou non pour un film), exprimant l’origine silencieuse infinie qui rejoint ainsi la Mort dans l’angoisse et l’attente de la multiple contingence. Et si Bernard Herrmann s’est si bien entendu au départ avec Hitchcock, c’est peut-être précisément parce qu’il a su exprimer ce silence dans sa suspension dédoublée, son masque de contrepoint, son suspense, c’est-à-dire sa contingence cancéreuse dont le caractère est radicalement « l’imprévisible qui paradoxalement voit pourtant venir l’Irrémédiable ». La musique de Herrmann se manifeste comme forme irréversible et apparaît dans un inquiétant évanouissement : autrement dit, elle s’exprime en prenant la forme de la Mort à travers l’image dont elle recueille l’agonie silencieuse, articule les masques de cadavres cinétiques dans leurs accents de squelettes vivants, et tisse son suaire sonore par ses ambiances irrémédiables que nulle mélodie facile ne peut aider à remémorer.
Dans ces deux crépuscules mêlés, au-delà de la structure cinématographique, entre l’irréversible image et la fuite sonore indéfinie, Bernard Herrmann a su suggérer l’unité de l’Imago Mortis et de l’articulation du silence en remontant à l’origine du processus créateur de l’image pour en exprimer le vertige irrémédiable. Encore une fois, ce vertige n’a pas, ne peut pas avoir de mélodie aisée, de repère comme le retour rassurant du leitmotiv ou du refrain : la musique herrmannienne ponctue mais n’explique pas ; ses airs n’accentuent l’action qu’en résonance, selon une sorte d’arrière-fond mystérieux, une nuit lovecraftienne insondable fructifiant dans l’écho d’un néant qui ne raconte rien mais hurle sa noirceur aveugle, sa « colère divine » ressuscitée non pas comme le folklore d’un deus ex machina surajouté, mais une sorte de voix off nébuleuse, sans identifiant possible, l’onde de l’au-delà dont on entend par instant l’apesanteur suspendue, le fourmillement magnétique brumeux et les stridentes frictions d’ombres évanescentes animées par la Mort imminente.
C’est en cela aussi que Bernard Herrmann reste un artiste qui, même s’il « connaissait son Wagner par cœur » et a participé directement à l’élaboration de certaines mises en scène, n’a cependant pas su totalement émanciper sa musique du régime de l’image en créant – comme Wagner – son propre régime plastique soumis cette fois-ci à des principes strictement musicaux. Aussi trouve-t-on chez lui cette hésitation expressive, cette tension mentionnée au début de notre réflexion, qui rend son œuvre singulière et originale, mais qui reste plus ou moins relative à des régimes non musicaux. Comme si – en dehors de ses propres nécessités économiques évidentes – Herrmann avait eu besoin d’exprimer son art musical à partir de ce qui le met le plus en danger ou le rend par essence impossible… Impossible, comme le prouve d’ailleurs tout le parcours riche en anecdotes de Bernard Herrmann, un génie de la musique de film, pas simplement dans ses rapports humains…
Mais même si la vie de la Mort du silence chez Bernard Herrmann est systématiquement articulée, reflétée sur l’origine de l’image, le masque mortuaire, sa musique y trouve cependant l’originalité qui en fait sa force et son irrésistible puissance hypnotique : c’est celle d’un personnage fantomatique qui s’évanouit et rôde avec tact, surprend à chaque instant l’animation et caresse sa séquence. On ne trouve pas dans ces suggestions herrmanniennes de couleurs musicales mièvres ou de mélodies roses ; mais dans cette absence, par cette absence naît l’imprévisible flux et reflux d’ombres suspendues dans le reflet du masque, cette danse macabre anonyme et froide, sans ritournelle et sans mémoire, dont « les charmes de l’horreur n’enivrent que les forts », et aussi parfois les antédiluviens hurlements sans retour de l’Insondable, les grondements troubles du sans-fond dans l’air silencieux de l’irrémédiable, « l’air sans note fait pour nous, l’air de la Mort ».
























