 HARDCORE HENRY (2015)
HARDCORE HENRY (2015)
HARDCORE HENRY
Compositeur : Dasha Charusha
Durée : 51:43 | 25 pistes
Éditeur : Sony Masterworks
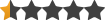
À l’ère antédiluvienne du Laserdisc, le sympathique jean-foutre Robert Rodriguez théorisait que l’interactivité sans précédent d’un tel support était en train de chambouler les manières, jusqu’alors gravées dans le marbre, d’appréhender le cinéma. Le chapitrage en particulier, pensé comme un aboutissement à l’omnipotence des vidéophages déjà investis par la VHS d’un pouvoir presque démiurgique, se révéla un outil des plus commodes pour qui souhaitait se repaître à tire-larigot de ses séquences favorites. Dans le cas du réalisateur mexicain, amateur gourmand d’ultra-violence et de pétoires fumantes, visionner un film d’action à la maison se mua bien vite en farandole de coups et blessures, où l’intérêt suprême consistait désormais à sauter à sa guise d’un morceau de bravoure à l’autre. Grâce à une télécommande docile, le genre tournait soudain à une expérience abstraite, une abstraction saturée d’adrénaline liquidant ses personnages, si caricaturaux puissent-ils être, ses nœuds dramatiques, même rabougris, et plus généralement toute considération d’ordre moral, pour laisser à nu le spectacle seul — rien d’autre. Ce culte de la jouissance sans borne, assez voisin tout bien soupesé du modus operandi exclusif du cinéma X, d’aucuns n’attendirent pas la révolution domestique pour s’en montrer d’ardents zélateurs, comme les trompe-la-mort des comédies burlesques du temps du muet, ainsi que leurs héritiers cinglés dans la turbulente Hong Kong. À ces hordes-là, s’additionnent quelques tentatives en solitaire, le foutraque Versus au Japon, sans négliger outre-Atlantique un Commando de gouleyante mémoire. Mais c’est de Russie que nous vient peut-être l’ultime ayatollah d’une fiévreuse exacerbation des sens.
Le responsable de ces lignes se doit de faire preuve d’un tant soit peu d’honnêteté envers l’honorable lecteur, qui, dans sa perspicacité infinie, aura sans doute déjà soupçonné qu’il y a là anguille sous roche. Dans une rubrique où le prisme musical doit supposément maculer l’analyse de ses reflets pluriels, et tant qu’à faire d’une façon positive, Hardcore Henry détonne. On ne voit guère quel bon point accorder à ce bruyant fatras croulant de tous côtés, sinon, à la rigueur, le zèle écervelé avec lequel il couvre le jeu de massacre. Entièrement tourné en vue subjective par le biais d’une GoPro nauséeuse, le film rapetisse son dispositif scénique à deux mains en amorce du cadre, au creux desquelles passe tout un spectaculaire arsenal. Enfouraillé de la sorte, le dénommé Henry, dont le mutisme achève d’annihiler auprès du spectateur un éventuel processus d’identification, s’en va tabasser, éparpiller, flinguer, éviscérer, dynamiter à peu près tout ce qui bouge sur fond d’électro volontiers technoïde. Il suffirait de livrer le film avec un joystick pour que sa ressemblance avec les orgies de gros calibres du FPS devienne congénitale, abolissant ipso facto la dernière maigre distance qu’il fait mine de respecter entre lui et ce qu’il croit être son public. On trouvera certes aux aptitudes extraordinaires du héros un alibi science-fictionnel, nappé par Dasha Charusha, la propre femme du réalisateur, d’un de ces ambient si peu impliqués sur le plan émotionnel qu’ils frisent l’autisme. L’amour, celui par lequel tout peut arriver, qui donne des ailes et abat des montagnes, est même de l’aventure, quoique la musique, en ensevelissant les formidables élans du cœur sous une batterie de pulsations atones, n’évoque pas grand-chose d’autre que le climat stérile d’un bloc opératoire. Mais rien de tout ça, au fond, n’intéresse vraiment Hardcore Henry. Seules comptent la grand-messe exterminatrice qu’il s’est décrétée pour sacerdoce, et la conviction viscéralement chevillée au corps que le cinéma d’action, si ce n’est le cinéma tout court, sortira d’un tel grand huit métamorphosé de pied en cap — pour son malheur, faut-il le préciser.
Pas loin de dix ans après sa sortie, on ne saurait dire si ses ambitions hystériques de poser un nouveau et décisif jalon ont été couronnées de succès. La descendance qu’il y avait tout lieu de redouter à cet objet bossué de scrofules n’a, en tout cas, pas (encore) vu le jour. Mais la musique à l’œuvre, conçue comme un jet de punaises au fond du conduit auditif, tyrannise toujours… Il y a d’ailleurs là un hiatus assez curieux. Car si le film entend faire table rase du passé en réduisant en poussière les cloisons qui séparent le cinéma d’une virtualité ivre de sa complaisance, la tambouille de Charusha, malgré une osmose qui n’est que de façade avec cet amoncellement halluciné de morts violentes, se borne à brasser des poncifs, mille fois endurés auparavant, mille fois subis depuis. Aucune anarchie grossièrement punk là-dedans, pas l’ombre d’une velléité de rebattre les cartes par le chaos. Au contraire, la docilité dont elle fait montre, qui rampe devant tout ce que l’électro-vermoulu énumère de lieux communs, relève d’une soumission servile. Pensiez-vous que le personnage de Jimmy, encore une protubérance vidéoludique qui s’exhibe crânement (il passe son temps à mourir puis à ressusciter), eût réussi à écarter Charusha de sa routine creuse ? Aussi dénuée de caractère musical que le névropathe Henry l’est de substance, elle persécute son attirail synthétique sans autre objectif que de doubler d’une couche flasque de gras le vacarme des fusillades. À force de s’égosiller, elle passe tout proche d’injecter une dose salutaire de peps au déchaînement final des pouvoirs mutants de l’albinos en chef, qui engloutit dans un terrible maelstrom les reliefs d’un bodycount de concours et des riffs démontés. Si elle y était parvenue, ç’eût été par accident. Non, décidément, il n’y a que lors des trop rares incises où s’interrompt son tohu-bohu que l’on apprécie la dame. Moult mercis, par conséquent, à l’étrange danse des duplicatas, bercée par le swing moelleux d’I’ve Got You Under My Skin ; merci également à cette éphémère incartade comique, voyant Henry les quatre fers en l’air après qu’il ait tenté de sauter à dos de canasson. Pour railler ses piteux efforts, un orchestre que nul n’osait plus espérer dans une pareille gabegie produit soudain une superbe langue de flammes et de panache, ô combien familière : le thème de The Magnificent Seven ! Soudain, la grâce.











