 DARK OF THE SUN (1968)
DARK OF THE SUN (1968)
LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
Compositeur : Jacques Loussier
Durée : 65:55 | 27 pistes
Éditeur : Film Score Monthly
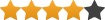
Pour nous autres gens de la francophonie, les remugles fanés de ce qui fut le Congo belge charrient surtout avec eux l’image en noir et blanc d’un Tintin mal dégrossi encore, endossant au pied levé le rôle de maître de classe afin d’entretenir les gentils autochtones de leur « patrie » — la Belgique, vous l’aurez deviné. Le colonialisme arborait ici son visage le plus benoît, entre stéréotypes obligeamment nourris par des missionnaires casqués et paternalisme visqueux de condescendance. Dans de tout autres pages en revanche, celles noircies par le débutant et futur taulier du roman d’aventures Wilbur Smith, le ton change radicalement ! Massacres insensés, rebelles imperméables à la moindre clémence et mercenaires pas du genre à faire de quartier maculent d’écarlate le continent africain, en proie aux affres de la fin des temps. Le film d’action exotique qu’il eût été possible malgré tout de tirer d’un tel récit, évidemment au prix de sauvages édulcorations, ne dépassa pas le stade de simple chimère. Sa carrière en tant que réalisateur a beau ne pas faire un instant le poids contre son sidérant pedigree de chef-opérateur, Jack Cardiff y œuvra plus d’une fois ainsi qu’un parfait iconoclaste. Et sur Dark Of The Sun, ô combien ! Il apparaît carnassier, résolu coûte que coûte à ne gratifier d’aucune escale son voyage vers l’abîme. La musique est la première à vendre la mèche, en tuant dans l’œuf, dès le générique baigné du jaune pisseux de la fièvre, le moindre cliché martial prêt à saillir : roulements de tambour, cuivres qui vont au pas de l’oie et tout le saint-frusquin. En lieu et place, orgue et clavecin mêlés dégagent par entêtantes bouffées quelque chose de sépulcral, sur quoi le pupitre des cordes renchérit en opacifiant le crépuscule près d’engloutir l’humanité.
Spontanément, ce formidable cocktail fait songer à Ennio Morricone, qui cravachait depuis le mitan des swinging sixties à la tête d’une extraordinaire révolution européenne. La griffe tout aussi audacieuse de François de Roubaix semble une autre hypothèse crédible, s’enhardit à supputer le spectateur mélomane, tandis que ses yeux aux aguets attendent que le nom de l’heureux élu se matérialise dans les crédits de l’ouverture. Surprise ! Il s’agit en réalité de Jacques Loussier. Entre l’artisan populaire et un peu savant aussi, qui vendit des millions de disques en passant à la joyeuse moulinette du swing le répertoire de Bach, et cette sommation musicale à abandonner tout espoir, la connexion paraît ardue à établir. Elle n’ébaubira que ceux qui ignorent l’appétence jamais désavouée du compositeur pour la pluralité des styles, confession revigorante de la part d’un proclamé jazzman censé ne pas déborder de son pré carré. L’image d’Épinal empêtrant celui-ci d’une queue-de-pie et d’un nœud papillon s’évapore également face aux regrets de Loussier, fort marri que le montage brut dont on lui accorda la primeur, et qui brillait d’après ses dires par une violence rouge et farouche, n’ait survécu in fine qu’à l’état de fragments. Cette furia qui l’estomaqua, il voulut à toute force, aux commandes de son athlétique formation londonienne, en préserver au moins le souvenir. Sa réussite est éloquente d’emblée, lorsque les chiens de guerre s’activent en suant d’abondance autour du train qui doit les conduire tout droit en enfer. Aussi efficace qu’un fouet de contremaître, le piano bat furieusement la mesure d’un ostinato redoutable, gonflant les muscles bandés des hommes à la manœuvre, extorquant à l’acier noir des brumes de vapeur. La fuite en avant compose le motif majuscule de cette séquence, mais aussi du film dans son ensemble, tombé sous le joug d’un battement rythmique impitoyable, un hoquet de métronome qui interdit quelque repos que ce soit ; un aiguillon chauffé à blanc donc, dont l’écho obstiné, presque morbide à force d’être ressassé, pousse le dur à cuire Curry (Rod Taylor, dont les mâchoires carrées ne furent peut-être jamais mieux utilisées qu’ici) et sa troupe en treillis toujours plus loin dans l’antichambre de la damnation.
Même contraints à faire halte, par la faute d’un coffre-fort récalcitrant, Loussier ne desserre pas l’étreinte autour de ces anti-héros. De tic-tac où le danger se love, son motif se mue en véritable compte à rebours, roide de stress à l’approche des indépendantistes à la machette volubile. C’est à peine si Curry aura eu le temps de recouvrer son souffle après la violente escarmouche contre un ancien SS, pas vraiment repenti… Un duel absurde, dominé par le rugissement d’une tronçonneuse et l’inéluctabilité, prégnante comme jamais, du thème principal, où les cymbales font tituber les rivaux enragés au bord du gouffre. Sans Jim Brown, probablement se seraient-ils entretués. Surprenant en soldat du cru « civilisé », l’ancien enfant terrible du football américain incarne la foi en de meilleurs lendemains, qui libèreraient le Congo des fers d’une sauvagerie ancestrale pour découvrir son cœur noble et humain. Elle est là, cette identité chaleureuse, à travers les chants gutturaux que Jacques Loussier, profitant de rares instants de paix, donne aux natifs — encore qu’on s’abstiendra de prendre pour argent comptant leur soi-disant authenticité, redevable à plus d’un égard à l’exotica et ses fantasmes ensoleillés de danse du ventre. Au fond, Curry lui-même, malgré son cynisme endurci par la guerre, ne demande qu’à croire. Mais devant le cadavre de son camarade si plein de sagesse, victime de la traitrise du nazi, son sang bouillant ne réclame qu’une chose : vengeance ! Celle-ci sera consommée au bout d’une traque folle, grosse de cuivres que la colère rend sentencieux et suffoquée par la lourde chape du piano. L’utopie s’évanouit, la ligne ténue entre le guerrier blanc et le guerrier noir disparaît, les soumettant l’un comme l’autre à une égale barbarie. Sur le visage sombre de Curry, écoeuré plutôt qu’exalté de s’être ainsi vautré dans le sang, passe cependant un frisson, telle une réminiscence sourde de l’idéalisme qu’avait voulu lui inculquer son compagnon. La décision qu’il prend alors de se livrer à la justice s’inscrit, grâce au superbe friselis de flute troussé par un Jacques Loussier ayant bien compris que quelque chose de crucial advenait, dans un registre mélancolique d’où l’espoir n’est pas fatalement banni. Sa carrière de mercenaire errant résolument close, Curry devient in extremis le nouvel ancrage moral de Dark Of The Sun, son phare dressé contre la bestialité aveugle. S’il ne portera peut-être jamais aussi haut les rêves et les illusions de son ami, au moins s’est-il découvert et révélé pour ce qu’il restera dorénavant, quel que soit le prix à payer : un homme.












